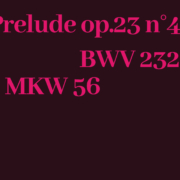« – Offenbach, c’est vieux. C’est de l’opéra en plus, on va rien comprendre ! Le vocabulaire n’est jamais clair !
-C’est vrai, mais pour y voir plus clair, quelques mots inhabituels traduits par nos soins dans un langage plus contemporain » : Voici un petit lexique – non exhaustif mais tout de même utile – des mots inhabituels que l’on peut trouver dans les opérettes d’Offenbach.
Le champ lexical de la guerre
Fifre : désigne d’abord une petite flûte traversière en bois utilisée pour la musique militaire. Son son est très aigu. Par métonymie, désigne la personne qui en joue.
Vivandière : Au féminin, parce qu’à l’époque c’est un métier de femmes, les hommes étant à la guerre. Cela désigne une personne autorisée à suivre l’armée pour vendre aux troupes des vivres et des boissons.
Le champ lexical de l’amour
Particulier: dans Madame Favart lorsque le sergent Larose cherche son « particulier », il cherche une personne privée par opposition à la collectivité (l’Etat) qu’il représente. En revanche dans Orphée aux enfers, la « particulière » que le dieu Mars est allée voir est une amante. C’est un usage vieilli.
Tendron : de « tendre », désigne une très jeune fille, dont la jeunesse a séduit un homme d’âge mûr. En botanique, cela désigne aussi le nouveau bourgeon d’un arbre, pour vous donner une idée de l’âge d’un « tendron ».
Le champ lexical de la beuverie
Être gris : être légèrement ivre .
Se griser: s’enivrer, boire, et de l’alcool, pas de l’eau. Par extension, comme pour le verbe s’enivrer, cela signifie s’exciter, s’étourdir.
Les références à la mythologie grecque et romaine
Les lieux
Arcadie : région montagneuse de Grèce qui descend vers la mer Égée. En littérature et dans les légendes, c’est la patrie du dieu Pan, lieu idyllique peuplé de bergers paisibles, symbole de l’âge d’or.
Cythère : petite île de Grèce, comportant un temple à Vénus (Aphrodite) la déesse de l’amour. L’expression “s’embarquer pour Cythère” signifie avoir un rendez-vous galant.
Enfers: Au pluriel, désigne le royaume de Pluton (Hadès), un royaume souterrain, gardé par Charon et Cerbère et résidence des âmes après la mort. Il est composé de plusieurs régions telles que Les Champs Élysées, le Tartare etc, et séparé du monde des vivants par le fleuve Styx. Les défunts y sont envoyés après jugement en fonction de ce qu’ils méritent : le Tartare pour les damnés, les Champs Élysées pour les vertueux.
Olympe : ultra galère à gravir sans guide, l’Olympe est une vraie montagne située dans le Nord de la Grèce. Étant la plus haute de cette région, elle a été déclarée « demeure des Dieux » par Homère, et lieu de rassemblement autour de Jupiter (Zeus).
Les personnages
Actéon : Dans le mythe le plus connu, Actéon est un chasseur habile mais orgueilleux qui connaît une fin tragique : sur le mont Cithéron, il aperçoit la déesse Diane (Artémis) prenant son bain. Celle-ci, furieuse d’être surprise nue, le transforme en cerf et excite ses chiens contre lui jusqu’à ce qu’ils le dévorent. Dans la version d’Offenbach, la prude Diane n’est pas si prude, puisqu’elle est en vérité ravie des avances d’Actéon et c’est Jupiter (Zeus), pour préserver la réputation de sa fille, qui change le voyeur en cerf.
Admète : roi de Phères en Grèce actuelle. Il est connu surtout pour être le mari d’Alceste qui donna sa vie pour sauver celle de son mari. Il est aussi temporairement le maître d’Apollon, qui est condamné par Jupiter à jouer le rôle de berger sous les ordres d’Admète.
Alcmène : l’épouse d’Amphitryon, qu’elle trompe bien malgré elle. En effet, Jupiter l’abuse en se faisant passer pour Amphitryon. De cette union naît Hercule, mais Amphitryon, apprenant la tromperie, condamne sa femme au bûcher. Jupiter la sauve par un orage qui éteint les flammes.
Bacchante : le terme vient de Bacchus, le dieu du vin chez les Latins (Dionysos chez les Grecs). Les bacchantes sont les femmes qui lui vouent un culte, ses prêtresses. Elles sont reconnaissables par leur cri caractéristique « évoé ! ».
Bacchus : Dieu de l’ivresse et de la débauche, fils de Jupiter et de Sémélé. Il est gagnant à la fin.
Cerbère : Chien à trois têtes, il est le gardien des Enfers.
Cupidon : Fils de Mars et de Vénus dans la mythologie romaine. Il est le dieu de l’amour. Dans la pièce, il est fils de Jupiter.
Diane : Déesse de la chasse, fille de Jupiter, couramment appelée la « chaste Diane ».
Ephèbe : dans l’antiquité grecque, désigne un jeune garçon arrivé à la puberté. Un ado quoi.
Europe : un continent certes, mais également la mère de Minos et Rhadamanthe. Elle est surtout connue pour avoir été enlevée par Jupiter qui l’approche sous la forme d’un taureau blanc pour ne pas s’attirer les foudres de Junon (Héra).
Danaé : Fille du roi d’Argos, elle grandit enfermée dans une tour, non par une sorcière comme Raiponce, mais par son propre père qui a peur qu’elle tombe enceinte, car un oracle lui a prédit qu’il serait tué par son petit-fils. Cependant, Jupiter (encore lui !) s’introduit dans la tour sous la forme d’une pluie d’or. De son union avec Danaé naîtra Persée.
Grâces : Dans Orphée aux enfers, il s’agit de trois déesses qui accompagnent Vénus et qui personnifient le don de plaire. Par extension, les femmes ayant beaucoup de charme ou encore simplement les charmes de quelqu’un.
Junon : Femme et sœur de Jupiter, reine des dieux, elle est jalouse et son mari ne fait rien pour arranger son cas.
Jupin : diminutif de Jupiter (Zeus). Offenbach n’est pas le seul à utiliser ce diminutif mais dans Orphée aux enfers, il est chargé de beaucoup d’ironie. Le Littré donne comme étymologie Juppin signifiant polisson au XVIe siècle.
Jupiter : Roi des dieux, il règne sur les dieux et les mortels depuis les hauteurs du mont Olympe.
Léda : Pour continuer avec les conquêtes de Jupiter (toujours lui), Léda fut sensible aux charmes du dieu métamorphosé en cygne. À la suite de cette aventure, elle donna naissance à quatre enfants, sortis de deux œufs, dont la fameuse Hélène, autre héroïne chère à Offenbach, ainsi que Clytemnestre, Castor et Pollux. Il existe une autre version du mythe dont s’inspire Offenbach: refusant les avances du Dieu, celui-ci est obligé de recourir à une ruse : après s’être changé en cygne, il demande à Vénus de prendre la forme d’un aigle et de le poursuivre. Ainsi chassé, il peut se réfugier dans les bras de Léda et en profiter pour s’unir à elle.
Mars : Dieu de la guerre, Fils de Jupiter et Junon, père de Romulus et Remus.Mercure : Dieu du commerce, des voyageurs et des voleurs, il est le messager des dieux. Symbole de son zèle, il porte des sandales ailées.
Mercure : Dieu du commerce, des voyageurs et des voleurs, il est le messager des dieux. Symbole de son zèle, il porte des sandales ailées.
Minos, Eaque et Rhadamanthe : Anciens seigneurs réputés pour leur vertu. Minos est roi de Crète, c’est lui qui emmura le minotaure. Rhadamanthe est son frère. Eaque est le premier roi des Myrmidons et le grand-père du bouillant Achille. Tous trois sont, une fois morts, devenus juges des Enfers.
Muses : Neuf déesses, filles de Zeus, protectrices des arts. À chacune d’elle est associé un art : Clio (l’histoire), Euterpe (la musique), Thalie (la comédie), Melpomène (le chant et la tragédie), Terpsichore (la danse), Erato (la poésie lyrique et érotique), Polymnie (l’éloquence), Uranie (l’astronomie) et Calliope (la poésie épique). Dans un usage plus courant, la muse est une expression imagée pour désigner l’inspiration de l’artiste.
Nymphe : Divinités secondaires incarnant un élément de la nature : les forêts (dryades), les eaux (naïades), les mers (néréides) etc. Elles sont représentées sous la forme de jeunes filles gracieuses.
Pluton : Dieu des Enfers, frère de Jupiter, il est moins bien logé que ce dernier.
Styx : Ce n’est pas une personne, mais l’un des fleuves des Enfers. Il sépare le monde terrestre et le monde souterrain. Pour entrer aux Enfers, il faut le traverser sur la barque de Charon. Sa source se trouve dans le massif de Chelmós en Grèce.
Terpsichore : cf. une muse.
Thémis : déesse de la justice, de la loi et de l’équité, elle est la tante de Jupiter (Zeus). Elle appartient à la race des Titans, enfants d’Ouranos (le ciel) et de Gaïa (la terre).
Vénus : Déesse de l’amour et de la beauté, fille de Gaïa et Ouranos, mère de Cupidon.
Les références à la société du XIXe siècle (termes vieillis, quoi)
Cotillon : Soit une jupe soit, le plus souvent, une danse collective dansée à la fin des bals surtout au XIXe siècle.
Douairière : femme veuve possédant une douaire, c’est-à-dire un droit d’usufruit sur les biens de feu son mari (puisqu’à cette époque une femme ne possède rien en propre). Dans l’imaginaire collectif, une douairière est une vieille femme aristocrate et riche, comme dans Downton Abbey.
Hyménée : un mariage, mais dans la langue du XVIe essentiellement (et des poètes !)
Mantille : pièce d’habillement proche de l’écharpe pour couvrir la tête et les épaules.
Marmiton : nom qu’on donne à l’apprenti cuisinier ou aide cuisinier.
Pelisse : vêtement masculin ou féminin, long ou court, en fourrure (dedans, dessus, comme on veut).
Soubrette : nom que l’on donne aux servantes ou aux suivantes au théâtre.
Jurons
Sacrebleu : utilisé pour la première fois par Rabelais en 1552, la forme initiale était « Sacre Dieu ». Comme beaucoup d’insultes, le mot évolue avec l’emploi, et dès le siècle suivant, on trouve la forme « sacrebleu ». Notez que beaucoup de jurons sont créés sur le mot « dieu » qui devient « bleu » pour faciliter la prononciation en se débarrassant du son dental. Cela permet également d’atténuer la gravité du juron puisque jurer le nom de Dieu était perçu comme du blasphème. « Sacrebleu » est utilisé pour marquer l’impatience ou l’étonnement ou encore pour appuyer son propos.
Saperlotte : forme atténuée de « sapristi », probablement de la même étymologie que sacrebleu.
Corbleu : étymologie plus difficile à retracer, (cœur Dieu ou corps Dieu ?) ce juron marque une nuance d’indignation et beaucoup de colère.
Ventrebleu : marqueur de surprise, d’étonnement ou d’indignation, synonyme des interjections qui suivent.
Maugrebleu : forme euphémisée de « malgré Dieu », signifiant l’exaspération et la colère.
Morbleu / mordieu / mordienne : forme euphémisée de « Mort de Dieu ». La forme varie selon les régions (mordious est le plus connu et appartient aux Gascons).
Parbleu : « pardi ! bien sûr ! »signification souvent ironique. Forme euphémisée de « par Dieu ».
Palsambleu / palsanguienne : au théâtre, typique du registre paysan. Forme euphémisée de l’expression « par le sang de Dieu ».
Références aux arts
Deus ex machina : Du latin, qui signifie « Dieu sorti de la machine » et désigne au théâtre les procédés scéniques qui permettent de faire intervenir un dieu dans la pièce (trappe, grue etc.). On utilise cette expression pour parler des scènes où l’intervention d’un dieu permet de résoudre un conflit ou de conclure la pièce, et par extension pour tout élément inattendu ou extraordinaire (voire tiré par les cheveux) qui permet de conclure brusquement l’intrigue.
L’Opinion Publique : Dans Orphée aux enfers, ce personnage incarne l’ensemble des valeurs et croyances partagées par une société, à savoir ici celle du public. Sa présentation au début de la pièce évoque le chœur dans le théâtre antique. Elle déclare en effet, « j’ai perfectionné le chœur » en référence à celui-ci, dont le rôle était d’expliciter les événements de la pièce pour faciliter la compréhension du public. Ce rôle est à la fois amplifié et moqué dans l’opérette, car l’Opinion publique devient un personnage à part entière capable d’agir sur scène. Mais à cause de cette capacité, l’Opinion Publique perd son statut omniscient et est potentiellement soumise aux péripéties du drame.
Patelin: Qui est d’une douceur hypocrite. L’adjectif vient de La farce de Maître Pathelin, pièce anonyme datant du XVe siècle. Elle met en scène un personnage trompeur entreprenant une suite de ruses et de fraudes où le trompeur finit par être trompé à son tour. Dans Orphée aux Enfers, l’utilisation de cet adjectif apparaît dans le « rondeau des métamorphoses », où une partie des tromperies de Jupiter est dévoilée. L’adjectif est employé en parallèle du mot « farce », ce qui évoque la pièce. Ainsi, Jupiter, le trompeur, va sans doute finir berné.
Pizzicato : de l’italien, « pincé », technique pour jouer d’un instrument à cordes, en pinçant la corde avec les doigts plutôt qu’en la frottant avec l’archet.
Vielleuse : joueuse de vielle, instrument à cordes, ancêtre de la viole.
Références à la religion
Anathème : sentence de malédiction à l’encontre d’une personne jugée hérétique. Par extension, une condamnation, un blâme. « ‘Ne pas se faire montrer au doigt’, voilà encore une loi terrible. Être montré au doigt, c’est le diminutif de l’anathème ». Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer.
Ursulines : sœurs d’un ordre religieux catholique fondé en 1535 en Italie, se réclamant du patronage de Sainte Ursule et se consacrant à l’éducation des filles. Établies en France en 1608.
Autre
Bouillet : Marie-Nicolas de son prénom, auteur du dictionnaire universel d’histoire et de géographie, paru en 1842, et immensément populaire à sa sortie.
Cloaque : une sorte d’égout, un endroit malsain aux eaux stagnantes où croupissent des ordures.
Chevalet : Sur un violon, un alto, un violoncelle ou encore une contrebasse, le chevalet est la pièce en bois sur laquelle sont tendues les cordes au milieu de l’instrument. Jouer avec l’archet près du chevalet — sul ponticello en italien — permet d’obtenir un son grinçant.
Commissionnaire : un intermédiaire entre deux commerçants (moyennant argent, la commission).
Étoupe : résidu de fibres, en particulier du chanvre, inflammable.
Evoé : Cri d’acclamation à Bacchus. Vient du grec et à la même racine que « ovation ».
Flagorner : flatter bassement, peu subtilement.
Greffier : dans le contexte juridique français, un greffier est un officier de justice chargé de dresser le procès-verbal de l’audience et d’authentifier les actes de justice (entre autres missions).
Limier : personne ayant beaucoup de flair, chien (pour le gibier) ou policier (pour les suspects).
Nectar et ambroisie : Boisson et nourriture des dieux. Les mortels ne sont pas dignes d’y goûter.
Rixe : querelle violente avec coups et injures.
Pampre : rameau de vigne.
Rapt : enlèvement, tout simplement, que cela soit par séduction ou par violence.
Sémillant : vif, enjoué, fringant, pétillant.
Trémolo : Aux cordes, le trémolo est une sorte de tremblement obtenu par des va-et-vient rapides de l’archet sur la corde.
https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1843_num_4_1_451735
https://www.cnrtl.fr/definition/
https://www.littre.org/definition/jupin
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Normandie, PUF, 2014