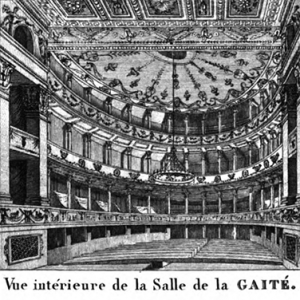Livret de Alfred Duru et Henri Chivot
Adaptation d’Emmanuel Ménard
Musique de Jacques Offenbach
PERSONNAGES
- FAVART
- LE MARQUIS DE PONTSABLÉ
- HECTOR DE BOISPREAU
- LE MAJOR COTIGNAC
- BISCOTIN, aubergiste
- LE SERGENT LAROSE
- MADAME FAVART
- SUZANNE
- JOLICŒUR
- SANS-QUARTIER
- LARISSOLE
- BABET, servante
- JEANNETON, id
Voyageurs, Invités, Officiers et Soldats, Fifres et Cantinières, Marmitons, Tapissiers, Garçons d’auberge, Les Personnages de La Chercheuse d’esprit
Le premier acte à Arras. Le deuxième acte à Douai. Le troisième au camp du maréchal de Saxe.
Acte Premier
Scène PREMIÈRE
BISCOTIN, BABET, JEANNETON, Voyageurs.
Au lever du rideau, les voyageurs arrivent par le fond, et sont reçus par les servantes et Biscotin.
N° 1 – CHŒUR DES VOYAGEURS.
Enfin le coche est arrivé,
Nous cahotant sur le pavé,
Après cette course infernale,
Vite, vite, qu’on nous installe !
BISCOTIN.
Bonjour, messieurs, bonjour mesdames,
Donnez-vous la peine d’entrer.
BABET.
Chez nous, pour vous satisfaire,
On saurait si bien vous plaire,
JEANNETON.
Que tous vous viendrez revoir
L’auberge du Lapin noir !
LES VOYAGEURS.
Enfin le coche est arrivé,
Nous cahotant sur le pavé,
Après cette course infernale,
Vite, vite, qu’on nous installe !
Qu’on nous conduise promptement
Chacun à notre logement.
Pendant que les voyageurs entrent dans les chambres à droite et à gauche, on voit arriver par le fond Cotignac et Suzanne.
Scène II
BISCOTIN, COTIGNAC, SUZANNE.
SUZANNE, entrant.
Bonjour M. Biscotin. Venez donc, papa…
COTIGNAC, la suivant.
Me voici, ma fille… C’est curieux… je m’étais endormi… ça ne m’arrive jamais..
BISCOTIN.
Eh ! mais, c’est M. le major Cotignac… et sa charmante fille…
COTIGNAC.
Bonjour, Biscotin, bonjour… Vous voyez que je vous suis fidèle et que toutes les fois que j’ai affaire à Arras, c’est chez vous que je descends…
BISCOTIN.
Vous me faites beaucoup d’honneur !
COTIGNAC.
Débarrasse-toi, Suzanne… ôte ta pelisse… ta mantille…
Suzanne retire sa pelisse et sa mantille qu’elle accroche à un cintre.
BISCOTIN.
Comme elle est grande, mademoiselle… et belle maintenant…
COTIGNAC.
Elle est très-belle… c’est dans le sang des Cotignac… (A Suzanne qui regarde au fond.) Eh bien ! mademoiselle, qu’est-ce que vous regardez là ?
SUZANNE.
Rien, papa…
BISCOTIN, à Cotignac.
Est-ce que vous êtes pour longtemps à Arras ?
COTIGNAC.
Du tout !… Je retourne au camp du maréchal de Saxe.
BISCOTIN.
Ah ! ah ! on dit que ça va chauffer par là ?…
COTIGNAC.
Je le crois… ma fille m’a fait la conduite jusqu’ici où j’ai une visite à rendre à M. de Pontsablé, le gouverneur de l’Artois.
BISCOTIN.
Tiens… vous avez affaire à notre gouverneur ?…
COTIGNAC.
Une requête à lui présenter… Est-il d’un abord facile, ce Pontsablé ?
BISCOTIN.
Mais oui… (Riant.) Surtout pour les dames.
COTIGNAC.
Bah !… Est-ce que ?…
BISCOTIN.
Disons qu’il a la réputation de céder facilement aux femmes qui lui cèdent…
COTIGNAC.
Vraiment ?… (Se retournant et voyant Suzanne qui regarde au fond.) Encore ?… Ah çà ! mademoiselle, qu’est-ce que vous avez donc à regarder comme cela dans la rue ?…
SUZANNE.
Mais papa… je…
COTIGNAC.
Ouais !… C’est pour voir si ce jeune homme nous a suivis, n’est-ce pas ?
BISCOTIN.
Un jeune homme ?…
SUZANNE.
Je ne sais de qui vous parlez, mon père.
COTIGNAC.
Un audacieux quidam qui, depuis Saint-Quentin, marche sur nos talons.
SUZANNE.
Oh ! sur nos talons, c’est impossible… puisque nous étions dans le coche, et lui à cheval…
COTIGNAC.
Eh bien oui, à cheval. C’est ainsi que vous ne savez pas de qui je parle, ma fille ?
Enfin, à cheval !… parlons-en… Une mauvaise jument dont je ne donnerais pas trois écus… nous allions beaucoup plus vite que lui, et j’espérais toujours en être débarrassé…
BISCOTIN.
Eh bien ?…
COTIGNAC.
Eh bien ! pas du tout… nous n’étions pas plus tôt entrés dans une auberge, pour relayer et nous rafraîchir un peu, que nous entendions au dehors une voix qui criait : « Garçon ! un picotin d’avoine pour Aglaé, et une omelette pour moi !… » C’était lui et sa jument qui nous avaient rattrapés.
SUZANNE.
Voyons, papa, s’il a affaire du même côté que nous, il est bien libre de suivre la même route…
COTIGNAC.
Tu trouves cela, toi… Heureusement qu’Arras est grand et qu’il ne sait pas à quelle auberge nous sommes descendus… J’espère donc cette fois, que nous ne le reverrons plus…
HECTOR, dans la cour.
Garçon ! un picotin d’avoine pour Aglaé, et une omelette pour moi…
Scène III
Les Mêmes, HECTOR.
N° 2 – TRIO
SUZANNE.
C’est lui !
COTIGNAC, apercevant Hector.
C’est lui !
SUZANNE.
Ah quel plaisir!
COTIGNAC, furieux.
Ah quel ennui !
SUZANNE.
Oui, c’est bien lui !
COTIGNAC.
Oui, c’est bien lui.
HECTOR, s’avançant.
Quoi ! je vous rencontre encor
Et la chance m’est fidèle…
A Cotignac.
Bonjour, monsieur le major…
A Suzanne.
Serviteur, mademoiselle…
COTIGNAC.
Halte-là ! monsieur… Suzanne
Ne vous connaît pas du tout…
HECTOR.
Pardon si je vous chicane,
Nous nous connaissons beaucoup…
COTIGNAC, surpris, à sa fille.
Tu le connais ?…
SUZANNE.
Oui, papa…
HECTOR.
Et de plus nous nous plaisons !
COTIGNAC, à Suzanne.
Vous vous plaisez ?…
SUZANNE.
Oui, papa…
HECTOR.
En un mot nous nous aimons.
COTIGNAC, à Suzanne.
Vous vous aimez ?…
SUZANNE.
Oui, papa…
COTIGNAC.
ventrebleu ! qu’apprends-je là !
SUZANNE.
I
Un soir nous nous rencontrâmes
Chez ma tante, dans un bal ;
Toute la nuit nous dansâmes…
Nous ne pensions pas à mal !
En nous livrant sans contrainte
À ce joyeux tourbillon,
Nous sentions dans notre étreinte
Nos cœurs battre à l’unisson…
Ah ! papa, lorsque l’on danse,
Tous deux la main dans la main,
C’est étonnant, quand j’y pense,
Comme l’on fait du chemin !
TOUS LES TROIS.
Ah ! papa, lorsque l’on danse.
Etc.
SUZANNE.
II
Quand vous faisiez votre sieste
Le soir, après le dîner ;
Dans le jardin, d’un pied leste,
Moi j’allais… nous promener !
Là, dans une douce ivresse,
Nous échangions tous les deux
Des serments pleins de tendresse…
Et des boucles de cheveux !
Ah ! papa ! lorsqu’on s’avance
A pas lents dans un jardin,
C’est étonnant, quand j’y pense,
Comme l’on fait du chemin !
TOUS LES TROIS.
Ah ! papa, lorsqu’on s’avance,
Etc.
COTIGNAC.
Corbleu ! ventrebleu ! maugrebleu !… Et je ne me suis aperçu de rien !…
SUZANNE, naïvement.
Ce n’est pas ma faute…
HECTOR.
Ni la mienne… Mais, maintenant que vous savez tout, je crois que le moment est venu de brusquer les choses… (Se posant.) Monsieur Cotignac, j’ai l’honneur de vous demander officiellement la main de mademoiselle votre fille.
COTIGNAC.
C’est incroyable !… Mais, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, moi…
HECTOR.
Hector de Boispréau… greffier à Saint-Quentin…
COTIGNAC, avec dédain.
Greffier !… Un simple greffier…
HECTOR.
Ça vous semble bien mesquin, je comprends cela… mais avant ce soir, j’aurai de l’avancement… La place de lieutenant de police à Douai est vacante ; c’est moi qui l’obtiendrai.
COTIGNAC.
Vous !
HECTOR.
Je suis venu à Arras pour solliciter M. le gouverneur de l’Artois.
COTIGNAC.
Ah !… Et quels sont vos titres ?
HECTOR.
Mais, mon travail… et j’ose ajouter mon mérite.
COTIGNAC, ricanant.
Ah ! ah ! si vous n’avez pas d’autres recommandations…
HECTOR.
J’espère qu’elles me suffiront.
COTIGNAC.
Jeune présomptueux, apprenez que je viens moi-même à Arras pour faire obtenir cette place à mon cousin Laroche Tromblon… qui doit épouser ma fille… Vous voyez donc bien qu’il ne vous reste aucun espoir.
HECTOR.
Bah !… J’ai confiance dans mon étoile…
SUZANNE.
Et moi aussi…
COTIGNAC, à sa fille.
Comment, tu fais des vœux contre Laroche-Tromblon ?
SUZANNE, vivement.
Ah ! ça m’est bien égal votre Laroche-Tromblon !…
COTIGNAC, sévèrement.
Ma fille !
HECTOR.
Cri du cœur !… on n’empêche pas les cris du cœur… (Avec courtoisie.) Quelle est, monsieur, votre réponse à la demande que j’ai eu l’honneur de vous faire ?…
COTIGNAC.
Ma réponse, la voici… elle est catégorique… jamais ma fille n’épousera un simple greffier… (Avec ironie.) mais si vous obtenez la place de lieutenant de police à Douai… Eh bien ! Suzanne sera à vous ! (à Biscotin) Je suis bien tranquille… Il n’a aucune chance. C’est Laroche-Tromblon qui triomphera.
BISCOTIN.
C’est évident !…
COTIGNAC.
Sur ce, permettez-nous de vous quitter. (A Biscotin.) Conduisez-nous à notre chambre…
BISCOTIN, montrant une chambre.
Par ici, monsieur le major !…
HECTOR, qui s’est rapproché de Suzanne, lui prenant les mains.
À bientôt, Suzanne !
SUZANNE.
À bientôt, Hector !
HECTOR.
L’un à l’autre toujours !
SUZANNE.
Toujours !
COTIGNAC, les séparant.
Eh bien ! mademoiselle… (Sévèrement en l’entraînant) Suivez-moi !
SUZANNE.
Oui, papa…
Elle envoie un baiser à Hector.
COTIGNAC, furieux.
Palsambleu !… Tenez, je… (A Suzanne.) Marchez devant !…
Ils entrent tous deux à gauche.
HECTOR, à Biscotin.
Et moi, où me mettez-vous ?
BISCOTIN, lui montrant la droite.
Ici, au numéro 6.
HECTOR.
Bien !… mettons en ordre mes lettres de recommandation et faisons vite un bout de toilette.
Il entre dans sa chambre.
Scène IV
BISCOTIN, puis FAVART.
BISCOTIN.
Plus personne… (Regardant autour de lui.) Je suis seul ! (Allant au fond et parlant à quelqu’un en dehors.) Jean, fermez la porte de la rue… (Descendant.) Enfin, je puis penser à mon pauvre prisonnier… Son déjeuner est en retard… (Il récupère un panier couvert d’un torchon.) Là !… (Après avoir de nouveau regardé autour de lui.) Maintenant, ouvrons la trappe… (Il appelle.) Monsieur Favart !
FAVART, dans la cave.
Voilà !
BISCOTIN.
Monsieur Favart !…
FAVART, passant la moitié du corps par la trappe.
Voilà !… Ah ! c’est vous, mon bon Biscotin !…
BISCOTIN.
Oui !… Je vous apporte votre déjeuner…
FAVART, sortant de la cave.
Laissez-moi d’abord, respirer un peu d’air pur… laissez-moi en prendre une petite provision… (Arpentant le théâtre et aspirant l’air.) Ah ! ça fait du bien !…
N°3 – COUPLETS
RÉCITATIF.
Dans une cave obscure, exilé sous la terre,
Mon âme gémissait dans la captivité,
Mais revoyant enfin le ciel et la lumière,
Je puis donner l’essor à toute ma gaîté.
COUPLETS.
I
Au diable l’humeur morose,
Je n’ai pour elle aucun goût…
Mon esprit voit tout en rose
Et je m’arrange de tout !
Quand le chagrin, à ma suite,
Veut s’élancer, je me mets
A courir si vite, vite,
Qu’il ne m’attrape jamais !
Eh ! gai ! gai ! c’est ma devise !
Je ne suis pas un savant,
Mon seul désir c’est qu’on dise :
Favart est un bon vivant !
II
Jamais je ne suis malade,
Ça donne de l’embarras,
Je fais une promenade
Entre mes quatre repas,
Bref ! plus heureux qu’un monarque,
Plus sans souci qu’un enfant,
Lorsqu’un jour viendra la barque
Je veux la suivre en chantant.
Eh ! gai ! gai ! c’est ma devise !
Je ne suis pas un savant,
Mon seul désir, c’est qu’on dise :
Favart est un bon vivant !
BISCOTIN, inquiet.
Pas si haut !… S’il entrait quelqu’un…
FAVART.
C’est vrai… Moi, Charles Favart, auteur dramatique, ex-directeur du théâtre de la foire Saint-Germain, je suis traqué comme une bête fauve… Et savez-vous pourquoi, Biscotin ?…
BISCOTIN.
Nullement… Vous êtes le fils de mon ancien patron… de celui qui m’a appris l’état de pâtissier… Vous êtes arrivé ici il y a huit jours en criant : cachez-moi !… Je vous ai caché sans vous en demander davantage…
FAVART.
Bon Biscotin… Excellente pâte… de pâtissier… Vous saurez tout…
BISCOTIN, inquiet, regardant autour de lui.
Est-ce bien la peine ?…
FAVART.
Ça me soulagera… Il y a six mois, Biscotin, j’ai épousé une jeune artiste de mon théâtre… mademoiselle Duronceray… un bouton de rose… fraîche, mignonne, jolie comme un cœur, de l’esprit à en revendre, du talent jusqu’au bout des ongles… et une vertu !… Oh ! sa vertu, voilà l’origine de tous mes malheurs…
BISCOTIN.
Je ne comprends pas…
FAVART.
Vous allez comprendre… Ici l’action s’augmente d’un troisième personnage… Le maréchal de Saxe !…
BISCOTIN, saluant.
Un grand capitaine…
FAVART.
Très-grand et très-gros… Il venait souvent à notre théâtre et en voyant jouer la Chercheuse d’esprit, une pièce très-réussie… elle est de moi… il devint absolument amoureux de ma femme…
BISCOTIN.
Ah ! bon !
FAVART.
Bon !… Je ne trouve pas… Il comptait sur son prestige guerrier, ce chef éminent… Après plusieurs assauts donnés à la vertu de mon épouse, il fut obligé de se replier en désordre après avoir éprouvé des pertes sensibles… pour son amour-propre…
BISCOTIN.
Ça a dû le vexer.
FAVART.
Énormément… Alors, il jura de se venger, et sous un motif frivole, il fit enfermer madame Favart dans le couvent des Ursulines de Cambrai.
BISCOTIN.
Ah ! ah !… Et vous ?
FAVART.
Moi… il voulut aussi me faire enfermer… pas chez les Ursulines… mais en prison… sous prétexte de quelques dettes criardes… Prévenu à temps, je parvins à m’enfuir, on me poursuivit, c’était une chasse à courre… Bref ! je ne m’arrêtai qu’ici, où vous m’avez accueilli comme un frère et fourré dans votre cave… Fin du premier acte. (le rideau commence à se fermer ; Favart s’en aperçoit et s’interpose) Non, non, pas encore ! (Le rideau se rouvre)
BISCOTIN.
Quelle affaire… mais enfin, la situation n’est pas si mauvaise… Et madame Favart est rassurée sur votre sort, grâce à ce billet que j’ai pu lui faire parvenir…
FAVART.
Oui… ce billet dans lequel je lui apprends que je suis en sûreté chez vous, digne ami… (S’animant.) Eh bien ! non, qu’il le sache, le grand capitaine… non, non !… nous ne capitulerons pas !…
BISCOTIN.
Ne criez donc pas comme ça… et rentrez, je vous en prie… rentrez…
Il montre la cave.
FAVART.
Vous croyez que c’est indispensable ?…
BISCOTIN.
Si je le crois !… Tout à l’heure, encore, j’ai vu rôder par ici des figures inquiétantes… des uniformes…
FAVART.
N’en dites pas plus… J’obéis, excellent Biscotin…
BISCOTIN, lui donnant le panier.
Emportez votre déjeuner.
FAVART.
Merci… Dérision amère ! Ma femme aux Ursulines ! moi dans cette cave ! Ah ! ce n’est pas ainsi que je comprenais la vie d’intérieur !
On entend une cloche.
BISCOTIN, vivement.
La cloche du déjeuner… Cette salle va se remplir de monde… (A Favart.) Disparaissez !…
Il referme la trappe sur lui, au moment où tous les voyageurs sortent de leurs chambres et entrent en scène.
Scène V
BISCOTIN, Voyageurs, Voyageuses, Les Servantes, puis COTIGNAC et HECTOR, puis MADAME FAVART.
N° 4 – CHŒUR ET SCENE
CHŒUR DES VOYAGEURS.
Allons, allons, vite à table,
Qu’on serve en un tour de main ;
Et qu’un repas confortable
Vienne apaiser notre faim !
Les voyageurs et les voyageuses s’asseyent aux tables. Cotignac sort de la chambre de gauche.
COTIGNAC.
Qu’on me donne une côtelette,
Avec du vin de Beaugency…
HECTOR, sortant de droite et s’asseyant à la table de Cotignac, à Biscotin.
Qu’on prépare mon omelette,
Et presto qu’on l’apporte ici…
COTIGNAC.
Pardon, cette table est la mienne…
HECTOR.
Ne peut-on pas y tenir deux ?
COTIGNAC.
Du tout, monsieur, chacun la sienne…
HECTOR, allant s’asseoir ailleurs.
C’est un beau-père très-grincheux !…
CHŒUR DES VOYAGEURS.
Allons, allons, vite à table,
Qu’on serve en un tour de main ;
Et qu’un repas confortable
Vienne apaiser notre faim !
On entend au fond les sons d’une vielle.
COTIGNAC, parlé.
Tiens ! qu’est-ce que c’est que ça ?
Madame Favart, en costume de vielleuse, parait au fond, elle entre et salue timidement.
HECTOR, la regardant, à part.
Que vois-je !
MADAME FAVART, à part, l’apercevant.
Hector !
HECTOR, bas.
Vous, ici ?…
MADAME FAVART, bas.
Pas un mot ! Je vous expliquerai.
Se plaçant au milieu du théâtre.
Je suis la petite vielleuse
Qui va courant par les chemins,
Et, toujours alerte et joyeuse,
Sème partout ses gais refrains.
Mon répertoire est immense !
Que désirez-vous, messieurs ?
Une plaintive romance,
Ou bien un refrain joyeux ?
(Se posant en chanteuse.)
Oh ! trop cruelle Sylvie,
Je t’aime plus que ma vie,
Réponds, cruelle, réponds.
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous !
LE CHŒUR.
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous !
MADAME FAVART.
Dans les gardes-françaises
J’avais un amoureux !
Fringant, et chaud comm’braise
Jeune, beau, vigoureux…
LE CHŒUR.
Dans les gardes-françaises
MADAME FAVART.
Donnez à la petite chanteuse …
LE CHŒUR.
Dans les gardes-françaises …
MADAME FAVART.
Allons, allons, un peu de coeur,
et ça vous portera bonheur.
Je suis la petite vielleuse
Qui va courant par les chemins,
Et, toujours alerte et joyeuse,
Sème partout ses gais refrains.
Elle fait la quête., ce qui fait fuir les voyageurs qui sortent. Elle arrive près de Cotignac qui fouille vivement à sa poche et en tire sa montre.
COTIGNAC.
Deux heures… Je n’ai que le temps de courir chez son Excellence.
Il disparaît. Tout le monde est sorti. Madame Favart s’approche d’Hector.
Scène VI
MADAME FAVART, HECTOR.
MADAME FAVART.
Plus personne !…
HECTOR.
Vous, Madame Favart… Justine… Vous ici !… Comment se fait-il ?
MADAME FAVART.
Ecoutez, Hector, à vous, je peux tout dire, nous avons été élevés ensemble… nous sommes presque frère et sœur.
Eh bien !… Favart est ici !…
HECTOR.
Ah bah !…
MADAME FAVART.
Oui, caché par Biscotin… J’ai su cela par un petit billet qu’il m’a fait tenir, et alors, je n’ai plus eu qu’une idée, venir rejoindre mon mari.
HECTOR.
Ce n’était pas facile…
MADAME FAVART.
Non, car j’étais au couvent des Ursulines et surveillée de très près… Mais, c’est justement là ce qui me piquait au jeu… Il ne s’agissait que de tromper les bonnes sœurs… et c’est ce que j’ai fait….
N°5 – COUPLETS.
I
Prenant mon air le plus bénin
Et des allures de novice…
Il fallait sous mon grand béguin
Me voir assister à l’Office !
Les yeux baissés, la bouche en cœur,
Tout le jour dans le monastère
J’échangeais ce dialogue austère : Oui
(Croisant ses mains sur sa poitrine.)
Ave, ma mère !
Ave, ma sœur !
II
La jardinière du couvent
Qu’un jour je parvins à séduire,
Me prête enfin ce vêtement
Qui dehors pouvait me conduire !
Hier, franchissant, non sans peur,
La porte du vieux monastère,
Grand merci, dis-je à la tourière. Oui
Ave, ma mère !
Ave, ma sœur !
HECTOR.
Très-bien…
MADAME FAVART.
Puis j’ai acheté une vielle… J’ai chanté tout le long du chemin… et me voilà…
HECTOR.
Votre histoire est très-intéressante, mais il faut que je vous quitte.
MADAME FAVART.
Pourquoi si vite ?
HECTOR.
En deux mots voici ma situation… J’adore une jeune fille, et je viens solliciter du gouverneur de l’Artois une place d’où dépend mon mariage avec elle…
MADAME FAVART.
Que je ne vous retienne pas… allez, mon cher Hector…
HECTOR.
Au revoir…
MADAME FAVART.
Au revoir… et bonne chance !…
HECTOR.
Merci !…
Il sort.
Scène VII
MADAME FAVART, puis BISCOTIN, et FAVART.
MADAME FAVART.
Pauvre garçon, il semble qu’il est bien amoureux… Voyons… tâchons de savoir où est ce brave aubergiste…
BISCOTIN, entrant et regardant vers la rue.
C’est drôle… On dirait des gens de la police… Méfions-nous…
MADAME FAVART, le regardant, à part.
Ce doit être lui…
BISCOTIN.
Tiens, la petite chanteuse !… Qu’est-ce que vous faites encore ici ?
MADAME FAVART, avec un accent campagnard.
Faites excuse… c’est-y vous qu’êtes M. Biscotin ?
BISCOTIN.
C’est moi-même…
MADAME FAVART.
Ben vrai ? Là, vrai de vrai ?…
BISCOTIN.
Puisque je vous le dis…
MADAME FAVART, de sa voix naturelle, avec effusion.
Alors, permettez-moi de vous embrasser.
Elle lui saute au cou et l’embrasse sur les deux joues.
BISCOTIN, scandalisé.
Qui est-ce qui m’a envoyé une pareille effrontée ?…
MADAME FAVART, vite et bas.
Chut ! Je suis madame Favart…
BISCOTIN, ôtant vivement son bonnet.
Madame Favart !… oh ! pardon !
MADAME FAVART, avec émotion.
Ah, M. Biscotin, comme je vous remercie de ce que vous avez fait pour Favart. Où est-il ?…
BISCOTIN.
Votre mari ?… Là… Dans ma cave…
MADAME FAVART.
Oh ! ce pauvre amour… ouvrez vite…
BISCOTIN.
Volontiers… mais c’est que je viens d’apercevoir de ce côté des soldats…
MADAME FAVART.
Eh bien, vous ferez le guet pendant que je descendrai…
BISCOTIN.
J’obéis… Attendez, il faut le préparer tout doucement… (Appelant.) Favart !….
FAVART.
Qu’est-ce qu’il y a ?…
BISCOTIN.
Votre femme est là…
FAVART, bouleversé.
Ma femme… ah ! quel coup !…
MADAME FAVART.
Ah ! mon Dieu !… Charles !…
FAVART.
Justine ! c’est bien toi… dans mes bras !… (Ils s’embrassent.) Ah ! quel sujet pathétique !… un homme encavé qui étreint son épouse habillée en fille des champs… il y a des larmes là-dedans !
MADAME FAVART.
Calme-toi !
FAVART.
Je ne peux pas… Voilà le seul moment un peu agréable que j’aie éprouvé depuis longtemps… mais comment as-tu fait pour t’échapper ?…
MADAME FAVART.
Je vais te raconter cela…
Reprise du début du n°5. La voix du sergent se fait entendre de l’extérieur.
BISCOTIN.
Attendez ! Redescendez à la cave… voilà des soldats !
MADAME FAVART.
Des soldats !…
FAVART
Je les brave !
BISCOTIN.
Voulez-vous bien disparaître !
MADAME FAVART.
Il a raison, mon ami. Disparais
FAVART, retournant à la cave.
Encore la cave !… C’est du guignon… et dire que ça bonifie le vin !…
Il disparaît.
BISCOTIN
Enfin !… Ils sont sur la piste… je m’en doutais… (A Mme Favart.) Vous, madame, du sang-froid…
MADAME FAVART.
Soyez tranquille… j’en ai…
BISCOTIN, lui donnant des vêtements pour se déguiser.
Prenez ces vêtements… Vous êtes Toinon… ma nouvelle servante…
MADAME FAVART.
Bien !… j’ai compris…
BISCOTIN, appelant.
Allons, Babet, Jeanneton, venez toutes, voici des militaires.
Scène VIII
MADAME FAVART, BISCOTIN, BABET, JEANNETON, LE SERGENT LAROSE et des Soldats.
N°6 – ENSEMBLE, RONDE ET CHŒUR
CHŒUR DES SOLDATS.
A l’auberge de Biscotin
On boit, dit-on, d’excellents vins !
Nous sommes rompus et pour cause,
Il faut ici qu’on se repose,
Reposez-nous, le verre en main,
A l’auberge de Biscotin
On boit d’excellents vins !
BISCOTIN.
On va vous servir à l’instant
Asseyez-vous…
LE SERGENT.
Oh ! oui, vraiment…
Car depuis le soleil levant
Nous recherchons un garnement…
MADAME FAVART, à Biscotin.
C’est lui !…
BISCOTIN, bas.
Sans doute !…
LE SERGENT.
Et mêmement,
Que dans votre établissement,
Nous allons délicatement
Faire quelques fouilles…
BISCOTIN.
Comment ?
LE SERGENT.
C’est la consigne…
BISCOTIN.
Bien, sergent … (A madame Favart) Que faire ?
MADAME FAVART.
Attendez !
BISCOTIN.
Parlez !
MADAME FAVART.
Attendez. (S’avançant vers les militaire)
Militaires,
Voilà le vin, tendez vos verres !
LE SERGENT, la regardant.
Tiens !… quel est ce jeune tendron ?
BISCOTIN, vivement.
Toinon, ma nouvelle servante !
MADAME FAVART, avec un gros rire.
Et voui, pardieu, c’est moi, Toinon !.
LE SERGENT.
Crédieu cet’ Toinon est charmante ! (A madame Favart)
Tu me rappelles Margoton…
Qui fut ancienn’ment mon amante
Et qui vous savait des chansons…
Mais nos recherches… Commençons…
MADAME FAVART, vivement.
Des chansons !… la belle affaire !
J’en sais d’plus fort’s que Margoton…
LE SERGENT.
Pas possible !…
MADAME FAVART.
Jarnigoton !
Je vais vous l’prouver, militaire !
Ecoutez-moi c’refrain gaillard…
Bas à Biscotin.
C’est une ronde de Favart.
TOUS.
Ecoutons-donc c’refrain gaillard.
MADAME FAVART.
C’est une ronde de Favart.
TOUS.
Chantez-nous le refrain gaillard !
MADAME FAVART.
RONDE.
I
Ma mère aux vignes m’envoyit,
Je n’sais comment ça s’fit
En parlant elle m’avait dit.
« Travaille ma fille, Vendange, grappille !… »
En chemin Colin m’abordit,
Il prit ma main et la baisit,
Je n’sais comment ça s’fit !
II
Il prit ma main et la baisit,
Je n’sais comment ça s’fit !
Puis v’là-t-y pas qu’il s’enhardit,
« Travaille ma fille, Vendange, grappille »
Mais ma vertu le repoussit,
Si rudement qu’il en tombit !
Je n’sais comment ça s’fit !
III
Mais en tombant il m’entraînit,
Je n’sais comment ça s’fit !
Ni l’un, ni l’autr’ne se blessit…
« Travaille ma fille, Vendange, grappille ! »
Cependant le coup m’étourdit
Si ben qu’malin il m’endormit…
Je n’sais comment ça s’fit…
IV
Mais, crac ! v’là qu’on me réveillit…
Je n’sais comment ça s’fit !
C’était ma mère et le bailli…
« Travaille ma fille, Vendange, grappille ! »
Colin était tout interdit…
Huit jours après il m’épousit…
Voilà comment ça s’fit !
TOUS.
Bravo ! bravo ! bonne chanson !
MADAME FAVART.
Que dites-vous de mon histoire ?
LE SERGENT.
C’est encor mieux que Margoton !
MADAME FAVART, gaîment.
Tendez vos verres… il faut boire !
TOUS.
Buvons, buvons à pleins verres,
Aimable et jeune beauté,
En braves, galants militaires
Nous buvons tous à ta santé !
MADAME FAVART, versant.
Buvez, buvez, buvez encore !
Buvez, buvez, buvez toujours !
LE SERGENT, se levant en chancelant.
Ah ! palsanguienne ! je t’adore !
MADAME FAVART.
Buvez, buvez, buvez toujours !
LE SERGENT
Verse, déesse des amours ! (Il tend son verre).
MADAME FAVART, versant.
Buvez encore !
Buvez toujours !
LES SOLDATS, buvant et chancelant
Buvons, buvons à pleins verres,
Etc.
MADAME FAVART, bas à Biscotin.
Ils sont tous gris !
LE SERGENT, d’une voix avinée.
Vive la vigne !…
Mais n’oublions pas la consigne
Et cherchons ce particulier !
MADAME FAVART.
Montez d’abord dans le grenier…
LE SERGENT.
Elle a raison dans le grenier
Cherchons notre particulier.
MADAME FAVART, bas à Biscotin.
Là-haut sur les bottes de paille
Ils vont s’endormir…
BISCOTIN.
C’est certain !
Venez tous !…
MADAME FAVART, les regardant chanceler.
Gare à la muraille !
LE SERGENT.
Ne craignez rien.
BISCOTIN, aux soldats.
Je vais vous montrer le chemin !
ENSEMBLE.
LE SERGENT et LES SOLDATS.
Buvons, buvons à pleins verres,
Etc.
BISCOTIN et LES SOLDATS.
Buvez, buvez à pleins verres,
Etc.
Les soldats chancelant et se cognant, sortent conduits par Biscotin.
Scène IX
MADAME FAVART, FAVART.
FAVART, passant la tête.
Ils sont partis ?
MADAME FAVART.
Oui… J’ai pu m’en débarrasser…
FAVART.
Alors, je sors… (Il sort de la cave.) Enfin !… nous pouvons causer de nos petites affaires… Nous voilà tranquilles…
MADAME FAVART.
Oh !… tranquilles… pas tant que ça…
FAVART.
Qu’est-ce qu’il y a encore ?…
MADAME FAVART.
Il y a que je les ai fait boire, qu’ils vont probablement s’endormir, mais qu’ils peuvent se réveiller d’un moment à l’autre.
FAVART.
Alors, que faire ?
MADAME FAVART.
Parbleu ! il faut fuir…
FAVART, noblement.
Fuir !… fuir !… dis-tu ?… (Changeant de ton.) Oui, c’est une assez bonne idée…
MADAME FAVART.
Il ne s’agit que de la mettre à exécution… pour cela il faut trouver un plan !
FAVART.
Un plan… ça me regarde… c’est un scénario à faire…
MADAME FAVART.
Cherchons !
FAVART.
Attends… Je tiens l’embryon… avant tout il faut que je me déguise…
MADAME FAVART.
Oui !
FAVART.
Il y a dans cette chambre les hardes des domestiques, je vais m’empaysanner…
MADAME FAVART
Très-bien, mais après ?… où irons-nous ?
FAVART.
Les choses simples sont les meilleures… tout droit devant nous…
MADAME FAVART.
Sans argent, sans papiers… alors, mon pauvre ami, nous n’irons pas bien loin…
FAVART.
Ah oui, j’en ai peur…
MADAME FAVART.
Tiens, laisse-moi faire… moi je trouverai quelque chose…
FAVART, l’admirant.
Ça, c’est un collaborateur… c’est moi qui cherche et c’est elle qui trouve… je vas toujours m’habiller.
Il sort.
Scène X
MADAME FAVART, puis HECTOR.
MADAME FAVART, seule.
Oui, ce moyen, il faut que je le trouve, il le faut ! (Hector entre par le fond, l’air sombre, et descend la scène sans rien dire. — Courant à lui.) Ah ! Hector !… si vous saviez !… mon pauvre Favart, je l’ai revu…
HECTOR, préoccupé.
Tant mieux, j’en suis heureux pour vous…
MADAME FAVART.
Mais, il est traqué, poursuivi, et je ne sais comment nous allons pouvoir sortir d’ici…
HECTOR, avec amertume.
Il y aurait bien eu un moyen facile…
MADAME FAVART, vivement.
Lequel ?
HECTOR.
Si j’avais obtenu cette place que je sollicite, j’aurais pu vous faire passer pour mes domestiques et vous emmener tous les deux avec moi à Douai.
MADAME FAVART.
Mais oui, c’est vrai ! Quelle belle idée !
HECTOR.
Dans ma propre voiture !….
MADAME FAVART.
La voiture du lieutenant de police !
HECTOR.
On ne serait pas venu vous chercher là.
MADAME FAVART.
Oh ! non !… Ah ! mon cher Hector… Alors, nous sommes sauvés.
HECTOR.
Oui, mais cette place, je ne l’aurai pas.
MADAME FAVART.
Qu’en savez-vous ?
HECTOR.
Je viens de l’hôtel du gouverneur… on n’a même pas voulu me recevoir.
MADAME FAVART.
Il fallait insister.
HECTOR.
C’est ce que j’ai fait… j’ai pris l’huissier à part, je lui ai glissé une pièce dans la main en le priant de s’intéresser à moi… Alors il a cligné de l’oeil et m’a dit tout bas : — Envoyez votre femme… — Mais… — Envoyez votre femme, vous dis-je, et votre affaire est dans le sac !… Voilà tout ce que j’ai pu en tirer.
MADAME FAVART.
Oh ! oh ! je crois comprendre… Le marquis est un coureur de jupons…
HECTOR.
Il paraît qu’à cet égard sa réputation est des mieux établies… il aime à se faire solliciter par les femmes de ses inférieurs… avec lui, pas d’avancement sans cela… Ah ! si j’avais eu une femme sous la main… Mais à présent, je n’ai plus qu’une chose à faire…
MADAME FAVART.
Quoi donc ?
HECTOR.
Je vais écrire à Suzanne que je ne peux pas l’épouser… parce que je ne suis pas marié.
Il sort vers sa chambre.
Scène XI
MADAME FAVART
MADAME FAVART, seule.
C’est pourtant vrai… S’il avait eu la place, mon pauvre Favart était sauvé… et moi aussi…
Mais cette place, pourquoi ne l’obtiendrait-il pas, au fait ?… Que faut-il pour cela ?… qu’il ait une femme pendant une heure… Eh bien ! il en aura une !… et cette femme, ce sera moi… je vais aller trouver ce gouverneur… (Elle va pour sortir et revient.) Oui… mais je ne peux pas me présenter à son hôtel dans ce costume… (Apercevant la pelisse et la mantille de Suzanne.) Ah ! cette pelisse, cette mantille… Je ne sais à qui elles sont… mais, ma foi tant pis !… (Elle met la mantille et la pelisse.). Maintenant, allons jouer la comédie… et tâchons de bien jouer, car c’est à notre bénéfice !… Elle sort au moment où Hector revient.
Scène XII
HECTOR, puis SUZANNE, puis FAVART.
HECTOR, une lettre à la main.
Voilà ma lettre… (Apercevant Mme Favart qui sort par le fond.) Justement, c’est elle… (Remontant.) Suzanne !… Suzanne !… Eh bien ! elle ne répond pas, elle se sauve… Suzanne !…
SUZANNE, entrant.
Qui m’appelle ?…
HECTOR, surpris.
Comment vous voilà de ce côté… lorsque je viens de vous voir partir par là… Vous êtes donc double ?…
SUZANNE.
Ah ! mon Dieu !… Est-ce que vous deviendriez fou ?…
HECTOR.
Ça ne m’étonnerait pas. (Avec émotion lui tendant une lettre.) Tenez, Suzanne, lisez cette lettre que j’avais préparée pour vous et vous comprendrez tout…
SUZANNE, prenant la lettre.
Voyons…
FAVART, revenant, il est en valet d’auberge.
Me voilà costumé… où est ma femme ?
SUZANNE, après avoir lu.
Ainsi… cette place… plus d’espoir ?…
HECTOR, revenant à elle.
Aucun espoir… aucun !…
FAVART, au fond, le regardant et le reconnaissant. À part.
Tiens !… Mais, c’est Boispréau !…
N°7 – TRIO DE L’ENLEVEMENT.
HECTOR.
Adieu, Suzanne, je vous rends
Votre promesse et vos serments ;
Quant à moi, j’ai trouvé, ma chère,
Un bon moyen pour me distraire !…
SUZANNE.
O ciel ! que prétendez-vous faire ?
HECTOR.
Un petit tour dans la rivière !
FAVART, l’arrêtant.
Halte-là ! monsieur, s’il vous plaît…
SUZANNE, étonnée.
Qu’est-ce ?…
HECTOR, à part.
Favart !…
Vivement à Suzanne.
C’est mon valet !
FAVART.
Mettre fin à son existence,
C’est simplement de la démence ;
Ne faites pas ça, car après
Vous en auriez bien des regrets !
Il est, pour dénouer la chose,
Un moyen beaucoup moins morose…
SUZANNE, vivement,
Parlez…
HECTOR, de même.
Quel est donc ce moyen ?
FAVART.
Il est très simple… écoutez bien :
De quoi s’agit-il ?
Mon esprit subtil
Devine aisément
Tout votre roman.
S’aimer et s’unir
Est votre désir ;
Mais un dur papa
N’entend pas cela !
Pour forcer la main
Du père inhumain,
C’est facile, il faut
S’enfuir au plus tôt ;
Rien de plus charmant
Qu’un enlèvement !
De suite ça fait
Un terrible effet !
Le père ombrageux
Vous poursuit tous deux ;
Et sur vous enfin,
Pose le grappin !
Tout en sanglotant,
Alors vous jetant
Aux pieds du barbon
Vous criez : Pardon !
Soudain, à ce cri,
Le tigre attendri
Pardonne et bénit ;
Puis il vous unit !
Transport général
Avec chœur final !
Et sur ce tableau
Ferme le rideau !
Le rideau commence à se fermer.
FAVART. (s’en apercevant)
Non, non toujours pas ! (le rideau se rouvre) Alors, c’est entendu ?… partez !…
SUZANNE.
Un enlèvement… non, non, je refuse.
HECTOR.
Moi aussi… je refuse.
SUZANNE, avec des larmes.
Oui… et disons-nous adieu pour jamais !
HECTOR, de même.
Pour jamais…
FAVART, ému.
Ma parole !… Ils me fendent le cœur !…
Scène XIII
Les Mêmes, LES VOYAGEURS, puis COTIGNAC, BISCOTIN, BABET et JEANNETON, puis Le Sergent et les Soldats.
N°8 – FINALE – A – ENSEMBLE / B – COUPLETS / C – STRETTE
A ENSEMBLE – CHŒUR.
Pour la lieutenance
Il y a deux concurrents
Qui s’sont mis sur les rangs ;
Nous allons, je pense,
Savoir quel est celui
Qui l’emporte aujourd’hui !
COTIGNAC.
(Entrant, très en colère)
J’enrage, j’enrage, je suis en fureur,
Je viens de chez le gouverneur,
Dans l’antichambre je demeure
A me morfondre plus d’une heure,
Pendant qu’il était — le fripon —
Tête-à-tête avec un jupon !
Alors, je crie et je proteste,
L’huissier me répond d’un ton leste :
Vous pouvez partir maintenant,
Il a nommé son lieutenant !
HECTOR.
Ainsi,l’affaire est terminée.
SUZANNE.
Et la place est donnée.
LE CHŒUR.
Dites-nous vite à qui.
COTIGNAC.
Eh mordieu ! je l’ignore !
Je n’en sais rien encore !
Scène XIV
Les Mêmes, MADAME FAVART habillée en Toinon
MADAME FAVART, entrant une lettre à la main, parlé.
Monsieur de Boispréau…
HECTOR, parlé.
Qu’y a-t-il ?
MADAME FAVART, à Hector.
Je viens vous dir’, monseigneur,
Qu’un gard’ du gouverneur
M’a donné cette grand’lettre
En m’priant d’vous la remettre…
HECTOR, parlé.
Une lettre… Voyons… (Il prend la lettre.) Lisons : « Mon cher monsieur de Boispréau, vu les talents hors ligne dont vous n’avez cessé de faire preuve… Vu les immenses services que vous avez rendus à l’Etat… Et vu, surtout, la haute et puissante recommandation d’une personne influente… Vous êtes nommé, par les présentes, au poste de lieutenant de police à Douai ! »
HECTOR.
Je suis nommé ! quel bonheur !
SUZANNE.
Il est nommé ! quel bonheur !
COTIGNAC.
Il est nommé ! quel bonheur !
LES AUTRES.
Il est nommé ! quel honneur !
HECTOR, bas à madame Favart.
Mais comment se fait-il ?
MADAME FAVART, bas.
Quelque femme, je pense,
Aura parlé pour vous…
HECTOR, bas.
Vous, peut-être ?
MADAME FAVART, bas.
Silence !
HECTOR, courant à Suzanne.
Enfin, nous allons être unis…
COTIGNAC.
Permettez…
HECTOR.
N’est-ce pas le prix
Que vous-même m’avez promis ?
SUZANNE.
C’est vrai, papa, tu l’as promis !
TOUS.
Mais oui, mais oui, il l’a promis !
B – COUPLETS – SUZANNE
I
Mon p’tit papa, je t’en supplie
A deux genoux,
Il faut que vite on nous marie,
Ecoute-nous !
Cette fois sera la première,
Après j’attendrai mon p’tit père…
Voyons, voyons, sois bien mignon,
Ne dis pas non !
Pour ta fille, il faut être bon !
Ne dis pas non !
Sois bien mignon,
Ne dis pas non !
II
Allons, papa, laisse-toi faire,
Un bon mouv’ment.
Ce mariag’là, c’est l’affaire
D’un p’tit moment ;
Tu m’as dit bien souvent : j’espère
Qu’un beau jour je serai grand-père !…
Voyons, voyons, sois bien mignon,,
Ne dis pas non !
Pour ta fille, il faut être bon !
Ne dis pas non !
Sois bien mignon,
Ne dis pas non !
C – STRETTE – COTIGNAC, furieux.
Va donc !… Va pour le mariage !
Mais corbleu ! saprebleu ! j’enrage !
À ce moment, les soldats et le sergent reviennent.
FAVART, effrayé.
Les soldats ! Je suis pris…
HECTOR, bas.
Non ! non !
Je me souviens de ma promesse…
À Favart et à madame Favart.
Dépêchons-nous, car le temps presse…
Allons, Benoît, allons, Toinon…
FAVART et MADAME FAVART.
Nous sommes à votre service,
Monsieur le lieutenant de police.
LE SERGENT, parlé.
Le lieutenant de police !
FAVART, à Hector.
Et votre carrosse est tout prêt.
HECTOR, à Suzanne, lui montrant Favart et madame Favart.
Avec ma bonne et mon valet,
Mettons-nous bien vite en voyage,
A Douai, nous ferons notre mariage !
TOUS.
Oui ils feront leur mariage !
Vite en voyage !
MADAME FAVART, très-gaîment.
Allons soudain
Mettons-nous en voyage !
Car de l’hymen
Un voyage est l’image !
On part gaîment,
Mais un orage
Survient grondant,
Gar’le ménage !
LE CHŒUR.
Fouette, fouette, fouette, cocher !,
Que la voiture vole
Dans une course folle,
Clic, clac !
MADAME FAVART.
Mais un cahot
L’un vers l’autre vous jette,
L’amour bientôt
Apaise la tempête !
SUZANNE et HECTOR.
Le ciel est pur,
Plus un nuage,
Et dans l’azur
Fin du voyage !
FAVART, MADAME FAVART, HECTOR et SUZANNE.
On s’enlace
Doucement,
On s’embrasse
Tendrement ;
Tout s’achève
Dans l’ardeur
D’un doux rêve
De bonheur !
TOUS.
Allons soudain
Mettons-nous en voyage !
Car de l’hymen
Un voyage est l’image !
Allons soudain
Mettons-nous en voyage !
Clic, clac !
Fouette, cocher !
Que la voiture vole
Dans une course folle !
Clic, clac !
Fouette, cocher !
Que la voiture vole
Dans une course folle !
Clic, clac !
Le rideau se ferme.
Acte deuxième
CHEZ HECTOR DE BOISPRÉAU
Scène PREMIÈRE
HECTOR, MADAME FAVART, en soubrette, Un Tapissier, Un Agent de Police.
Au lever du rideau, Hector est assis à la petite table et feuillette des papiers. — Un agent de police et un tapissier sont debout devant lui, le chapeau à la main. — Madame Favart, à droite, époussette les meubles.
HECTOR, au tapissier.
Eh bien ! monsieur le tapissier, où en sont vos hommes ?
LE TAPISSIER.
Ils achèvent le grand salon.
HECTOR.
Dépêchez-vous… n’oubliez pas que je donne ce soir une grande fête et que vous avez encore cette pièce à décorer.
Le tapissier salue et sort.
HECTOR.
Quant à vous, monsieur l’exempt, j’ai lu vos rapports, ils sont en règle et vous pouvez vous retirer.
L’EXEMPT.
Pas d’ordres particuliers ?
HECTOR.
Aucun… Reprenez votre service et venez m’informer ce soir de ce que vous aurez vu… allez !
L’agent s’incline et sort.
MADAME FAVART, s’approchant.
Bravo ! La parole brève !… le geste plein d’autorité !… Vous étiez né pour commander…
HECTOR, se levant.
N’est-ce pas ?… Eh bien, et vous, Justine, savez-vous que je vous admire… On dirait que vous avez été soubrette toute votre vie… Seulement, ce qui me désole, c’est de vous voir forcée de continuer le personnage…
MADAME FAVART.
Il faut bien s’y résigner… jusqu’au moment où Favart et moi nous trouverons une occasion sûre de passer en Belgique…
HECTOR.
J’espère que cela ne tardera pas… du reste, il n’y a encore que huit jours que nous sommes arrivés à Douai et que je suis installé dans mes fonctions de lieutenant de police…
MADAME FAVART.
Et dans celles infiniment plus agréables… de nouveau marié !
HECTOR, gaîment.
C’est vrai ! Je suis marié.
N°9 – COUPLETS.
HECTOR.
I
Suzanne est aujourd’hui ma femme,
Et, jugez si c’est merveilleux,
Elle est ma femme et je proclame
Que je ne pouvais trouver mieux
Pour moi c’est le ciel sur la terre,
C’est plus que mon cœur n’espéra ;
Et c’est à vous seule, ma chère,
Que je dois tout ce bonheur-là.
II
J’aime une nombreuse famille,
Or donc, avant trois ou quatre ans,
Je veux qu’autour de moi fourmille
Une troupe de garnements.
Enfin bientôt j’aurai, j’espère,
Tous les ennuis d’être papa ;
Et c’est encore à vous, ma chère,
Que je devrai ce bonheur-là.
MADAME FAVART, légèrement.
Bah !… j’ai eu bien peu de mérite, allez !… Si vous saviez comme ce pauvre marquis a été facile à embobiner…
HECTOR.
On le dit pourtant très-dangereux…
MADAME FAVART.
Lui !… Allons donc ! C’est une réputation usurpée… J’en suis venue à bout avec quelques sourires et quelques œillades…
HECTOR.
N’importe ! Vous présenter comme ma femme, c’était hardi, et s’il apprenait jamais qu’on s’est moqué de lui à ce point-là, vous savez qu’il me ferait jeter en prison…
MADAME FAVART.
Bah !… Que pouvez-vous craindre ?… Le marquis ne quitte jamais Arras, et il n’y a que vous et moi qui connaissions cette histoire. Votre femme n’en sait rien, ni Favart non plus…
HECTOR.
Heureusement ; car maintenant qu’il fait ici office de cuisinier, il serait capable d’en manquer toutes ses sauces…
MADAME FAVART.
Et ce serait dommage… car il les réussit à merveille… et ma foi, je trouve qu’il est superbe sous le tablier blanc et la toque de l’emploi…
HECTOR.
Superbe, c’est le mot…
MADAME FAVART.
Je ne peux pas le regarder sans rire… (Montrant Favart qui a paru au fond, en cuisinier.) Tenez, voyez-moi un peu cette tête !
Scène II
Les Mêmes, FAVART, en cuisinier.
FAVART.
Elle est bonne, n’est-ce pas, la tête ?… (Entrant et prenant l’attitude d’un domestique qui attend des ordres.) Je viens prendre les ordres de monsieur. Qu’est-ce que monsieur commandera ce matin pour son déjeuner ?… (Changeant de ton, familièrement.) Bonjour, Hector, ça va bien ?
HECTOR.
Pas mal, et vous, cher ami ?
FAVART.
Moi, ça je suis aux fourneaux!… je suis en train de vous préparer le grand souper de ce soir, ça m’amuse beaucoup !
HECTOR.
Tant mieux !…
FAVART.
Que voulez-vous, la gaîté et moi nous sommes inséparables !… et puis, je suis si tranquille ici…
MADAME FAVART.
Oui… Eh bien ! moi je ne le suis pas tant que toi…
FAVART.
Bah depuis quand ?…
MADAME FAVART.
Depuis avant-hier… (A Hector.) Depuis la visite de votre tante, la vieille comtesse de Montgriffon…
HECTOR.
Pourquoi ?… Que craignez-vous d’elle ?…
MADAME FAVART.
Je ne sais… mais lorsque je lui ai servi un verre de malaga et un biscuit, elle m’a regardée d’un air singulier, à travers ses lunettes… elle vous a dit : « Mon neveu, quelle est donc cette petite ?… » Vous avez répondu : c’est Toinon ma servante… « Ah ! ah ! c’est Toinon, votre servante, ah ! ah !… » et elle a de nouveau braqué sur moi ses lunettes avec une ténacité, une persistance… J’ai peur qu’elle ne m’ait vue jouer à Paris et qu’elle ne m’ait reconnue…
FAVART.
Diable, ce serait grave…
HECTOR.
Oui, car elle n’est pas bonne, la chère tante, — mais je suis convaincu que vous vous alarmez à tort, et la preuve, c’est qu’elle est partie sans faire la moindre observation et j’ai même remarqué qu’elle avait été charmante pour Suzanne… Tiens, mais à propos, où est-elle donc, Suzanne ?…
FAVART.
Elle vient de sortir, elle est allée faire les dernières commandes pour la fête de ce soir…
HECTOR.
La fête de mon installation. J’ai invité tous les notable de la ville… Je crois que ce sera superbe et que… (Grand bruit au dehors.) Hein ? Quel est ce bruit ?
MADAME FAVART.
Quelque rixe, sans doute… quelque malfaiteur qu’on vous amène… (A Favart.) Va donc voir, Charles…
FAVART.
Tout de suite…
Il sort. — Nouveau bruit au dehors.
HECTOR.
Mais non, écoutez… ce sont des cris de joie, des vivats…
MADAME FAVART.
En effet… (Inquiète.) Qu’est-ce que cela signifie ?
FAVART, revenant vivement.
Grande nouvelle ! grande nouvelle ! quel honneur pour vous, mon cher Hector… C’est le marquis de Pontsablé, c’est le gouverneur de l’Artois qui vient vous voir. (Criant au fond.) Par ici, par ici, monseigneur !… (A Hector.) Moi je cours endosser ma livrée…
Il disparaît.
HECTOR, épouvanté.
Le marquis !… Le marquis chez moi !…
MADAME FAVART, poussant un cri étouffé.
Ah ! mon Dieu !
HECTOR, à madame Favart.
Et vous qui me disiez qu’il ne quittait jamais Arras…
MADAME FAVART, attérée.
Le sort s’acharne !
HECTOR.
Il va me demander à voir ma femme…
MADAME FAVART.
C’est évident…
HECTOR.
Le voici… (A madame Favart.) Je suis perdu !…
MADAME FAVART reprenant confiance.
Peut-être. Ou peut-être pas !…
Elle sort vivement, récupérant une robe de Suzanne.
Scène III
HECTOR, LE MARQUIS DE PONTSABLÉ, Officiers de sa suite, Paysans et Paysannes, au fond.
N°11 – CHŒUR ET COUPLET DES AIEUX.
CHŒUR.
Honneur, honneur
A mon seigneur
Le gouverneur !
Honneur, honneur
A monseigneur !
PONTSABLÉ.
Cet accueil très flatteur dont je suis enchanté
N’est après tout que mérité,
Dernier des Pontsablé, je suis la noble trace des chefs
Des chefs de mon illustre race.
I
Mes aïeux, hommes de guerre,
Dans le fond gens excellents,
Mais sujets à la colère,
N’étaient pas très-endurants !
Pour un rien, une vétille,
Ils rageaient à qui mieux mieux…
Enfoncer une bastille
Ce n’était qu’un jeu pour eux !
Par respect pour ma famille,
Je fais comme mes aïeux !
LE CHŒUR.
Par respect pour sa famille,
Il fait comme ses aïeux !
PONTSABLÉ.
II
Mes aïeux auprès des femmes
Étaient très entreprenants,
Et beaucoup de nobles dames,
Les eurent pour leurs galants.
Leur longue histoire fourmille
Des exploits les plus fameux.
Nobles dames ou jeunes filles,
Rien n’était sacré pour eux !
Par respect pour ma famille,
Je fais comme mes aïeux !
LE CHŒUR.
Par respect pour sa famille,
Il fait comme ses aïeux !
PONTSABLÉ, à la foule.
Maintenant, vous m’avez bien vu,
Je vous ai montré ma personne,
De vos cris je suis rebattu.
Eloignez-vous, je vous l’ordonne.
Par respect pour ma famille,
Je fais comme mes aïeux !
LE CHŒUR.
Par respect pour sa famille,
Il fait comme ses aïeux !
Tout le monde se retire.
Scène IV
HECTOR, PONTSABLÉ.
PONTSABLÉ, à Hector.
Enfin ! nous pouvons causer… Ce n’est pas moi que vous attendiez, avouez-le…
HECTOR, troublé.
En effet… j’étais loin de supposer que vous me feriez l’honneur…
PONTSABLÉ.
Une affaire importante qui m’appelle à Douai… Vous comprenez que je n’ai pas voulu descendre chez un autre que chez vous !…
HECTOR.
Vous êtes vraiment trop bon… trop bon…
PONTSABLÉ.
Ainsi, vous voilà tout à fait installé ?
HECTOR.
Tout à fait… et je remercie monsieur le marquis de la faveur qu’il m’a faite en me nommant.
PONTSABLÉ.
Ne parlons pas de ça… Votre mérite… vos talents : vos hautes capacités vous désignaient à mon choix…
HECTOR.
Je suis confus…
PONTSABLÉ.
Avec moi, jamais de passe-droit… je ne me laisse pas influencer… (Changeant de ton.) Et votre femme, comment va-t-elle ?
HECTOR.
Ma femme ?… (A part.) Nous y voilà !… (Haut.) Elle bien, monseigneur, elle va très-bien…
PONTSABLÉ.
J’en suis ravi… et j’ai hâte de lui présenter mes hommages…
HECTOR, balbutiant.
Oui… vous voulez lui présenter ?…
PONTSABLÉ.
Mes hommages… naturellement…
HECTOR.
Naturellement… mais c’est que c’est impossible.
PONTSABLÉ.
Comment ! impossible ?…
HECTOR.
Elle est sortie…
PONTSABLÉ.
Je l’attendrai…
HECTOR.
Elle ne rentrera que dans trois jours !…
PONTSABLÉ.
Dans trois jours !…
HECTOR.
Elle est allée voir une pauvre malade, une de ses amies de pension qui a soixante-dix-sept ans… (Il se reprend.) Non… je veux dire… dont la mère a soixante-dix-sept ans !… Alors, vous comprenez…
PONTSABLÉ.
C’est fâcheux !…
HECTOR.
Ah ! oui !…
PONTSABLÉ.
Et je suis désolé…
HECTOR.
Moi aussi…
PONTSABLÉ.
Est-ce qu’il n’y a pas moyen de la faire prévenir ?…
HECTOR.
Oh ! pas moyen… vous comprenez… une malade… quatre-vingt-dix-sept ans !
PONTSABLÉ.
Soixante-dix sept !
HECTOR.
Oui… oh, euh… quatre-vingt sept ?
Scène V
Les Mêmes, FAVART, en grande livrée.
FAVART, entrant.
Monsieur !…
HECTOR.
Qu’est-ce que c’est ?…
FAVART.
Je viens prévenir monsieur que madame est rentrée…
HECTOR, à part.
Bon sang, l’animal !…
PONTSABLÉ.
Bon… très-bien… C’est que la vieille dame va mieux…
HECTOR.
C’est impossible… Il ne sait pas ce qu’il dit… tu te trompes… (Il fait des signes à Favart.) Ma femme n’est pas rentrée.
FAVART, sans le voir.
Mais, si, monsieur, puisque je viens de lui parler…
HECTOR, désolé. — À part.
Il ne comprend rien…
PONTSABLÉ, à Hector.
C’est drôle… vous paraissez tout troublé…
HECTOR.
Moi… du tout… au contraire… (Vivement.) Monseigneur désirerait-il prendre un verre de liqueur et un biscuit ?
FAVART.
Du biscuit de Savoie… nous en avons de délicieux.
PONTSABLÉ.
Volontiers, mais plus tard. (A Hector, montrant Favart.) Quel est ce garçon ?…
HECTOR.
C’est… Benoît… un de mes domestiques.
PONTSABLÉ, examinant Favart.
Il a l’air fort intelligent, ce Benoît…
HECTOR, grommelant.
Oui, très-intelligent… (A Favart.) Va-t’en !
FAVART.
Oui, monsieur… Ah ! j’oubliais…
HECTOR.
Quoi encore ?…
FAVART.
Madame fait demander à monsieur à quelle heure il faut allumer dans les salons pour la fête de ce soir…
PONTSABLÉ, étonné.
Une fête… Comment, vous donnez une fête ?…
HECTOR, à part.
Bon sang, le maladroit…
Il fait des signes à Favart.
FAVART, étonné, répétant les gestes d’Hector.
Qu’est-ce qu’il a donc à faire comme ça ?…
HECTOR.
Oh ! une fête… c’est-à-dire…
FAVART.
Une fête superbe… pour célébrer l’installation de monsieur…
HECTOR, à part.
Il est enragé !… (Haut.) Quelques personnes…
FAVART.
Monsieur a invité toute la ville… les salons seront combles…
HECTOR, à part.
Il ne se taira pas !…
PONTSABLÉ, à Hector.
Et vous ne me soufflez pas un mot de tout cela ?…
HECTOR.
L’émotion… le plaisir de vous voir… et puis je sais que les nombreuses affaires de monsieur le marquis ne nous permettent pas d’espérer l’honneur de sa présence…
PONTSABLÉ.
Pourquoi donc ?… Au contraire… je me ferai un véritable plaisir d’assister à cette fête.
HECTOR, à part t.
Ah ! bon ! me voilà bien !… (A Pontsablé) Quelle heureuse nouvelle ! (A Favart avec colère.) Va-t’en !
FAVART.
Mais, monsieur, permettez…
HECTOR, à part.
Il va encore dire quelque sottise… (Haut.) Veux-tu t’en aller, crétin, idiot !…
FAVART.
Oui, monsieur… (A part.) Si j’y comprends quelque chose…
PONTSABLÉ.
Comme vous le secouez, ce pauvre garçon… (A Favart.) Mon ami !… (A Hector.) Voulez-vous me permettre de lui donner un ordre ?…
HECTOR, avec abattement.
Tout ce que vous voudrez, marquis, vous êtes chez vous !… (A part.) Je n’en puis plus !
PONTSABLÉ, à Favart.
Mon ami, va dire à ta maîtresse que le marquis de Pontsablé désire lui présenter ses hommages…
FAVART.
Oui, monseigneur, j’y cours… (Voyant Hector qui lui fait de nouveau des gestes.) Mais qu’est-ce qu’il a donc ? il est malade…
Il sort.
HECTOR, à part.
Allons ! c’est fini, impossible de lutter davantage… autant tout lui dire… (Haut.) Monseigneur, un mot… ma femme… que vous avez vue à Arras… ne peut paraître devant vous…
MADAME FAVART, paraissant déguisée en Suzanne.
Allons vite… des fleurs partout… Remplissez les jardinières…
PONTSABLÉ.
Eh ! mais… la voilà… c’est elle…
HECTOR, à part.
Justine !…
Scène VI
MADAME FAVART, PONTSABLÉ, HECTOR puis SUZANNE.
PONTSABLÉ, allant au-devant d’elle.
Venez, venez donc, belle dame…
MADAME FAVART, jouant la surprise.
Monsieur de Pontsablé !… Quelle aimable surprise !…
HECTOR, bas et vivement.
Vous me sauvez encore ! merci !
PONTSABLÉ, à madame Favart.
Que je suis donc ravi de vous revoir… Alors, cette vieille dame va mieux ?…
MADAME FAVART, étonnée.
Quelle vieille dame ?… (Hector lui fait des signes.) Oui… oui… beaucoup mieux… je vous remercie… (Changeant la conversation.) Est-ce que nous aurons le bonheur de vous posséder longtemps à Douai ?
PONTSABLÉ.
Mon Dieu… je ne sais pas encore au juste… (A part.) Lançons mon hameçon et examinons bien mon lieutenant de police… (Haut. — Regardant Hector en face et accentuant bien chaque mot.) Cela dépendra de madame Favart.
HECTOR, vivement.
De madame Favart ?…
MADAME FAVART, à part.
Hein ?
PONTSABLÉ, examinant toujours Hector, à part.
Il a tressailli… mes renseignements étaient exacts… (Haut.) Oui, je ne suis ici que pour elle… elle s’est enfuie de son couvent et il faut absolument que je la retrouve… Ordre du maréchal de Saxe…
MADAME FAVART, s’oubliant.
Ah !… du maréchal !… (Se reprenant aussitôt.) Ah ! du maréchal !
PONTSABLÉ.
Oui ! (A Hector.) Vous m’aiderez, Boispréau.
HECTOR, balbutiant.
Certainement… c’est mon devoir…
PONTSABLÉ.
On m’a signalé sa présence dans cette ville, avez-vous quelque indice ?…
HECTOR.
Aucun…
MADAME FAVART.
Aucun !…
PONTSABLÉ.
Aucun, c’est singulier…
HECTOR.
Je ne l’ai même jamais vue…
PONTSABLÉ.
Ah ! vous ne l’avez jamais… moi non plus, du reste.
MADAME FAVART, à part.
Heureusement…
PONTSABLÉ.
Et c’est bien là ce qui me gêne… (A madame Favart.) Car on la dit très-rusée cette comédienne !…
MADAME FAVART.
Eh ! ne le sont-elles pas toutes !… Ah ! ces actrices… Ah ! pouah !… quel métier !… Tenez, marquis, ne me parlez pas de ce monde des coulisses… il me porte sur les nerfs…
PONTSABLÉ.
Je le crois… quand on a votre distinction, votre noblesse… Oh ! du premier coup d’œil on voit la différence qui existe entre ces femmes de théâtre et une femme du monde… comme vous, madame.
MADAME FAVART.
Vous êtes physionomiste…
PONTSABLÉ.
On le dit ! (Il lui baise la main. — À part.) Elle est idéale ! (A Hector.) Mais revenons à cette comédienne. Je vais vous signer un ordre d’arrestation.
HECTOR, montrant la table.
Tenez, monseigneur, là… (Pontsablé s’asseoit. — Suzanne parait au fond de la scène) Oh ! ma femme !
Pontsablé écrit.
SUZANNE, entrant vivement et courant à Hector.
Me voici…
HECTOR, bas et vivement.
Tais-toi !
MADAME FAVART, à part.
Elle va tout gâter.
HECTOR, poussant Suzanne hors de la vue de Pontsablé
Et disparais… ou je suis perdu !…
Cachant Suzanne, stupéfaite.
PONTSABLÉ, levant la tête.
Qu’est-ce donc ?
HECTOR, très-troublé.
Rien, monseigneur… rien… je disais… Quel beau temps… quel superbe temps pour les asperges…
FAVART, entrant.
Oh, des asperges, alors je viens… (Il se trouve en face de madame Favart.) Hein !… ma femme en grande dame !
MADAME FAVART, le poussant hors de la vue de Pontsablé
Tais-toi…
HECTOR, à part.
À l’autre maintenant.
MADAME FAVART.
Pas un mot et disparais…
Le cachant.
PONTSABLÉ, levant la tête.
Qu’y a-t-il ?
MADAME FAVART.
Rien, monseigneur, rien… je disais… Quel beau temps… quel superbe temps pour les petits pois…
PONTSABLÉ, se levant.
Les oreilles me cornent donc… (Donnant un papier à Hector.) Voici l’ordre.
HECTOR, le prenant.
Bien, monseigneur… (A part) Quelle situation !…
PONTSABLÉ.
Mais cela, bien entendu, n’empêche pas la fête de ce soir… et je vais vous demander une grâce… mon cher ami…
HECTOR.
Laquelle, monseigneur ?… (A part.) Il m’effraie…
PONTSABLÉ, montrant madame Favart.
Celle de présenter votre charmante femme à toute la noblesse de la ville…
SUZANNE, à part.
Sa femme !…
FAVART, même jeu.
Sa femme !…
HECTOR, à part.
Ah ! bon… il ne manquerait plus que ça.
PONTSABLÉ.
Vous me permettrez seulement d’aller donner quelques soins à ma toilette…
HECTOR.
Certainement… ! (Appelant.) Jean ! Conduisez monseigneur à sa chambre… la chambre des antiquités…
PONTSABLÉ, se redressant.
Comment ! des antiquités !
MADAME FAVART.
C’est la plus belle… Allez, cher marquis, et revenez-nous bien vite…
PONTSABLÉ.
Le plus tôt possible… (A Hector en sortant.) Boispréau, votre femme est un ange… (Au fond.) Elle est idéale…
Il sort.
Scène VII
MADAME FAVART, HECTOR, FAVART, SUZANNE.
N°12 – QUATUOR.
SUZANNE.
Ah ! c’est affreux !
FAVART.
Ah ! c’est infâme !
SUZANNE.
On nous trompait !
FAVART.
Indignement !
SUZANNE.
Parlez, monsieur !…
FAVART.
Parlez, madame ?…
SUZANNE.
Expliquez-vous !…
FAVART.
Et vivement !
MADAME FAVART, à Charles
Deux mots vont suffire
Pour calmer tes sens.
HECTOR, à Suzanne.
Je vais tout te dire,
Écoute et comprends…
Pour que monsieur ton père
Consente à nous unir.
MADAME FAVART.
De ton réduit sous terre
Pour que tu puisses fuir.
HECTOR.
Qu’était-il nécessaire
Avant tout d’obtenir…
MADAME FAVART.
La place. Mais que faire ?
Et comment réussir ?
Il fallait…
HECTOR.
Qu’une dame…
MADAME FAVART.
Allât
HECTOR.
Chez le marquis,
MADAME FAVART.
Sous le nom…
HECTOR.
De ma femme…
MADAME FAVART.
J’y courus…
SUZANNE.
Bon, j’y suis !…
MADAME FAVART.
J’obtins tout.
FAVART.
Saprelotte !…
MADAME FAVART.
Or, il faut…
HECTOR.
Devant lui…
MADAME FAVART.
Qu’ici rien…
HECTOR,
Ne dénote…
MADAME FAVART.
Notre fraude…
HECTOR.
Aujourd’hui…
MADAME FAVART.
Car le vieux…
HECTOR.
Mascarille…
MADAME FAVART.
Par malheur…
HECTOR.
S’il l’apprend…
MADAME FAVART.
Pour Hector…
HECTOR.
La Bastille !
MADAME FAVART.
Et pour moi…
HECTOR.
Le couvent !
MADAME FAVART.
La Bastille !
FAVART.
Le couvent !
ENSEMBLE.
La Bastille et le couvent !
Plus souvent !
HECTOR, à Suzanne.
Il faut, tu vois bien,
C’est le seul moyen,
Quelque part en ville
Chercher un asile…
SUZANNE.
Quoi ! sans nul souci
Te laisser ici
Le charmant programme
Seul avec madame !
MADAME FAVART.
Oh ! quant à cela…
FAVART.
Ne suis-je pas là ?
HECTOR, à Suzanne.
Pars, ma chère amie,
Pars, je t’en supplie…
SUZANNE, parlé.
Partir… Partir !…
COUPLETS SUZANNE.
I
Après quelques jours seulement
De ménage,
A m’en aller complaisamment
On m’engage,
Afin qu’une autre, me chassant,
Quelle audace !
Près de mon mari sur-le-champ
Me remplace.
Non, non ! Halte-là !
Si cela vous va,
Moi ça ne peut pas faire
Mon affaire !…
Je n’me suis pas marié’pour ça !…
II
De l’amour m’en tenant ici
Au prélude,
Quand déjà j’ai pris d’un mari
L’habitude ;
Il faudrait, hélas ! que bien loin
Pour vous plaire,
Je reste dans un petit coin
Solitaire !…
Non ! non ! halte-là !…
Etc.
FAVART, HECTOR et MADAME FAVART.
Eh bien ! que la Bastille s’ouvre !
SUZANNE, vivement.
Non ! non ! je vais partir…
FAVART, HECTOR et MADAME FAVART.
Merci !
SUZANNE, à part.
Si toutefois, je ne découvre
Le moyen de rester ici !…
ENSEMBLE
SUZANNE.
Avec prudence
Fuyons bien loin,
De mon absence
On a besoin !
Pour qu’il évite
Un sort fâcheux,
Il faut bien vite
Quitter ces lieux !
FAVART et MADAME FAVART
Avec prudence
Fuyez bien loin,
De votre absence
On a besoin !
Pour qu’il évite
Un sort fâcheux,
Il faut bien vite
Quitter ces lieux
HECTOR.
Avec prudence
Fuis et bien loin,
De ton absence
On a besoin !
Pour que j’évite
Un sort fâcheux,
Il faut bien vite
Quitter ces lieux !
Suzanne sort avec Hector.
Scène VIII
FAVART, MADAME FAVART.
FAVART, prenant la main de sa femme et la faisant descendre.
Pardon, madame Favart, un mot s’il vous plaît !…
MADAME FAVART, étonnée.
Qu’est-ce que tu as ?
FAVART.
De quoi avez-vous causé l’autre jour avec le gouverneur ?
MADAME FAVART, moqueuse.
Des soupçons… Oh ! Charles !
FAVART, accentuant.
De quoi avez-vous causé ?… De quoi ?
MADAME FAVART.
Quels regards !… (Riant.) Ah ! ah ! ah ! ah ! (Apercevant Pontsablé qui paraît au fond.) Tiens, le voici, le gouverneur !… Tu peux le questionner toi-même… (Riant.) Ah ! ah ! ah !
FAVART.
Mais oui, je vais le questionner !
Scène IX
Les Mêmes, PONTSABLÉ.
PONTSABLÉ, en grande toilette, à part.
Elle est encore là… Je suis assez coquet, il me semble… Je peux me lancer…(S’avançant vers madame Favart.) Eh ! mon Dieu ! belle dame, vous me paraissez d’une gaîté…
MADAME FAVART, toujours riant, montrant Favart.
C’est cet imbécile de Benoît… qui ne dit et ne fait que des sottises… (semblant légère, mais avertissant Favart) s’il continue, nous ne pourrons pas le garder.
FAVART, à part.
Bon ! elle se moque de moi par-dessus le marché !
PONTSABLÉ.
Vraiment ?… Eh bien ! moi, il ne me déplaît pas ce garçon… et je le prends à mon service…
FAVART.
Vous, monseigneur ?
PONTSABLÉ.
Oui… et tu vas me servir immédiatement…
FAVART, étonné.
Comment ça ?
PONTSABLÉ.
Tu vas voir… (Revenant à madame Favart.) Mais d’abord à nous deux… L’autre jour, traîtresse, vous vous êtes bien moquée de moi… à Arras…
MADAME FAVART, bas à Favart.
Tu vois, jaloux !
FAVART, bas et vivement.
Pardonne-moi… je ne le ferai plus…
MADAME FAVART, à Pontsablé.
Me moquer de vous !… Ah ! marquis, pouvez-vous supposer ?… Le respect que je vous dois…
PONTSABLÉ.
Laissons le respect de côté… et puisque le hasard me procure en ce moment un charmant tête-à-tête, je veux en profiter…
MADAME FAVART.
Nous ne sommes pas seuls.
PONTSABLÉ.
Oh ! un domestique…
MADAME FAVART.
Oui, mais si on entrait !…
PONTSABLÉ.
C’est ici (Montrant Favart.) que notre compère va m’être utile. Tu vas te placer là… au fond… en sentinelle… et si tu vois venir le mari…
FAVART.
Le mari ?… Ah ! oui, oui… le mari !…
PONTSABLÉ.
Tu me préviendras… (cherchant des yeux et apercevant sur la table une sonnette qu’il lui donne.) en agitant cette sonnette. (A madame Favart.) Vous voyez qu’il n’y a aucun danger…
MADAME FAVART, souriant.
En effet !…
FAVART.
Oui, monseigneur… (Au fond.) Eh bien, voilà un joli rôle qu’on me donne à jouer !
Scène X
PONTSABLÉ, MADAME FAVART, FAVART au fond, puis Marmitons, puis Tapissiers.
PONTSABLÉ, revenant, à madame Favart, avec chaleur.
La place est à moi !… entamons vigoureusement.
Enfin, madame, je puis donc vous dire que vous êtes adorable et que je vous aime à la folie.
FAVART, au fond, à part.
Oh ! oh ! comme il s’enflamme… Je vais lui servir un petit plat de ma façon !
PONTSABLÉ, à madame Favart.
Oui, vous êtes une déesse, digne d’une position plus élevée… ce qu’il vous faut, c’est un adorateur qui puisse satisfaire vos moindres caprices… Eh, bien ! dites un mot et je mets ma fortune à vos pieds.
N°13 – ENSEMBLE DE LA SONNETTE
MADAME FAVART.
Marquis, grâce à votre richesse,
Vous offrez et même au delà
A qui sera votre maîtresse,
Chevaux, voiture et cætera !
Mon mari ne pourrait, je pense,
Me donner rien de tout cela ;
Entre vous, quelle différence…
PONTSABLÉ.
Elle est immense !
MADAME FAVART.
Vous, vous me promettez beaucoup,
Au risque d’être téméraire,
Lui ne me promet rien du tout,
Mais me donne le nécessaire,
Le nécessaire !
PONTSABLÉ.
Le nécessaire !
La belle affaire !
J’offre mieux entre nous
Car je t’aime, je t’aime.
Tu me vois ici-même
Tomber à tes genoux !
Il se jette à ses pieds. — Favart sonne.
Les marmitons entrent vivement
LES MARMITONS, bousculant Pontsablé.
Pour que Bacchus le tienne en joie,
Nous apportons à monseigneur
D’excellents gâteaux de Savoie,
Vins exquis et fine liqueur !
PONTSABLÉ, qui s’est relevé, furieux à Favart.
Ce drôle est des plus négligents !
Pourquoi faire entrer tous ces gens ?
FAVART.
Vous vous trompez, ce n’est pas moi,
Ce qui les fit venir, je crois,
C’est ma petite sonnette,
Ma sonnette mignonnette.
TOUS.
C’est la sonnette !…
FAVART.
Je vous le dis et c’est certain,
Le coupable c’est la sonnette,
Ils sont accourus au tin, tin
De ma sonnette mignonnette,
Tin ! tin ! tin !
PORTSABLÉ.
Si ce qu’il me dit est certain,
Si le coupable est la sonnette,
Que le diable soit des tin, tin
De cette sonnette indiscrète,
Tin ! tin ! tin !
MADAME FAVART.
Il a raison et c’est certain,
Le coupable c’est la sonnette,
Ils sont accourus au tin, tin
De la sonnette mignonnette,
Tin ! tin ! tin !
LES MARMITONS.
Nous devons être, c’est certain,
Attentifs aux coups de sonnette
Et nous’accourons aux tin, tin
De la sonnette mignonnette,
Tin ! tin ! tin !
PONTSABLÉ, furieux, aux marmitons.
Au diable ! Au diable allez-vous-en !
FAVART et MADAME FAVART, à part.
Il est furieux ! Ah ! C’est charmant !
Sur un geste de colère de Pontsablé, tous les marmitons se sauvent.
PONTSABLÉ, à Favart.
Toi, fais donc plus attention !
FAVART.
C’est mon grand zèle qui m’emporte…
PONTSABLÉ.
C’est bon, reprends ta faction.
FAVART.
Oui, je garderai bien la porte.
PONTSABLÉ, parlé.
Reprenons… Heureusement que j’ai du ressort… (A Madame Favart, avec feu.) Madame, ne me repoussez pas, vous ne savez pas ce que vous refuseriez… un mari, c’est un amoureux bien tiède, tandis que moi, je suis bouillant, et à toute heure du jour vous me trouverez prêt à vous prouver ma flamme.
MADAME FAVART.
En amour rempli de vaillance
Dites-vous cette flamme-là,
Pendant toute votre existence,
A mes yeux se rallumera !
Mon époux je le sais d’avance
Est bien moins brûlant que cela ;
Entre vous, quelle différence !
PONTSABLÉ.
Elle est immense !
MADAME FAVART.
Vous, vous me promettez beaucoup,
Au risque d’être téméraire.
Lui ne me promet rien du tout,
Mais me donne le nécessaire !
Le nécessaire !
PONTSABLÉ, avec chaleur à madame Favart.
Ici plus de contrainte,
Dans une douce étreinte
Laisse-moi t’enlacer,
Sur mon cœur te presser.
MADAME FAVART.
La demande est hardie,
Finissez, je vous prie.
PONTSABLÉ.
Tu ne peux refuser
D’accorder un baiser.
MADAME FAVART.
Un baiser ! Jamais !
PONTSABLÉ.
Écoutez ô ma mie !
Un baiser, je t’en prie !
Favart sonne. À ce moment, les tapissiers et marmitons entrent et séparent Pontsablé de Mme Favart.
CHŒUR DES TAPISSIERS.
Montés sur les échelles et clouant des écussons aux murs.
Pan ! pan ! pan ! pan ! amis, courage !
Pan ! pan ! pan ! pan ! cognant, frappant !
Pan ! pan ! pan ! pan ! faisons l’ouvrage !
Pan ! pan ! pan ! pan ! frappons gaiement !
PONTSABLÉ, furieux à Favart.
Ce drôle est des plus négligents !
Pourquoi laisser entrer ces gens ?
FAVART.
Vous vous trompez, ce n’est pas moi ;
Ce qui les fit venir, je crois,
C’est ma petite sonnette,
Ma sonnette mignonnette.
TOUS.
C’est la sonnette !
REPRISE DE L’ENSEMBLE.
FAVART.
Je vous le dis et c’est certain,etc.
PONTSABLÉ.
Si ce qu’il me dit est certain,etc.
MADAME FAVART.
Il a raison et c’est certain, etc.
LES MARMITONS.
Nous devons être, c’est certain, etc.
LES TAPISSIERS.
Pan ! pan ! Pan ! etc., etc.
- ET MME FAVART
Tin tin tin,
Aux maudits sons des tin tin tin
PONTSABLÉ.
Tin tin tin,
Aux maudits sons des tin tin tin
Les tapissiers se sauvent par le fond.
Scène XI
PONTSABLÉ, MADAME FAVART, FAVART.
PONTSABLÉ.
C’est inouï !… Ça n’a pas de nom !… impossible de faire ma déclaration au milieu d’un pareil tohu-bohu !… (A madame Favart, très-vite.) Mais il faut que vous sachiez une chose, madame… J’hésitais à vous le dire… mais puisque vous me repoussez, puisque vous me sacrifiez à votre mari, apprenez que, lui, il vous trompe !… Oui, madame, il a une maîtresse !…
MADAME FAVART.
Allons donc !
PONTSABLÉ, continuant.
Qu’il cache ici dans votre propre maison !… (Avec éclat) Et cette maîtresse, c’est madame Favart..
FAVART, à part.
Hein ?
MADAME FAVART, à part.
Ciel !… (Haut.) Qui a pu vous dire… ?
PONTSABLÉ.
Une vieille amie à moi… que je n’ai pas vue depuis une trentaine d’années… la comtesse de Montgriffon.
MADAME FAVART, à part.
Elle m’avait reconnue…
PONTSABLÉ.
Elle m’a écrit un petit billet, où elle me donne rendez-vous ici ce soir… et c’est elle-même qui me désignera notre habile comédienne.
MADAME FAVART, à part, très-vivement.
Je suis prise !… Maudite vieille ! ah ! il faut absolument que je m’éloigne… Mais que faire ? (Par inspiration.) Ah ! une attaque de nerfs… (Haut.) Ah ! marquis !… marquis !
PONTSABLÉ.
Quoi donc ?
MADAME FAVART, avec des pleurs.
Vous m’avez ouvert les yeux… lui !… une maîtresse !… Ici !… chez moi !… oh ! c’est affreux !
PONTSABLÉ.
C’est indigne !
MADAME FAVART.
Oh ! que je souffre !… Je ne pourrai paraître à cette fête… mon pauvre cœur brisé… J’étouffe !… (Elle chancelle.) Ah ! ah !
PONTSABLÉ, la recevant dans ses bras et la renvoyant à Favart.
Elle se trouve mal !…
FAVART.
Ah ! mon Dieu !… (Bas à sa femme.) Qu’as-tu donc ?
MADAME FAVART, bas à Favart.
Tais-toi… c’est pour rire… (Renversant sa tête et criant.) J’étouffe !… ah ! ah !
FAVART, à part.
Bien joué l’évanouissement…
PONTSABLÉ, criant.
Des sels !… du vinaigre !
Scène XII
Les Mêmes, HECTOR, puis SUZANNE.
HECTOR, entrant.
Qu’y a-t-il ?
PONTSABLÉ.
Du vinaigre… des sels… il n’y a donc pas une femme de chambre ?…
SUZANNE, en soubrette, entrant.
On m’appelle ?
HECTOR, à part.
Suzanne !
SUZANNE, bas en passant devant lui.
Je vous avais bien dit que je trouverais un moyen de rester…
PONTSABLÉ, à Suzanne.
Secourez votre maîtresse…
MADAME FAVART, d’une voix languissante.
Merci… merci… je vais mieux… (Se levant.) Permettez-moi seulement de me retirer dans ma chambre…
HECTOR.
Je vais vous conduire…
MADAME FAVART, d’un ton sec.
C’est inutile… (A Favart.) Votre bras, Benoît…
FAVART.
Voilà, madame…
PONTSABLÉ, enchanté.
Elle est furieuse… très-bien !…
MADAME FAVART, se retirant et lançant une œillade à Pontsablé.
Au revoir… cher marquis…
Elle lui tend la main.
PONTSABLÉ, bas en lui baisant la main.
Puis-je donc espérer ?
MADAME FAVART, bas.
Oui… Quand vous tiendrez madame Favart !
Elle sort avec Favart qui la soutient.
Scène XIII
PONTSABLÉ, HECTOR, SUZANNE, puis FAVART.
PONTSABLÉ, à part, joyeux.
Elle est à moi !
HECTOR, à Suzanne.
On n’a plus besoin de vous, vous pouvez vous retirer.
SUZANNE.
Oui, monsieur !
PONTSABLÉ, regardant Suzanne.
Tiens ! tiens !… mais elle est gentille cette petite… viens ici, petite… Comment t’appelles-tu ?
SUZANNE, faisant la révérence.
Toinon, monseigneur… (A part.) Elle a pris mon nom, je prends le sien.
PONTSABLÉ.
Toinon !… c’est tout à fait champêtre… ça sent les foins… Sais-tu bien, soubrette, que tu es bien piquante !
HECTOR, rageant, à part.
Oh ! oh !… devant moi !
PONTSABLÉ.
Tiens, voilà un louis pour t’acheter une croix d’or.
SUZANNE.
Merci, monseigneur…
PONTSABLÉ.
Et un baiser par-dessus le marché…
Il essaie de l’embrasser.
HECTOR, n’y tenant plus.
Oh ! oh !… (A Suzanne.) Sortez, effrontée, sortez !
SUZANNE, s’éloignant.
Oui, monsieur… (A part, en sortant.) Il est jaloux… chacun son tour !…
Elle disparaît.
PONTSABLÉ, à lui-même.
C’est étonnant comme il rudoie ses domestiques…
FAVART, entrant par le fond.
Voici déjà des invités de monsieur qui arrivent.
HECTOR, avec humeur.
C’est bien, faites entrer.
Scène XIV
PONTSABLÉ, HECTOR, FAVART, Invités et Invitées, puis MADAME FAVART, en vieille douairière.
Musique en sourdine.
FAVART, annonçant dans le fond.
- le comte et madame la comtesse de Beaucresson, M. et madame le Barrois, M. le vidame des Ablettes, M. le baron et madame la baronne de Verpillac…
HECTOR, saluant.
Mesdames… messieurs…
PONTSABLÉ, à part.
Je ne vois pas la vieille comtesse de Montgriffon, me manquerait-elle de parole ?
FAVART, au fond, annonçant.
Madame la comtesse de Montgriffon !
HECTOR, à part.
Ma tante !… quel fâcheux contretemps ! (à Favart.) Mais ce n’est pas ma tante !
FAVART, bas.
Chut !… c’est ma femme !
PONTSABLÉ, allant à madame Favart.
Venez donc, chère comtesse, je vous attendais avec une impatience…
MADAME FAVART, en douairière.
Bonjour, marquis, bonjour ! (Le lorgnant.) Ah ! mon cher ! comme vous êtes changé ! quelle dégringolade !
PONTSABLÉ, vexé.
Vous trouvez… moi je vous ai reconnue tout de suite ! (A part.) C’est une ruine !
MADAME FAVART.
Ah ! nous étions mieux que ça autrefois, dans notre jeune temps… mais que voulez-vous ! on ne peut pas être et avoir été, n’est-ce pas ?… ah ! mon existence a été bien remplie, je ne me plains pas.
N°14 – MENUET ET RONDEAU DE LA VIEILLE
MADAME FAVART.
Je passe sur mon enfance,
J’arrive à mes dix-sept ans ;
Cette époque d’innocence
Qu’on appelle le printemps !
Innocente !… j’ose à peine
Affirmer tant de vertu ;
Ce bon monsieur Lafontaine
Déjà !… chut !… je l’avais lu !
Quand passait sous ma fenêtre
Un jeune et bel officier,
Je sentais dans tout mon être
Un… je ne sais quoi vibrer !
Le cœur chaud, la tête prompte,
Quand vinrent mes dix-huit ans,
J’épousai monsieur le comte…
Vrai !… Je crois qu’il était temps !
Puis l’été… de vingt à trente.
Tout bas, je l’avoue ici…
Cette saison trop brûlante…
Fut fatale à mon mari !
A quarante ans c’est l’automne.
Au dire des amoureux,
C’est alors que l’arbre donne
Ses fruits les plus savoureux.
Mais, hélas ! l’hiver s’avance,
Il neige sur mes cheveux ;
Aux douceurs de l’existence
Il faut faire mes adieux !
A cette vie… un peu leste…
J’ai renoncé… malgré moi
Mais le souvenir m’en reste,
Et c’est encore ça, ma foi !
PONTSABLÉ, à lui-même.
Peste ! ce fut une gaillarde… (Haut.) Chère comtesse, je vous remercie d’être venue… (à Hector) Je vous ai dit, Boispréau, que j’étais venu à Douai pour y arrêter madame Favart ; vous m’avez promis de m’y aider… Eh bien, la besogne sera facile, attendu que vous cachez madame Favart ici même !…
HECTOR.
Moi !
MADAME FAVART.
Certainement, petit drôle…
HECTOR, bas à Favart.
Comment !… Mais qu’est-ce qu’il lui prend ?
FAVART, bas.
Laissez-la faire… laissez-la faire.
PONTSABLÉ, à Hector.
Ah ! ah ! vous êtes confondu… je ne vous en veux pas… (A madame Favart.) Il ne vous reste plus qu’à me la montrer…
MADAME FAVART.
Vous êtes arrivé trop tard, mon bon ami… la cage est vide… l’oiseau est envolé. Madame Favart n’est plus ici depuis une heure…
PONTSABLÉ, très-agité.
Elle m’échapperait… mais le maréchal de Saxe va me révoquer… je suis destitué !…
MADAME FAVART.
Allons, allons… mon bon !… calmez-vous… tout n’est pas perdu… Je sais où est la belle.
HECTOR, stupéfait.
Hein ?
FAVART, bas.
Laissez-la faire… Laissez-la faire !
MADAME FAVART, lui donnant une lettre.
Voici un billet qu’elle adressait à mon neveu et que je viens d’intercepter au passage… (A Hector.) Grondez-moi donc, vous…
HECTOR, bas.
Oui… (Haut.) Comment ma tante, vous avez osé…
MADAME FAVART, sèchement.
Silence, Hector !
PONTSABLÉ.
Silence, Hector !… (lisant la lettre) « Mon cher Hector, je pars pour Saint-Omer où je vais me réfugier chez une de mes parentes, madame Dubois… j’espère enfin être à l’abri de mes persécuteurs… Justine Favart ! » (Avec joie.) Je la tiens !
MADAME FAVART.
Mais il ne faut pas perdre de temps…
PONTSABLÉ, vivement.
Pas une minute…
MADAME FAVART.
Il faut partir pour Saint-Omer…
PONTSABLÉ.
À l’instant même…
MADAME FAVART.
Partez vite, marquis ! (Bas à Hector.) Grondez-moi donc…
HECTOR.
Mais, ma tante…
MADAME FAVART.
Silence, Hector !…
PONTSABLÉ.
Silence, Hector ! (A Favart.) Vite, vite, ma voiture.
Favart remonte au fond pour donner l’ordre.
FAVART.
Voiture ! Voiture !
PONTSABLÉ.
Au revoir et merci… (Aux officiers.) En route, messieurs, en route pour Saint-Omer !
Il sort vivement avec les officiers. — Les invités sortent pour le voir partir.
Scène XV
MADAME FAVART, FAVART, HECTOR, puis SUZANNE.
Un instant de silence.
FAVART, avec joie.
Parti !
HECTOR, de même.
Enfin !
MADAME FAVART, ôtant sa douillette, sa coiffe et jetant sa canne.
Eh bien, comment trouvez-vous que je m’en suis tirée ?
HECTOR.
Superbe !…
FAVART.
Tu as été tout bonnement splendide…
SUZANNE, entrant, toujours en soubrette.
Ah ! madame, je vous écoutais… et je vous admirais !
FAVART, à sa femme.
Je te ferai un rôle de vieille pour ta rentrée au théâtre…
MADAME FAVART.
Oui, mais en attendant, il faut fuir et gagner la frontière…
FAVART.
Tu as raison… la route est libre… partons !
PONTSABLÉ, du dehors.
Gardez bien toutes les issues, que personne ne puisse sortir !
TOUS LES QUATRE.
Lui !…
MADAME FAVART, vivement.
Du sang-froid !
Scène XVI
Les Mêmes, PONTSABLÉ, Les Invités.
N°15 – FINAL – CHŒUR ET ENSEMBLE
CHŒUR.
La fureur le transporte,
Que va-t-il se passer ?…
Et qui vient de la sorte,
Ainsi le courroucer ?
La musique continue en sourdine.
MADAME FAVART, à Pontsablé qui entre furieux.
Que signifie, cher marquis ?…
PONTSABLÉ.
Cela signifie que l’on voulait me bafouer.
MADAME FAVART.
Comment ?
PONTSABLÉ.
Heureusement que la première personne que j’ai rencontrée en sortant d’ici, c’est la vraie comtesse de Montgriffon qui arrivait dans son carrosse.
MADAME FAVART, à part.
Aïe !
FAVART, à part.
Très-scénique !… mais bien fâcheux !
PONTSABLÉ, à madame Favart.
Ai-je besoin d’ajouter que l’autre… celle qu’on m’a servie tout à l’heure, c’était madame Favart elle-même.
MADAME FAVART, à part.
Je suis prise !
SUZANNE et HECTOR.
Tout est perdu !
PONTSABLÉ, avec éclat.
Oui, madame Favart ! que je tiens enfin, et que je vais conduire au camp de Fontenoy… Ordre du maréchal de Saxe !
FAVART, s’élançant.
Du maréchal !… un instant ! je ne la quitte pas !… vous nous arrêterez ensemble !
PONTSABLÉ, étonné.
Qui donc êtes-vous ?
FAVART, se croisant les bras et avec force.
Je suis Favart !
PONTSABLÉ, joyeux.
Favart !… le mari et la femme !… je les tiens tous les deux… quel coup de filet !…
ENSEMBLE
PONTSABLÉ.
Tous deux je les attrape !
Je les pince je les happe !
C’est avoir du bonheur!
La charmante aventure !
Cette double capture
Me fera grand honneur
La charmante aventure
Être la capture
De l’heureux gouverneur
Cette double capture Me fera bien sûr,
grand honneur.
FAVART.
Il nous attrape,
Le sort nous frappe !
C’est avoir du malheur !
L’aventure,
La capture,
Quelle absurde aventure
Être la capture
De ce vieux gouverneur
Je deviens la capture de ce vieux gouverneur,
de ce gouverneur.
HECTOR.
Ici j’échappe,
Le sort me frappe !
C’est avoir du malheur !
L’aventure,
La capture,
Ô funeste aventure
Être la capture
De ce vieux gouverneur
Sa femme est la capture de ce vieux gouverneur,
de ce gouverneur.
Ma femme est la capture de ce vieux gouverneur,
de ce gouverneur.
CHŒUR.
Il les attrape !
Le sort les frappe !
C’est avoir du bonheur !
L’aventure,
La capture,
La bizarre aventure
Cette double capture
Lui fera
grand honneur !
MME FAVART et SUZANNE
Ô funeste aventure
je deviens la capture
De ce vieux gouverneur
Ô funeste aventure.
Je deviens la capture de ce vieux gouverneur,
de ce gouverneur.
PONTSABLÉ.
Le mari Favart et sa femme
Je tiens les deux, bravo Marquis !
Mais agissons vite, agissons !
Madame, vous avez un talent exquis…
Il s’avance vers Suzanne.
SUZANNE, étonnée.
Moi !…
TOUS, à part.
Que fait-il ?
PONTSABLÉ, à Suzanne.
De la franchise
Car cette fois pas de méprise,
La comtesse vient à l’instant de tout m’apprendre en me disant
« Vous trouverez la délinquante
Sous les habits d’une servantes
Répondant au nom de Toinon »
Vous ne pouvez plus dire non.
SUZANNE, vivement.
Mais je suis… je suis…
HECTOR, bas et vivement.
Ciel ! Il faut te taire !
PONTSABLÉ.
Vous êtes quoi ?
SUZANNE.
Que dois-je faire ?
PONTSABLÉ.
Eh bien ! vous êtes ?
SUZANNE, avec résolution.
Je suis, je suis…
Oui je suis madame Favart
Pour mentir il est trop tard.
PONTSABLÉ, enchanté.
Quelle victoire que la mienne !
MADAME FAVART, à Favart, bas.
Je suis sauvée !
FAVART, bas.
Et moi, mordienne !
Je suis un maître sot
D’avoir parlé trop tôt.
MADAME FAVART, bas à son mari, parlé.
Laisse-le faire et compte sur moi.
HECTOR, bas à sa femme, parlé.
Sois tranquille, je te rejoindrai.
PONTSABLÉ, joyeusement.
Et maintenant
Prenons la chose gaîment,
Partons sur-le-champ
Partons pour le camp !
MADAME FAVART puis TUTTI
Avec mon père, souvent
J’ai visité plus d’un camp ;
Je vous garantis, vraiment,
Que c’est un endroit charmant !
Après la guerre,
Le militaire
Aime à s’offrir
Quelque plaisir ;
Là, sous la tente,
On rit, on chante,
Rien n’est plus beau
Que ce tableau !
SUZANNE.
La vivandière
Verse à plein verre
Maintes liqueurs
A nos vainqueurs.
Puis la trompette,
Tout à coup jette
Dans tous les rangs
Ses sons bruyants.
Après la guerre,
Le militaire
Aime à s’offrir
Quelque plaisir ;
Là, sous la tente,
On rit, on chante,
C’est un très beau tableau !
MME FAVART et SUZANNE puis TUTTI
La foule immense
Soudain s’élance,
Et le tambour
Roule à son tour !
TOUS.
Tambour et trompette
Rataplan, Ratarataplan !
La fête est complète ;
Rien n’est charmant
Comme le camp !
Tambour et trompette
Rataplan, Ratarataplan !
La fête est complète ;
C’est charmant le camp,
Rataplan !
FAVART.
Et puis au commandement,
Ra ta plan !
Chacun s’élance gaîment,
Ra ta plan !
C’est un bruit étourdissant,
Ra ta plan !
Un coup d’œil éblouissant
Oui, c’est un bruit étourdissant
Ra ta plan !
TOUS.
Tambour et trompette
Rataplan, Ratarataplan !
La fête est complète,
Rien n’est charmant
Comme le camp !
Tambour et trompette
Rataplan, Ratarataplan !
La fête est complète,
C’est charmant le camp,
Rataplan !
Après la guerre,
Le militaire
Aime à s’offrir
Quelque plaisir ;
Là, sous la tente,
On rit, on chante,
C’est un très beau tableau !
La fête est Complète,
rataplan
Rien n’est charmant
Comme le camp
Rataplan !
Le rideau baisse.
Inter-acte
FAVART, « NICETTE », « MME MADRE », « M. SUBTIL »
Rideau fermé, sur le Proscenium.
FAVART, arrivant sur le proscenium, son carnet et sa plume à la main, réfléchissant.
O valeureux fils de Bellone,
Toi qu’une auréole environne… euh… Toi qu’une auréole environne…
(S’interrompant.) Voilà donc à quoi j’en suis réduit !… faire l’éloge du maréchal de Saxe alors que je lui dois toute ma misère… Allez donc rimer dans des conditions pareilles… Déserté par l’inspiration comme je le suis par ma chère Justine… (il jette carnet et plume)
Ah, décidément, la fatalité ne manque pas d’ironie ! C’est à croire parfois que mon destin a été composé par quelque facétieux librettiste de vaudeville.
Songer qu’il y a peu encore, je dirigeais le théâtre de la Monnaie de Bruxelles, qu’on me jouait sur la scène de l’Opéra-Comique, que ma « Chercheuse d’esprit » triomphait à plus de 200 reprises… Je tutoyais le succès, les portes de la gloire s’ouvraient devant moi… Et…
Et il aura suffi qu’un troupeau de barbons s’entichent de ma Justine pour que j’échoue ici, pataugeant dans la boue d’un camp militaire, réduit à donner le théâtre aux Armées au lieu de crouler sous les applaudissements du public parisien. La peste soit des barbons libidineux et de leur susceptibilité mal ordonnée !
Mais baste, puisque me voilà condamné aux publics en uniformes et aux tréteaux militarisés, qu’au moins ici aussi, mon talent éclate et transcende ma tragique destinée. Allons, au travail !
(il va vers la coulisse cour, récupère une liasse de feuilles (le livret de La Chercheuse d’esprit, et lance en entrouvrant légèrement le rideau de scène)
Holà, les artistes ! Moins d’oiseveté et plus de travail, je vous attends pour répéter.
Arrivée de « M.Subtil », finissant de s’habiller.
SUBTIL
Ah Favart ! Nous voilà, ces dames finissent de pomponner et arrivent. Aurons-nous un public exigeant, aujourd’hui ?
FAVART
Un public exigeant ? Vous vous croyez donc au Français ? C’est le Théâtre aux Armées, ici, vous n’ allez pas jouer devant le roi mais devant une assemblée de soudards surexcités par leur victoire d’hier.
SUBTIL
Pfff, quel gâchis. Mais soit, même les rustres ont droit à la félicité artistique, et je serai heureux de leur dispenser quelques miettes de mon talent.
FAVART
Voilà, c’est ça. Et ces dames, sont-elles prêtes ?
Arrivée de « Nicette » et « Mme Madré ».
NICETTE / MME MADRE
Nous voilà, cher maître, nous voilà.
FAVART
Bien.
Nous reprenons la scène 2. J’espère que vous l’avez retravaillée depuis hier, je vous rappelle que nous jouons aujourd’hui même… certes, devant un piètre public bien indigne d’une œuvre comme ma Chercheuse d’Esprit (regard à Subtil), mais tout de même ! Allons.
Vous connaissez la situation : Mme Madré donne sa fille Nicette à épouser à M. Subtil, qui, lui, va donner son fils à Mme Madré comme futur mari. Contrairement à leurs calculateurs parents, les enfants sont tous les deux innocents, en particulier Nicette…
NICETTE, bêtasse.
… Ah oui, elle est bien gentille, cette Nicette !
FAVART, sarcastique.
Voilà, vous avez à merveille résumé les choses, et quoique je n’aime pas dire du mal, elle est en effet bien gentille, cette Nicette. A défaut de ma chère Justine, vos occuperez fort bien l’emploi, mon amie (« Nicette », croyant que c’est un compliment, est ravie).
Bref, cette scène montre, non sans humour et talent, comme les fâcheux s’entichent à bien mauvais escient de l’innocence… (à part) C’est à croire que j’étais doué de préscience quand j’écrivis ces pages !
Allons-y : (à Nicette) Donc, ma chère, soyez idiote, (à M. Subtil), vous, soyez gonflé d’arrières-pensées libidineuses, (à Mme Madré) et quant à vous, soyez la pire mère qu’ait portée la Terre depuis cette infanticide de Médée !
Nicette, Mme Madré et M. Subtil se mettent en place, Favart s’installe en retrait près de la coulisse jardin.
- SUBTIL
Approchez mon aimable fille !
Ah ! Que je la trouve gentille
Votre douceur gagne le cœur !
NICETTE
Le cœur !
- SUBTIL
Le cœur !
Pour vous Nicette je soupire
C’est l’effet d’un regard,
que vous m’avez lancé !
NICETTE
Lancé !
- SUBTIL
Lancé !
Soulagez mon martyre.
Pour jamais l’amour
m’a blessé !
NICETTE
Blessé !
- SUBTIL
Blessé!
MME. MADRÉ
L’entretien me fait rire.
- SUBTIL
De ces yeux si jolis
Tous les coups sont partis.
Je meurs d’amour !
NICETTE
Hé bien tant pis
- SUBTIL
Ah ! L’aimable innocence
Rien encor n’a pus l’enticher
Quel plaisir quand j’y pense
De défricher son ignorance
MME. MADRÉ
Son esprit ne sortira non jamais de sa cosse,
Bête elle sera !
Après comme avant la noce,
Moi, dès son âge je n’ignorais rien.
- SUBTIL
Vous fûtes précoce, on le sait fort bien !
ENSEMBLE
- SUBTIL
Ah ! L’aimable innocence
Rien encor n’a pus l’enticher
Quel plaisir quand j’y pense
Ah! quel plaisir,
l’esprit,
Oui da,
Tout comme une autre lui viendra,
L’esprit certainement viendra
Tout comme une autre elle apprendra !
NICETTE
Je n’comprends rien
à tout c’qui m’disent ici
Je n’comprends rien
à tout c’qui m’disent
Je n’comprends rien !
MME. MADRÉ
Son esprit ne sortira non jamais de sa cosse,
Et bête elle sera !
Après la noce,
Jamais l’esprit ne sortira,
Jamais l’esprit ne lui viendra,
Et toujours bête elle sera
Oui toujours bête elle sera
Jamais l’esprit ne lui viendra !
FAVART, enthousiaste au début puis de moins en moins.
Bien, bien, tout cela n’est pas mal du tout. Certes, ce serait bien mieux encore avec ma chère Justine, mais il faut se contenter de ce que l’on a.
Vous, messieurs c’était très bien ! C’était très bien ! Bon, vous c’était bien là-bas. Vous c’était bien … heu … c’est comme ci comme ça. Dites moi, vous ! On ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais !
Vous n’arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention ! Écoutez, j’ai une conception personnelle de l’ouvrage, ce n’est pas assez triomphal, pas assez orgueilleux, de l’orgueil bon sang ! C’est de la bouillie tout ça ! C’était pas mauvais, c’était très mauvais ! Voilà, exactement ! Alors reprenons au début !
A ce moment-là, retentissent les premières mesures instrumentales de l’entracte du 3ème acte.
FAVART
Allons bon, les revoilà, ceux-là. Tant pis, fin de répétition. Allez, filez.
Tous les 4 disparaissent à cour, dans la maison réservée aux comédiens.
Acte troisième
AU CAMP DE FONTENOY
Scène première
Soldats, Officiers, puis COTIGNAC, Les Fifres, Les Vivandières, Les Petits Soldats.
Au lever du rideau, tableau pittoresque et très-animé. Des soldats jouent aux cartes et aux dés sur des tambours, etc.
N°16 – INTRODUCTION.
CHŒUR DES SOLDATS.
Nous avons gagné la victoire,
Nous nous sommes couverts de gloire !
Au son du fifre et du tambour,
Chantons, buvons en ce beau jour !
LES PETITS FIFRES.
Petits fifres du régiment,
Avec des notes sans pareilles,
Nous charmons le soldat vaillant,
En lui déchirant les oreilles !
Pfitt ! pfitt ! pfitt !
Écoutez ça !
Car la musique
Pfitt ! pfitt ! pfitt !
La plus magique,
Oui, la voilà !
TOUS.
Pfitt ! pfitt ! pfitt !
Écoutez ça,
Etc.
LES VIVANDIÈRES.
Vivandières du régiment,
Des nôtres réchauffant le zèle,
On nous voit courir bravement
Où l’son du fifre nous appelle,
LES PETITS SOLDATS puis TOUS.
Petits troupiers du régiment,
Remplis d’ardeur et de vaillance,
Nous nous comportons brillamment,
Quand le fifre nous met en danse,
Écoutez ça !
Car la musique
La plus magique,
Oui, la voilà !
COTIGNAC, aux fifres et aux trompettes
Rompez les rangs !…
TOUS, rompant les rangs.
Vive le major !
Tous sortent, sauf Jolicoeur, Larissole et Sansquartier.
Scène II
COTIGNAC, LARISSOLE, SANSQUARTIER, JOLICOEUR
COTIGNAC.
Très-bien !
JOLICŒUR, aux autres.
Enfin… nous allons donc savoir…
Il se dirige vivement vers une des tentes pour soulever le rideau.
COTIGNAC.
Hé ! là-bas, Jolicœur… Qu’est-ce que vous faites là ?
JOLICŒUR.
Pardon, major, je regardais…
SANSQUARTIER.
Ne vous emportez pas, major… C’est Larissolle qui prétend qu’une femme a passé la nuit sous cette tente.
LARISSOLLE.
Un peu que je le prétends… puisque je l’ai vue…
JOLICŒUR, vivement.
Une femme !… une femme !… Est-ce vrai… monsieur le major ?
COTIGNAC, l’imitant.
Une femme… une femme !… voyez-vous, ce blanc-bec, comme il prend feu. Eh bien ! oui, c’est vrai, une femme et une femme charmante.
TOUS, l’entourant.
Qui ça ?… qui ça ?…
COTIGNAC.
Eh !… vous m’étouffez.., dégagez, dégagez… c’est madame Favart, parbleu !…
TOUS.
Madame Favart !
SANSQUARTIER.
La célèbre comédienne ?
COTIGNAC.
Elle-même !… En l’honneur de la victoire de Fontenoy, il y a aujourd’hui grande fête au camp, et tout à l’heure, madame Favart jouera devant vous tous le rôle de la Chercheuse d’esprit qu’elle a créé à Paris.
JOLICŒUR.
Une comédienne, mon rêve ! (prenant le tricorne de Cotignac.)
COTIGNAC.
Veux-tu laisser ça, toi… tu vois bien que tu perds ton temps. (Reprenant.) Oui, mes enfants… de plus elle chantera des vers en l’honneur du maréchal de Saxe, que M. Favart est en train d’improviser…
Roulement de tambour en coulisses.
TOUS.
Qu’est-ce que c’est que ça ?…
COTIGNAC.
C’est l’ordre du jour qui va vous donner les détails de la fête.
LARISSOLLE.
Courons l’entendre !
COTIGNAC.
Halte-là !… Qui m’aime me suive… (les trois soldats sortent en courant. — Seul à l’avant-scène.) Attendez-moi donc, tas de clampins !
Il sort.
Scène III
FAVART, SUZANNE
SUZANNE, sortant de la tente et courant à Favart, entré de l’autre côté.
Ah ! monsieur Favart !… Eh bien ?… pas de nouvelles d’Hector ?
FAVART.
Aucune… pas plus que de Justine… et pourtant je comptais sur elle…
SUZANNE.
Qu’allons-nous faire ?
FAVART.
Ça je l’ignore…
SUZANNE.
Dame ! il faudra bien avouer que je ne suis pas Mme Favart… Ah ! pourquoi suis-je venue ici ?
FAVART.
Tout ça, voyez-vous, c’est la faute de ce vieux croûton de gouverneur… de ce don Juan fossile… de ce…
SUZANNE.
Silence… le voici !…
Scène IV
Les Mêmes, PONTSABLÉ.
PONTSABLÉ, entrant vivement.
Madame Favart ! (Apercevant Favart et Suzanne.) Vous êtes là… Ah ! mes enfants, je suis aux anges… aux anges !… Je sors de chez le maréchal de Saxe… il a la goutte… Sans quoi il serait déjà venu vous faire une petite visite… Du reste il est enchanté… Il sait que c’est grâce à mon adresse que vous êtes au camp… Il m’a bombardé d’éloges… bombardé est le mot.
FAVART, avec ironie.
Eloges bien mérités.
PONTSABLÉ.
Je le crois… car j’ai été fin…
FAVART.
Oh ! oui… (A part.) Vieux satyre, va !…
PONTSABLÉ, à Favart.
Voyons, ça marche-t-il ?… Avez-vous terminé votre impromptu ?…
FAVART.
À peu près. (Déclamant).
O valeureux fils de Bellone !…
Toi qu’une auréole environne…
PONTSABLÉ.
Très-bien… (A Suzanne.) Et vous, madame, avez-vous repassé votre rôle ?
SUZANNE, embarrassée.
Mon rôle… oui… certainement. (A part.) Quelle position délicate !
PONTSABLÉ.
Alors, tout va bien… Tant mieux ! car j’ai une grande nouvelle à vous annoncer… Le roi vient d’arriver au camp et va assister à la représentation…
FAVART, effrayé.
Le roi ?…
SUZANNE, à part.
Ah ! mon Dieu !
PONTSABLÉ, à Suzanne.
Depuis longtemps il désirait vous voir jouer… votre fortune est faite.
SUZANNE, bas à Favart.
Ah ! il n’y a plus à hésiter…
FAVART.
Il faut tout lui dire…
SUZANNE, à Pontsablé.
Monseigneur !…
PONTSABLÉ.
Quoi ?…
SUZANNE.
Monseigneur, on vous a trompé… Je ne suis pas madame Favart !
PONTSABLÉ.
Hein ?…
FAVART.
Il y a erreur dans la personne… J’ai mis ça très-souvent dans mes pièces.
PONTSABLÉ, à Suzanne.
Mais alors, qui êtes-vous donc ?
SUZANNE.
Je suis… madame de Boispréau…
PONTSABLÉ, stupéfait.
La femme d’Hector… Il serait possible !…
SUZANNE, avec émotion.
Et je vous prie, monseigneur, je vous supplie de me permettre d’aller retrouver mon mari…
PONTSABLÉ, la regardant fixement.
Bon ! bon !… je comprends… (Riant.) Ah ! ah ! ah !
SUZANNE.
Comment ?
PONTSABLÉ.
Vous cherchez encore à m’échapper… Fi ! que c’est mal… vous voulez me jouer un petit tour dans le genre de l’autre.
SUZANNE.
Moi !
FAVART, à part.
Qu’est-ce qu’il dit ?
PONTSABLÉ.
Seulement on ne m’attrape pas deux fois !…
FAVART, à lui-même.
Comment ! il ne croit pas…
SUZANNE.
Mais, monseigneur, je vous jure…
PONTSABLÉ.
Mme Favart, ne jurez pas. Allez, c’est entendu, vous jouez la comédie à ravir… et je vous prédis tout à l’heure un énorme succès devant Sa Majesté !… Ah ! ah ! ah ! madame de Boispréau… Elle est un peu forte celle-là !… À bientôt, chère belle, à bientôt ! Et repassez votre rôle…
Il sort.
FAVART.
Eh bien ! vrai, je ne m’attendais pas à celle-là !…
SUZANNE, désespérée.
Que vais-je faire, moi ?
FAVART.
Retirez-vous dans votre tente, et attendons les événements.
SUZANNE, avec un soupir.
Attendons !
Elle entre sous la tente.
FAVART.
Et moi, rimons !…
Il sort. Hector et madame Favart, tous deux en costume de colporteurs, paraissent au fond, entourés par les soldats.
Scène V
HECTOR, MADAME FAVART, LE SERGENT, Les Soldats.
N°18 – CHŒUR ET TYROLIENNE
CHŒUR DES SOLDATS.
Allons, sans plus attendre,
Montrez, petits marchands,
Si vous avez à vendre
Beaucoup d’objets charmants.
LE SERGENT.
Quels sont ces deux petits bonshommes ?
Et que viennent-ils faire au camp ?
MADAME FAVART.
Vous voulez savoir qui nous sommes…
HECTOR.
On va vous le dire à l’instant.
ENSEMBLE.
MADAME FAVART et HECTOR.
Tyroliens de naissance,
Tout le jour nous chantons ;
Gagnant notre existence,
Du mieux que nous pouvons.
La, la, i, ti !
La, la, i, ti !
La, i, la !
LE SERGENT.
Sont-ils gentils tous les deux… Mais vous ne ferez pas beaucoup d’affaires avec nous, camarades.
MADAME FAVART.
Tant pis !
HECTOR.
Un peu plus loin, nous serons plus heureux.
LE SERGENT.
À votre aise… essayez… (aux soldats.) Et vous, alors, vous n’avons donc pas de travail à faire ? Allez !
Le Sergent et les soldats disparaissent, Hector et madame Favart restent seuls sur la scène.
MADAME FAVART.
Vous voyez, ça va tout seul… nous voilà de la maison… Il s’agit maintenant de savoir où est mon mari…
HECTOR.
Et ma petite femme.
MADAME FAVART.
Et de les avertir que tout est préparé pour notre fuite et qu’une voiture nous attend à cinq cents pas du camp… Cherchons !…
HECTOR.
Oui, cherchons bien vite !
MADAME FAVART, regardant autour d’elle et apercevant le théâtre.
Un théâtre !… Que c’est bête, tout de suite mon cœur a battu… Une affiche !…
HECTOR.
Venez… venez…
MADAME FAVART, s’approchant de l’affiche et lisant.
Madame Favart ! (A Hector.) Une minute seulement. (Lisant.) « Théâtre du camp à trois heures. Représentation devant le roi. » (S’arrêtant.) Devant le roi ! (Continuant.) « La Chercheuse d’esprit. Madame Favart remplira le rôle de Nicette… » Moi !
HECTOR.
Voilà qui est curieux !
MADAME FAVART, à elle-même.
Et le roi assistera… mais alors je pourrais peut-être… Oui ! mais dans ce costume… Bah ! ce sera bien plus original… C’est dit ! (Appelle le sergent Larose) Sergent ?
LE SERGENT.
Petit ?…
MADAME FAVART.
Est-il vrai que le roi soit au camp ?
LE SERGENT.
C’est authentique !… Même que voilà sa tente là-bas !…
MADAME FAVART.
Celle où flotte le drapeau ?
LE SERGENT.
Oui…
MADAME FAVART.
Merci, sergent !…
LE SERGENT.
Il n’y a pas de quoi.
Il sort.
HECTOR, à madame Favart.
Que voulez-vous faire ?
MADAME FAVART, avec résolution.
Hector, j’ai une autre idée.
HECTOR.
Une idée ?…
MADAME FAVART.
Une idée hardie, mais qui peut nous sauver.
HECTOR.
Expliquez-moi…
MADAME FAVART, vivement.
Non… plus tard… attendez-moi ici, je reviens.
Elle sort en courant
HECTOR.
Hein ?… Elle me laisse là… tout seul… (Il reprend son panier de colporteur) Ah ! si ce n’était pas pour ma femme… Oh !… Suzanne ! Suzanne !…
SUZANNE.
Mon nom !… (Elle aperçoit Hector, le reconnait et court à lui.) Hector !
HECTOR.
Elle !…
Scène VI
HECTOR, SUZANNE.
HECTOR, l’embrassant.
Enfin !… je te revois !…
SUZANNE.
Mon ami… quelle imprudence !
HECTOR.
Il n’y a pas de danger… nous sommes seuls.
SUZANNE.
Mais comment as-tu pu pénétrer dans ce camp ?
HECTOR.
Tu vois, grâce à ce costume de colporteur… Ah ! c’est que je n’y tenais plus, vois-tu… loin de toi… j’étais inquiet, tourmenté…
SUZANNE.
Et jaloux…
HECTOR avec humour.
Et jaloux… je ne m’en cache pas… Si tu crois que c’est rassurant de savoir sa jeune épouse au milieu d’un corps d’armée de soixante mille hommes parmi lesquels il y en a au moins… cinquante-neuf mille cinq cents de très-entreprenants…
SUZANNE.
Quelle folie !… c’est là justement ce qui devait te rassurer.
HECTOR, étonné.
Comment ?
N°19 – COUPLETS.
SUZANNE.
Le péril que court ma vertu
Bien à tort te trouble la tête ;
Et ma sécurité, vois-tu !
N’a jamais été plus complète.
S’il s’agissait d’un amoureux,
Tu pourrais n’être pas tranquille…
Mais ce n’est pas bien dangereux
Quand on en a… soixante mille !…
On peut d’un cœur compatissant,
A l’amant qui prie et s’enflamme
Laisser cueillir en rougissant
Le tendre baiser qu’il réclame ;
Mais, vrai ! l’on y regarderait
La tâche étant trop difficile
Si par aventure, il fallait
En recevoir… soixante mille !
SUZANNE ET HECTOR.
Soixante mille
HECTOR, souriant.
Tu as raison, le nombre me rassure.
SUZANNE.
À la bonne heure !… Enfin l’important, c’est que te voilà… Et madame Favart ?
HECTOR.
Elle était avec moi… mais elle vient de partir comme une flèche.
SUZANNE, étonnée.
Ah ! où est-elle allée ?
HECTOR.
Je l’ignore.
SUZANNE.
Mais le temps presse.
HECTOR.
Je le sais bien. (Apercevant madame Favart au fond.) Ah !… la voici !
Scène VII
Les Mêmes, MADAME FAVART.
HECTOR et SUZANNE.
D’où venez-vous ?
MADAME FAVART.
De chez le roi !
SUZANNE.
Quoi ! vous avez osé ?…
MADAME FAVART.
Oui… et si vous aviez vu quel effet quand l’officier de service a annoncé : madame Favart !
N°20 – AIR
J’entrai sous la royale tente,
Le front baissé, toute tremblante,
Et je m’arrêtai, l’air penaud,
Roulant dans mes doigts mon chapeau.
Il se fit un profond silence,
Chaque courtisan, à part soi,
Se demandant si ma présence
Ne va pas déplaire au grand roi.
J’étais là, ne sachant que dire,
Quand j’entends un éclat de rire
Ah ! ah ! ah !
Je regarde un peu de côté…
Ça partait de Sa Majesté…
Ah ! ah ! ah !
Il prenait la chose au comique,
Aussitôt chaque courtisan
Et tout le corps diplomatique
S’empressèrent d’en faire autant.
Ah ! ah ! ah ! ah !
Ce fut un rire mémorable.
Jugeant le moment favorable,
Je n’hésite plus, et ma foi,
Je me jette aux genoux du roi.
Alors au plus vite,
Je vous lui récite,
Je vous lui débite
Toutes mes raisons ;
Pour moi le caprice
Du bouillant Maurice
Qui met sa police,
A mes cotillons.
Je raconte ensuite
Notre double fuite,
Sans pain et sans gîte,
Et tous nos malheurs.
Je suis éloquente,
Je suis émouvante,
Et ma voix touchante
Se mouille de pleurs, oui de pleurs.
Ah ! ah ! ah !
Du marquis je vise
La sotte méprise,
Quand, dans sa bêtise,
Il nous arrêta.
Bref, toute l’affaire,
Et ta ti ta taire !
Et ta ti ta taire !
Et ta ti ta ta !
Daignant alors me relever,
Le roi me dit d’un ton léger :
« Nous savons, madame, qu’on vante
Votre grâce, et l’on nous a dit,
Qu’où vous êtes surtout charmante
C’est dans la Chercheuse d’esprit. »
« Mais, sire, enfin que dois-je attendre ?
C’est un plaisir de vous entendre »
« Nous aurons ce plaisir ce soir
À bientôt, madame, au revoir. »
Et me voilà, me voilà !
HECTOR.
C’est une affaire manquée.
MADAME FAVART.
Oui… et remarquez que maintenant me voilà forcée de jouer…
SUZANNE.
C’est vrai… impossible de désobéir à Sa Majesté…
MADAME FAVART.
Aussi, j’ai pris mon parti… oui, je paraîtrai sur ce théâtre… je jouerai, je chanterai, je danserai… j’y mettrai ma tête, mon cœur et mes jambes… je brûlerai les planches… et alors nous verrons…
HECTOR.
Et nous ?…
MADAME FAVART.
Vous, c’est une autre affaire… Il faut, quoi qu’il arrive, vous mettre à l’abri de la colère du gouverneur… Partez !…
HECTOR.
Vous abandonner !…
SUZANNE.
Jamais !…
MADAME FAVART.
Allons, pas d’enfantillage… (Donnant à Suzanne son manteau et son chapeau.) Prenez ce chapeau, ce manteau, et fuyez bien vite !
PONTSABLÉ, du dehors.
Oui, je vais la prévenir…
MADAME FAVART.
Le marquis ! (Les poussant à partir.) Mais allez donc !… allez donc !
Hector et Suzanne disparaissent par le fond.
Scène VIII
MADAME FAVART, PONTSABLÉ.
PONTSABLÉ, se dirigeant vers la tente de gauche.
Voyons si madame Favart est prête…
MADAME FAVART.
Tâchons de le retenir un instant pour leur donner le temps de s’enfuir… Bonjour, marquis…
PONTSABLÉ, étonné.
Bonjour, marquis… Voilà un garçon familier…
MADAME FAVART.
Un garçon… (baissant sa fausse barbe) regardez-moi bien…
PONTSABLÉ, stupéfait.
Madame de Boispréau !… que venez-vous faire ici ?… et sous ces habits ?
MADAME FAVART.
Ingrat !… vous me le demandez !…
PONTSABLÉ, hésitant.
Je vous le demande… pour le savoir…
MADAME FAVART.
Pontsablé ! je vous ai promis que si mon mari me trompait, je le tromperais avec vous… (Avec dignité.) Une honnête femme n’a qu’une parole !…
PONTSABLÉ, avec joie.
Alors c’est pour moi que vous êtes ici ?…
MADAME FAVART, jouant l’émotion.
Pour vous seul… Voyez ma rougeur !…
PONTSABLÉ, s’échauffant.
Je la vois… et je suis au comble de la félicité… Ah ! femme divine… femme idolâtrée… femme…
Scène IX
Les Mêmes, COTIGNAC.
COTIGNAC, arrivant.
- le gouverneur !… M. le gouverneur !…
PONTSABLÉ, à part.
Ah ! son père !
MADAME FAVART, à part.
Il arrive bien, celui-là !
COTIGNAC.
Je venais !… (Apercevant madame Favart et poussant un cri.) Ah !
PONTSABLÉ, à part.
Il a reconnu sa fille…
COTIGNAC, à part.
La servante d’Hector !… Et déguisée !
PONTSABLÉ, à madame Favart.
Evitez sa colère… allez !
Elle sort.
Scène X
PONTSABLÉ, COTIGNAC.
PONTSABLÉ, à part.
Tâchons de calmer ce père irrité…
COTIGNAC, riant, à part.
C’est bien Toinon !… La servante d’Hector… Oh !…
PONTSABLÉ, haut, à Cotignac.
Pas de bruit, pas d’éclat, mon cher Cotignac… Je comprends votre colère… elle est légitime… Ne touchez pas à votre sabre !
COTIGNAC, étonné.
Je n’y touche pas…
PONTSABLÉ.
Vous avez reconnu la personne qui était là ?
COTIGNAC, narquois.
Si je l’ai reconnue ! Je crois bien !… c’est…
PONTSABLÉ.
Chut !… Pas de bruit ! pas d’éclat !… Ecoutez-moi, Cotignac… j’ai une excuse… la passion !… Je l’aime cette femme !… (Vivement.) Ne touchez pas à votre sabre !…
COTIGNAC.
Mais je n’y touche pas…
PONTSABLÉ.
Quant à elle, mon ami, je vous jure qu’elle n’est pas coupable…
COTIGNAC.
Coupable ou non… qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ?…
PONTSABLÉ, étonné.
Ça ne vous fait rien ?…
COTIGNAC.
À moi, rien du tout… et puisque vous y tenez tant que ça, vous n’avez qu’à dire à Hector de vous la céder…
PONTSABLÉ.
Vous croyez qu’il consentirait… ?
COTIGNAC.
Pourquoi pas ?… Il ne demande qu’à vous être agréable… D’ailleurs, je crois qu’il n’était pas très-content de son service… Et qu’il allait lui donner ses huit jours…
PONTSABLÉ, stupéfait.
Ses huit jours… il a une manière de s’exprimer…
COTIGNAC.
Seulement, c’est un drôle de goût que vous avez là… et il est regrettable qu’à votre âge vous donniez dans les cuisinières…
PONTSABLÉ.
Dans les cuisinières !… Mais ce petit paysan, c’est votre fille !… La femme d’Hector…
COTIGNAC.
Allons donc !… Jamais de la vie !… C’est sa domestique…
PONTSABLÉ, furieux.
Sa domestique !… Il m’aurait envoyé une bonniche… et moi, un Pontsablé, j’aurais courtisé une Margoton… une nymphe potagère !…
Scène XI
Les Mêmes, FAVART, Un Officier.
FAVART, entrant vivement.
Le roi est arrivé… Tout le monde se place… Nous sommes perdus…
UN OFFICIER, à Pontsablé.
Monseigneur, Sa Majesté ordonne que l’on commence à l’instant.
PONTSABLÉ.
Sa Majesté !… (A Favart.) Vite, monsieur, appelez vos artistes…
FAVART, abasourdi.
Oui, monseigneur ! (Remontant vers la maisonnette.) Nicette. M. Narquois, madame Madré…
LES ACTEURS, entrant.
Nous voilà !…
PONTSABLÉ.
En scène… en scène !… (Les acteurs montent sur le petit théâtre.) Et madame Favart… où est elle ?… Je cours l’avertir… oh ! ma tête !
Il sort vivement.
Scène XII
FAVART, seul.
Allons… c’est fini… la bombe va éclater… Il ne reste plus qu’une porte de derrière : « La mort ! » Vatel s’est tué pour moins que ça. Suivons l’exemple de cet illustre cuisinier.
Il pointe sa plume vers sa poitrine. — En entendant le chœur suivant, il s’arrête.
N°21 – CHŒUR ET DUO
CHŒUR EN DEHORS.
Favart ! Favart !
L’heure s’avance,
Pas de retard,
Que l’on commence ;
Favart ! Favart !
FAVART, se poignardant avec sa plume, parlé.
Finissons-en !… O Justine… Justine ! où es-tu ?
Scène XIII
FAVART, MADAME FAVART, en costume de Nicette de la Chercheuse d’esprit.
MADAME FAVART.
Me voilà !…
FAVART, stupéfait.
Toi ! … Est-ce bien toi ? ici ! … et dans le costume de Nicette ? … Comment se fait-il ?
MADAME FAVART.
Plus tard je t’expliquerai… mais… j’ai peur… va, j’ai bien peur…
DUETTO
ENSEMBLE.
MADAME FAVART.
Je tremble, je tremble !
Et c’est en vain que je combats,
La terre me semble
S’ouvrir et craquer sous mes pas.
Ah !
La terre me semble
Va craquer sous mes pas !
FAVART.
Tu trembles, tu trembles !
Je ne te comprends pas,
Et vraiment tu sembles
Faire aujourd’hui tes premiers pas.
Mordieu je ne te comprends pas !
FAVART.
Tu le vois, je suis brave… écoute,
Tu vas me suivre, et je vais, moi,
Sans crainte, te montrer la route.
Il s’élance vers le théâtre et monte l’escalier.
CHŒUR EN DEHORS.
Le roi ! le roi !
Qu’on fasse place !
Et chapeau bas devant le roi !
Favart redescend l’escalier, pâle et tremblant.
FAVART.
Le roi !
Tu l’as entendu, c’est le roi !
MADAME FAVART.
C’est le roi !
Le roi !
J’ai bien entendu !
Avec résolution.
Eh bien, non ! pas d’enfantillage !
Dans mon art, je trouve un soutien !
Et pour me donner du courage,
Embrasse-moi !
FAVART.
Je le veux bien.
MADAME FAVART, montrant sa joue.
Un gros baiser.
FAVART.
Bien doux ! bien tendre !
MADAME FAVART.
Qu’il sonne fort !
FAVART.
Il sonnera !
MADAME FAVART.
Allons, prends-le !
FAVART.
Je vais le prendre.
MADAME FAVART.
Dépêche-toi !
FAVART, l’embrassant.
Tiens, le voilà !
MADAME FAVART, montrant l’autre joue.
Un autre là !
FAVART.
Bien doux ! bien tendre !
Etc.
ENSEMBLE.
MADAME FAVART.
Ce bon baiser
M’a rendu mon courage ;
Sans plus tarder,
Mordienne ! à l’abordage !
FAVART.
Ce bon baiser
Lui rend tout son courage ;
Sans plus tarder,
Mordienne ! à l’abordage !
Madame Favart monte vivement sur le petit théâtre.
FAVART.
Ah !… je renais !… Place au théâtre ! (Il monte l’escalier.) Je frappe les trois coups !
Scène XIV
FAVART, sur le théâtre, PONTSABLÉ, puis COTIGNAC, Le Sergent, HECTOR et SUZANNE, puis Les Acteurs.
PONTSABLÉ, sortant de gauche.
Elle n’y est pas… je l’ai cherchée partout…
FAVART, reparaissant.
Ça y est !… le rideau est levé !…
PONTSABLÉ, avec colère.
Mais il est fou !… Et madame Favart ?…
COTIGNAC, entrant.
Monseigneur !… monseigneur !… On vient de saisir un homme et une femme qui cherchaient à sortir du camp.
PONTSABLÉ, furieux.
Qu’est-ce que ça me fait ?
COTIGNAC.
On va les amener devant vous…
PONTSABLÉ.
Je n’ai pas le temps…
LE SERGENT, au fond.
Par ici, allons, marchez !…
Le sergent fait entrer Hector et Suzanne.
COTIGNAC, très-surpris.
Ma fille et mon gendre !…
PONTSABLÉ, même jeu.
Hector… et madame Favart !… (A Hector.) Ah ! ah ! je comprends… Un rapt !… Vous vouliez l’enlever… faire manquer la représentation…
FAVART, sur le théâtre.
Silence donc, là-bas… ma femme est en scène…
PONTSABLÉ.
En scène… Qu’est-ce qu’il chante, celui-là. (A Favart.) C’est impossible, puisque…
FAVART.
Comment impossible !… (Applaudissements au fond.) Vous êtes donc sourd comme un pot ? Vous n’entendez donc pas les applaudissements ? (Applaudissant de toutes ses forces.) Bravo ! Justine, bravo !…
PONTSABLÉ, abasourdi.
Je n’y suis plus du tout… oh ! ma tête !… (Avec force.) Ah çà ! voyons, qui trompe-t-on ici ?…
HECTOR.
Vous, monsieur le marquis.
PONTSABLÉ, sautant.
Moi !…
SUZANNE, vivement.
Mais vous nous pardonnerez…
PONTSABLÉ.
Vous pardonner… ah çà ! madame, qui donc êtes-vous ?
SUZANNE.
Mais, je vous l’ai dit, monseigneur !
HECTOR.
Ma femme !…
COTIGNAC.
Ma fille !…
PONTSABLÉ.
Sa femme… sa fille… Oh ! ma tête !… Mais, alors, on s’est moqué de moi ?… (Furieux.) Morbleu !… Ventrebleu !…
TOUS LES TROIS.
Monseigneur…
PONTSABLÉ.
Arrière !… (Au sergent.) Vite… de quoi écrire. (A Hector, avec rage.) Ah ! vous m’avez bafoué, monsieur !… ah ! vous m’avez dindonné, monsieur… moi !… Un Pontsablé !… Mais, chacun son tour !… Je vous tiens !… et je vais prendre ma revanche !… Oh ! ma tête !… oh ! ma tête…
FAVART, sur le théâtre.
Mais, taisez-vous donc !… Vous troublez la représentation… On va vous faire sortir, vieux piaileur !…
PONTSABLÉ.
Cabotin !
FAVART, sur le théâtre.
Ça roule… ça roule !… chauffons, mes enfants… Le couplet au public maintenant. (Regardant par les plis de la tenture.) Bon, très-bien !… Le roi a souri… le grand roi a daigné sourire… (Applaudissements prolongée.) Quel succès !… quel succès !… c’est du délire !… (Applaudissements.) Bravo ! bravo ! Tous ! tous !… (S’essuyant le front.) Ah ! nous avons été beaux !
Il descend l’escalier, suivi des comédiens de La Chercheuse d’Esprit.
LES SOLDATS, hors scène.
Vive Favart !
FAVART, ému.
Braves militaires… (Agitant son chapeau.) Vive l’armée !…
Scène XV
Les Mêmes, MADAME FAVART,Les Soldats.
N°22 – CHŒUR.
Vive, vive Favart,
La reine de son art !
A sa grâce, à ses charmes,
Il faut rendre les armes,
Vive, vive Favart !
Madame Favart descend du théâtre et court à son mari.
MADAME FAVART.
Ah ! Charles !… Charles !… (Se jetant dans les bras de Favart.) soutiens-moi… Je me sens mourir !…
FAVART.
Eh bien ! qu’est-ce que c’est ?… Tu pleures !
MADAME FAVART.
C’est de joie et de plaisir !… Oh ! je suis bien heureuse, va !…
PONTSABLÉ.
Bravo ! madame, bravo !… Mais si vous triomphez d’un côté… (Montrant Hector et Suzanne.) moi, je triomphe de l’autre…
MADAME FAVART, étonnée, à Hector et à Suzanne.
Quoi !… Vous ici !…
SUZANNE.
Hélas !…
HECTOR.
On nous a rattrapés !…
PONTSABLÉ, montrant le papier qu’il tient à la main.
Et voici mes ordres… La prison pour ces messieurs-dames… Soldats, assurez-vous de leurs personnes…
Des soldats s’emparent des Favart.
PONTSABLÉ,
Et voilà comment triomphe la justice.
FAVART.
Quoi ? Mais ça ne se termine quand même pas comme ça !
PONTSABLÉ.
Rideau !
Le rideau commence à se refermer, Offenbach arrive alors sur le plateau et fait signe de rouvrir le rideau.
OFFENBACH.
Non, non, attendez ! (le rideau se rouvre)
PONTSABLÉ.
Quoi encore ?
Offenbach fait entrer un soldat avec un bouquet.
OFFENBACH au soldat.
Eh bien allez-y, vous !
UN SOLDAT, présente le bouquet à madame Favart.
De la part de Sa Majesté !…
FAVART.
Oh oh, un coup de théâtre !
MADAME FAVART.
Il est superbe… (Tirant un pli du bouquet.) Un billet !… Oh, il est du roi ! « Madame, vous fûtes divine, vous avez ravi en ce jour nos yeux royaux et nos royales oreilles ».
FAVART.
Et il n’y a pas aussi un petit compliment pour l’auteur ?
MADAME FAVART
Un instant, il y a un second billet !… (Elle l’examine. Triomphante, à Pontsablé 🙂 Tiens donc. Monsieur, je vous informe que vous n’avez plus le droit de donner des ordres…
PONTSABLÉ.
Comment ?
MADAME FAVART, lui tendant le billet.
Tenez, lisez… Le roi accepte votre démission…
PONTSABLÉ, stupéfait.
Accepte… Mais je ne l’avais pas donnée…
MADAME FAVART.
Sa Majesté a pensé que vous aviez besoin de repos… (Riant.) Et franchement, je crois qu’Elle a bien raison…
PONTSABLÉ, douloureusement.
Oh ! ma tête…
HECTOR et SUZANNE, saisissant les mains de madame Favart.
Ah ! Madame…
Offenbach s’approche discrètement et ajoute un 3ème billet dans le bouquet.
FAVART, regardant faire Offenbach.
Mais… il y a encore autre chose !… Peut-être enfin quelque louange pour l’auteur.
MADAME FAVART, tirant du bouquet un nouveau pli.
Ah ! voyons !…
COTIGNAC, gaîment.
Ce n’est pas un bouquet… c’est une boîte aux lettres !…
MADAME FAVART, qui a lu, à Favart.
C’est pour toi. Le roi t’accorde le privilège de l’Opéra-Comique… Voilà le brevet !
FAVART.
Bravo !… Eh bien je t’engage comme premier sujet !…
PONTSABLÉ, à madame Favart.
Madame, vous êtes un démon !…
FAVART, fièrement.
Un ange, monsieur.
MADAME FAVART, souriant.
Ni l’un ni l’autre… une femme seulement… (A Pontsablé.) Et c’était bien suffisant pour vous vaincre.
PONTSABLÉ.
Elle est idéale !…
N° 23 – FINAL.
MADAME FAVART, au public.
De Favart, cett’femme d’esprit,
Ce soir j’ai pris l’habit.
Je n’sais comment ça s’fit !
Je tremblais fort, mais on m’a dit :
L’public te f’ra crédit,
Courage, ma fille,
Vendange, grappille !
Dans ma tâch’si j’ai réussi,
Puiss’-t-on dire en sortant d’ici
Faisant le geste d’applaudir.
Voilà comment ça s’fit !…
MADAME FAVART, accompagnée des autres Mme Favart
De Favart, cett’femme d’esprit,
Ce soir j’ai pris l’habit.
Je n’sais comment ça s’fit !
Je tremblais fort, mais on m’a dit :
L’public te f’ra crédit,
Courage, ma fille,
Vendange, grappille !
Dans ma tâch’si j’ai réussi,
Puiss’-t-on dire en sortant d’ici
Faisant le geste d’applaudir.
Voilà comment ça s’fit !…
CHŒUR FINAL
Après la guerre,
Le militaire
Etc., etc.
Le rideau baisse.
FIN