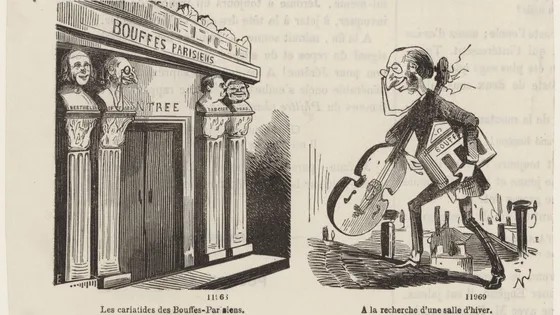Télécharger la version pdf
Livret d’Hector Crémieux et Ludovic Halévy
Adaptation d’Emmanuel Ménard
Musique de Jacques Offenbach
PERSONNAGES
-
L’Opinion publique, soprano
-
Eurydice, soprano
-
Orphée, tenor
-
Aristée-Pluton, tenor
-
Jupiter, baritone
-
John Styx, tenor
-
Vénus, soprano
-
Cupidon, mezzo soprano
-
Mars, baryton
-
Diane, soprano
-
Junon, soprano
-
Mercure, tenor
-
Un Licteur (prologue), tenor
-
Un huissier (tableau 3), parlé
-
Minos, tenor
-
Eaque, tenor
-
Rhadamante, baryton
-
Cerbère x3 parlé
Acte I
PROLOGUE
N°1 CHOEUR DES BERGERS ET SCENE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les Bergères
Voici la douzième heure, que chacun retourne en sa demeure
Allons, rentrons nos blancs moutons.
Les Bergers
Voici la douzième heure, retournons en notre demeure
Allons, rentrons nos blancs moutons
Un Licteur
Place, place au conseil municipal qui passe, qui passe.
Tous
Place, place!
Entrée du conseil municipal
Le Conseil
Conseil municipal de la ville de Thébes,
nous sommes les gardiens du bonheur pastoral,
nous soignons les enfants, dirigeons les éphèbes,
bref, nous sommes un bon conseil municipal.
Le Choeur
Honneur, honneur à nos doyens !
Honneur, honneur à nos anciens !
Le Conseil
Merci merci, mes chers enfants,
vos anciens de vous sont contents.
Le Choeur
Honneur, honneur à nos doyens !
Honneur, honneur à nos anciens !
Le Conseil
Vos anciens de vous etc.
(L’Opinion Publique paraît )
Un Licteur
(Parlé) L’Opinion Publique !
L’Opinion Publique
(Parlé) Qui je suis ? – du théâtre antique
J’ai perfectionné le choeur,
Je suis l’opinion publique,
Un personnage symbolique,
Ce qu’on appelle un raisonneur.
Le choeur antique en confidence
Se chargeait d’expliquer aux gens
Ce qu’ils avaient compris d’avance,
Quand ils étaient intelligents.
Moi, je fais mieux. J’agis moi-même ;
Et prenant part à l’action,
De la palme ou de l’anathème
Je fais la distribution.
Que prenne garde à moi la femme
Qui voudrait tromper son époux,
Et que se garde aussi l’époux
Qui ferait des traits à sa femme !…
C’est aux personnages du drame
Que je parle, rassurez-vous !
Voici venir notre Eurydice ;
Je pars : mais je suis toujours là,
Prêt à sortir de la coulisse,
Comme un deus ex machina !
L’Opinion exit.
Le Conseil
Conseil municipal de la ville de Thébes,
nous sommes les gardiens du bonheur pastoral,
nous soignons les enfants, dirigeons les éphèbes,
bref, nous sommes un bon conseil municipal.
Scène 1
N°2 COUPLETS DU BERGER JOLI
Eurydice
La femme dont le coeur rêve
N’a pas de sommeil ;
Chaque jour elle se lève
Avec le soleil.
Le matin de fleurs plus belles
Les prés sont brodés :
Mais ces fleurs, pour qui sont-elles ?
Vous le demandez ?
Pour qui ?
N’en dites rien à mon mari,
Car c’est pour le berger joli
Qui loge ici.
Chaque jour ainsi j’apporte,
Au berger galant,
De beaux bleuets, qu’à sa porte
J’accroche en tremblant,
Et mon pauvre coeur palpite,
A bonds saccadés…
Pour qui donc bat-il si vite ?
Vous le demandez ?
Pour qui ?
N’en dites rien à mon mari,
Car c’est pour le berger joli
Qui loge ici.
Orphée paraît par l’ascenseur.
Scène 2
Eurydice
Il est sorti !… je veux qu’en rentrant il trouve son studio semé de fleurs.
Orphée
Que vois-je !… n’est-ce pas la nymphe Nabila, la belle nymphe que j’adore ? Seule.
Révélons ma présence par ce trait qu’elle aime tant.
Eurydice
Mon mari !…
Orphée
Ma femme !… imbécile !… dépêchons-nous de crier avant qu’elle ne commence… ah ! Je vous y prends, Madame.
Eurydice
A quoi, je vous prie ?
Orphée
A quoi ?… Mais à qui donc apportiez-vous ces fleurs, s’il vous plaît ?
Eurydice
Ces fleurs ?… euh… au vent, au bonheur !… et vous, mon tendre ami, à qui jetiez-vous ce chant passionné de votre… crin-crin ?
Orphée
Euh… aux muses…
Eurydice
Fort bien ! Savez-vous ce que je conclus de tout cela, mon bon chéri ?… C’est que si j’ai mon berger, vous avez votre bergère… eh bien ! Je vous laisse votre bergère, laissez-moi mon berger.
Orphée
Allons ! Madame, cette proposition est de mauvais goût !…
Eurydice
Pourquoi donc, je vous prie ?
Orphée
Parce que… parce que… tenez ! Vous me faites rougir !
Eurydice
Ah ! Mais, c’est qu’il est temps de s’expliquer, à la fin ! Il faut qu’une bonne fois je vous dise votre fait, maître Orphée, mon chaste époux, qui rougissez ! Apprenez que je vous déteste ! Que j’ai cru épouser un artiste et que je me suis unie à l’homme le plus ennuyeux de la création. Vous vous croyez un aigle, parce que vous avez inventé les vers hexamètres !… Mais c’est votre plus grand crime à mes yeux !… Est-ce que vous croyez que je passerai ma jeunesse à vous entendre réciter des songes classiques et racler votre exécrable instrument ?…
Orphée
Mon violon !… Ne touchez pas cette corde, madame !
Eurydice
Il m’ennuie, comme vos vers, votre violon !… Allez charmer de ses sons les bergères de troisième ordre dont vous raffolez. Quant à moi, qui suis fille d’une nymphe et d’un demi-dieu, il me faut la liberté et la fantaisie !… J’aime aujourd’hui ce berger, il m’aime ; rien ne me séparera d’Aristée !
N°3 : DUO DU CONCERTO
Orphée
Ah ! C’est ainsi ?
Eurydice
Oui, mon ami.
Orphée
Tu me trompes, comme mari ?
Eurydice
Oui, mon ami !…
Orphée
Tu me dédaignes, comme artiste !
Eurydice
Oui, mon ami !
ORPHEE
Tu n’aimes pas le violoniste !
Eurydice
Non, mon ami !
Le violoniste
Me paraît triste,
L’instrumentiste
Est assommant,
Et l’instrument
Me déplaît souverainement.
Orphée
Ah ! De ton insolence
Je vais tirer vengeance.
Eurydice
Et comment, je vous prie ?
Orphée
Je vais, ma tendre amie,
Vous jouer aussitôt
Une oeuvre de génie :
Mon dernier concerto.
Eurydice
Grâce, je t’en supplie…
Orphée
Non, non, pas de retard,
C’est le comble de l’art :
Il dure une heure un quart !
Eurydice
Miséricorde, une heure un quart !
Je n’écouterai pas.
Orphée
Si, tu m’écouteras.
Eurydice se bouche les oreilles avec désespoir.
Ensemble
Orphée
C’est adorable,
C’est délectable,
C’est ravissant,
C’est entraînant.
Eurydice
C’est déplorable,
C’est effroyable,
C’est assommant,
C’est irritant.
Orphée
Ecoutez encor ce motif
Charmant, langoureux, expressif.
Quel charmant concerto !
Eurydice
Ah ! C’est horrible,
Ah ! C’est terrible.
Orphée
Quel tremolo !
Presto, presto, largo, largo,
Pizzicato… amoroso….agitato….
Eurydice
Ah, seigneur, Ah! quel supplice
C’est fini le voilà parti!
O Vénus, sois-moi propice !
Délivre-moi de mon mari.
(parlé)
Vénus, ma belle déesse, délivre-moi de mon aimable Orphée,
Et je t’immolerai dix brebis plus blanches que le lait !
Orphée
Jupiter, mon maître, délivre-moi de ma tendre Eurydice, et je chanterai tes louanges sur ma lyre à quatre cordes.
(à Eurydice.) Madame, je ne me fais aucune illusion sur le sort qui m’attend ! Quand une femme en est arrivée à ce degré d’audace, il est parfaitement inutile d’essayer de la remettre dans la bonne voie…
Eurydice
A la bonne heure ! Séparons-nous donc !
Orphée
Je le ferais de bon coeur, si cela ne devait pas nuire à ma considération et à la position que je me suis faite par mon talent et mon travail. Je suis esclave de l’opinion publique : c’est ma seule faiblesse, laissez-la-moi. J’ai besoin du Monde… et de Star Inside…, je ne veux pas les heurter.
Mais je me suis mis en tête de pourfendre chacun de vos adorateurs…
Eurydice
Avec votre archet ?
Orphée
Non, madame. Je crois inutile de vous apprendre le moyen que j’ai choisi pour attraper le maraudeur…
Qu’il vous suffise de savoir ceci : je ne lui conseille pas de fouiner dans les herbes que voilà, comme il le fait habituellement.
Eurydice
Et qui l’en empêchera ?
Orphée
Qui ?… certaine surprise que j’y ai semée à son intention…
Eurydice
Que voulez-vous dire ?
Orphée
Rien de plus ! Je vais travailler à mes prochaines compositions… Adieu, bibiche… Petite surprise semée pour lui, là… Faites attention… adieu !
Il sort.
Scène 3
Eurydice
Que veut-il dire avec sa petite surprise semée dans les herbes ?… C’est que ce vilain homme est capable de tout !… Quelque piège peut-être ! Et Aristée qui vient piocher dans ces herbes avant de folâtrer avec moi ! Courons au-devant de lui !… Le malheureux se ferait faire du mal !… Courons !…
Elle s’engouffre dans le studio. Au même instant, Aristée paraît.
Scène 4
ARISTEE
N°5 CHANSON D’ARISTEE
Récitatif.
Moi, je suis Aristée, un berger d’Arcadie,
Un fabricant de miel, ivre de mélodie,
Sachant se contenter des plaisirs innocents
Que les dieux ont permis à l’habitant des champs !
Voir voltiger sous les treilles,
Entre terre et ciel,
Les essaims de mes abeilles
Butinant leur miel ;
Voir le lever de l’aurore,
Et, chaque matin,
Se dire : je veux encore
Le revoir demain.
Voilà la fête
D’une âme honnête,
Le vrai bonheur
D’un tendre coeur !
Ah ah !
Voir bondir dedans la plaine
Les petits moutons,
Accrochant leur blanche laine
A tous les buissons !
Voir sommeiller la bergère,
Tandis qu’à pas lents,
Le berger qu’elle préfère
Vient et la surprend !
Voilà la fête
D’une âme honnête,
Le vrai bonheur,
Du coeur !
Ah ah!
(Parlé, regardant avec précaution autour de lui.)
Voilà ce que je dis aux personnes, ce que je dis devant le monde, pour inspirer de la confiance !… Mais si vous saviez qui je suis en réalité, et quels projets infernaux je médite !… Si l’idée que j’ai soufflée à Orphée réussit, je crois que c’est aujourd’hui que nous frapperons un grand coup ! Voici la tendre Eurydice !
EURYDICE (revenant)
Ah! Le voici ! J’arrive à temps !
Aristée, mon beau berger, prends garde ! Ne bouge pas !
ARISTÉE
Comment, ne bouge pas !
EURYDICE
Aristée ! Au nom de mon amour, n’approche pas !
ARISTÉE
Comment ?
EURYDICE
Mon mari sait tout ! Il nous aura espionnés ! Et il a semé des pièges dans ces herbes, des serpents, peut-être.
ARISTÉE (à part)
Est-il bête, l’animal ! Il veut me surprendre et il me fait prévenir ! Réparons sa maladresse. (haut) Allons donc ! Regarde comme je me moque de ses reptiles, regarde
(Il fourrage dans les herbes.)
EURYDICE
Aristée ! Ton amour et ton courage t’emportent ! Aristée ! Tu cours à la Mort !
ARISTÉE
Il n’y a pas de danger !
EURYDICE
Eh bien, alors, je veux mourir avec toi !
ARISTÉE
(Plongeant les mains d’Eurydice dans les herbes)
Allons donc!
EURYDICE
Aïe !
ARISTEE
Ca y est !…
EURYDICE
Mon dieu, qu’est-ce que j’éprouve ?
ARISTEE
Pluton, redeviens toi-même ! Une ! Deux ! Trois ! (Ses trois sbires apparaissent, le débarrassant de son costume de berger et lui donnant ses vêtements de dieu des enfers.) Et maintenant, désorganisons les éléments (la lumière baisse brusquement. Déçu du résultat). Chez moi, voilà comme on désorganise les éléments.
EURYDICE
Dieu puissant ! Est-ce que je vais mourir ?
ARISTEE
Entièrement !… lasciate ogni speranza !…
EURYDICE
Et cependant je ne souffre pas…
ARISTEE, bas.
Je t’expliquerai pourquoi…
EURYDICE
C’est étrange !…
ARISTEE
C’est logique…
N°6 INVOCATION A LA MORT
EURYDICE
I
La mort m’apparaît souriante
Que vient me frapper près de toi…
Elle m’attire, elle me tente…
Mort, je t’ appelle… emporte-moi ! ..
II
Mort, ton ivresse me pénètre !
Ton froid ne me fait pas souffrir ;
Il semble que je vais renaître,
Oui, renaître, au lieu de mourir !…
Adieu !… adieu !…
ARISTEE
Crac !… ça y est !… une larme !… une larme ! Et partons ! Avant de partir, abusons de notre divinité pour jeter un dernier défi au mari… (Il fait signe vers Eurydice, qui se redresse comme une somnambule. Pluton guide ses bras comme un marionnettiste et la fait écrire.)
Je quitte la maison
Parce que je suis morte,
Aristée est Pluton,
Et le diable m’emporte.
Pluton baisse les bras, Eurydice s’effondre.
La rime n’est pas riche !… mais la richesse ne fait pas le bonheur ! Et maintenant, aux sombres bords !
Il disparaît.
Scène 5
Orphée, rentrant par l’ascenseur
Ah ça ! Que diable y a-t-il donc de dérangé là-haut ? Je reviens à peine de répétition et j’arrive déjà en pleine nuit ! Je n’ai pas encore dîné, et voici déjà l’heure du souper. Que veut dire cette perturbation ? A moins qu’il n’y ait une éclipse ?
Par Jupiter !… que veut dire ceci ?… l’écriture de ma femme !… (il lit.)
Je quitte la maison
Parce que je suis morte,
Aristée est Pluton,
Et le diable m’emporte.
(Il s’effondre)
Comment, elle est morte !… ce n’est pas possible ! Mais si !… elle est bien morte !… puisqu’elle l’écrit elle-même !
Oh merci !… Merci, Jupin !… (il regarde avec inquiétude autour de lui) Quelqu’un !… mais non, personne !… je puis me livrer à ma joie !!!
Scène 6
N°7 FINALE
Orphée
Libre ! ô bonheur ! ô joie extrême !
Courons apprendre ce bonheur à la nymphe que j’aime !
Le Choeur
Anathème, anathème, sur celui qui sans pitie, anathème, anathème, refuse une larme même à sa moitié.
Orphée
Etranges cris !
Le Choeur
Anathème, etc.
Orphée
Encore ces voix ! De tous les côtés à la fois ! Quel phénomène d’acoustique !
Le choeur
Anathème, etc.
L’Opinion (paraît)
Arrière !… ça ne se passera pas comme ça !…
Orphée
Ciel ! L’opinion publique qui me poursuit déjà.
Choeur
Ciel ! L’opinion publique qui le poursuit déjà.
L’Opinion
C’est l’Opinion publique
Qui proclame ce qu’elle sait
Qui peut dans un sentier oblique
Saisir la trace d’un forfait.
Qui dit à la main sacrilège
Dans les blés tu semas le piège
Halte-là!
Ca n’peut pas s’passer comme ça!
Choeur
Ca n’peut pas s’passer comme ça!
L’Opinion
Epoux indigne, ma colère
Te suivra de toutes façons.
Je veux te mettre en la misère,
Te faire perdre tes leçons.
Et, du crépuscule à l’aurore,
Troublant tes nuits, crier encore
Halte-là!
Ca n’peut pas s’passer comme ça!
Choeur
Ca n’peut pas s’passer comme ça!
L’Opinion
Viens! A l’opinion c’est en vain qu’on résiste
Choeur
Pars! A l’opinion c’est en vain qu’on résiste
Orphée
Grâce!
L’Opinion
Pour te soustraire à ma sévérité
Et pour servir d’exemple à la postérité
Un seul moyen te reste
Orphée
Et lequel, dis?
L’Opinion
Bédam, c’est de courir après ta femme
Orphée
Mais je ne l’aime pas!
L’Opinion
L’exemple à tous yeux
N’en sera que plus glorieux
Orphée
Fut-il jamais un sort plus triste!
L’Opinion
Cours, cours après ta femme
Choeur
Cours, cours après ta femme
Orphée
A ton implacable voix
Il faut céder, je le vois.
L’Opinion
Allons, c’est le moment.
LE CHOEUR
Allons, c’est le moment.
Ensemble
L’Opinion
Viens ! C’est l’honneur qui t’appelle !
Et l’honneur passe avant l’amour !
Je serai ton guide fidèle
Pendant l’aller et le retour !
Orphée
Viens ! C’est l’honneur qui m’appelle,
Et l’honneur passe avant l’amour !
Je maudis le guide fidèle
Qui me suivra jusqu’au retour.
Acte II
Scène 1
No. 8 ENTR’ACTE ET CHOEUR DU SOMMEIL
Les Dieux
Dormons, que notre somme
Ne vienne jamais à finir.
Puisque le seul bonheur, en somme,
Dans notre olympe, est de dormir.
Ron, ron.
N° 9 COUPLETS
Vénus entre à petits pas.
Vénus
Je suis Vénus ! et mon amour a fait l’école buissonnière !
Je reviens au lever du jour d’un petit voyage à Cythère !
Un profond mystère cache mon retour ils dorment tous !
Endormons-nous !
A son tour, Cupidon entre sur le pointe des pieds.
Le Choeur (endormi)
Ah!
Cupidon
Je suis Cupidon mon amour a fait l’école buissonnière!
Je reviens au lever du jour d’un petit voyage à Cythère!
Un profond mystère cache mon retour!
Ils dorment tous!
Endormons-nous!
Paraît Mars qui entre discrètement.
Le Choeur (endormi)
Ah!
Mars
Je suis le dieu Mars, à mon tour je viens d’chez ma particulière,
Et je rentre au lever du jour d’un petit voyage à Cythère.
La p’tit cantinière cache mon retour dans mon nuage,
J’m’en vas filer, car la consigne est de ronfler.
Le Choeur (endormi)
Ah!
Scène 2
N° 11 REVEIL DES DIEUX ET COUPLETS DE DIANE
Cor de Diane
Jupiter,
Par Saturne ! Quel est ce bruit
Qui nous réveille au milieu de la nuit ?
(décrochant son propre portable ) C’est Diane, ma fille chérie,
Qui nous sonne sa sonnerie !
Sus ! Qu’on se réveille à l’instant !…
Les Dieux, se réveillant en bâillant
Han ! Han ! Han ! Han !
Jupiter
Et surtout pas de bâillement !
D’un cri de joie et d’allégresse,
Il faut saluer la déesse ;
Obéissons au règlement !
Entre Diane, d’un air pensif et affligé, accompagnée de Junon.
Les Dieux
Salut à Diane chasseresse !
Vénus
Mais pourquoi cet air de tristesse ?
Diane
Ah ! Rien n’égale mon tourment !
Couplets.
I
Quand Diane descend dans la plaine,
Tontaine, tontaine,
C’est pour y chercher Actéon,
Tontaine, tonton !
C’est près d’une claire fontaine,
Tontaine, tontaine,
Que Diane rencontre Actéon,
Tontaine, tonton !
Les Dieux (tous)
Que Diane rencontre Actéon,
II
Diane
Or, ce matin, dedans la plaine,
Tontaine, tontaine,
Je m’en fus chercher Actéon,
Tontaine, tonton !
Mais hélas ! Près de la fontaine,
Tontaine, tontaine,
Point n’est venu mon Actéon,
Tontaine, tonton !
Les Dieux (tous)
Point n’est venu son Actéon
Diane
Pauvre Actéon ! Qu’est-il devenu ? Lui qui était là tous les jours, caché sous un buisson, pendant que… ah ! Je le voyais très bien !
Jupiter
Ce qu’il est devenu ? Je vais te le dire ! Tout ça était immoral dans la forme ! Tu te compromettais avec ce jeune homme ! Je me suis débarrassé de lui !
Diane
Et comment ?
Jupiter
Je l’ai changé en cerf ! Et pour sauver ta réputation, ô ma chaste Diane, j’ai répandu le bruit, parmi les faibles mortels, que c’était à ta demande que j’avais ainsi désorganisé Actéon ; j’ai dit que tu avais trouvé sa curiosité indiscrète…
Diane, vivement
Mais non !
Jupiter
Je l’ai dit pour l’honneur de la mythologie ! Corbleu ! Mes enfants, les faibles mortels ont l’oeil sur nous ! Sauvons les apparences au moins! Sauvons les apparences ! Tout est là !
Diane
Vous les sauvez bien, vous !
Junon
Est-ce qu’il a encore fait quelque nouvelle escapade ?
Jupiter
Mais non, ma bonne Junon, de la réserve !… pas de scène devant le monde !… Je vous en prie, mes enfants, de la tenue !.
Allons ! Que chacun aille à sa besogne, en attendant l’heure de savourer le nectar et l’ambroisie… (départ du choeur en grognant) Et que personne ne manque au déjeuner… allez ! J’ai entendu des rumeurs ? Voilà déjà plusieurs fois que je m’aperçois… (il se tourne et s’aperçoit qu’il est seul avec Junon, les autres sont partis)
Par ma foudre !… on a du mal à mener ces gaillards-là… Et il faut encore que j’aie la jalousie de ma tendre épouse… quel crampon ! Eh bien, qu’est-ce qu’il y a ?…
Junon
Il y a que je ne puis plus vivre ainsi !… et que l’existence que vous me faites…
Jupiter
Qu’est-ce que j’ai encore fait, voyons ?…
Junon
Ah !… n’essaye pas de me tromper… Les bruits de la terre montent jusqu’à moi…
Jupiter
Mais encore…
Junon
Eh bien !… Il n’est bruit là-bas que de la disparition d’une mortelle, belle comme une déesse, et qui vient d’être enlevée par un dieu… Cette femme s’appelle Eurydice… Et le dieu !… c’est vous.
Jupiter
Moi ?…
Junon
Et quel autre que vous eût osé ?…
Jupiter
Vois, mon amie, où t’entraîne ton aveugle passion !… Cet enlèvement, je le connais comme toi…
Junon
Je le crois.
Jupiter
J’ai envoyé aux renseignements mon fidèle Mercure… et si mes soupçons sont fondés, tu verras bientôt qu’un dieu qui punit, comme j’entends le faire, les escapades des autres, ne peut qu’être le mari le plus fidèle, le plus constant…
Junon
Je ne vous crois plus, gros hypocrite !… vous m’avez tant de fois trompée !…
Jupiter
Allons, bon !… c’est comme tu voudras !… Que veux-tu que je te dise ?… Tiens !… j’entends le clapotement des ailes de Mercure… Ecoute et juge-moi !…
Scène 3
N° 12. RONDO SALTARELLE DE MERCURE
Mercure
Eh hop! Eh hop! Place à Mercure!
Ses pieds ne touchent pas le sol,
Un bleu nuage est sa voiture, rien ne l’arrête dans son vol.
Bouillet dans son dictionnaire vous dira mes titres nombreux :
Je suis le commissionnaire et des déesses et des dieux ;
Pour leurs amours moi je travaille, actif, agile, intelligent,
Mon caducée est ma médaille, une médaille en vif argent.
Eh hop! Eh hop! Place à Mercure!
Ses pieds ne touchent pas le sol,
Un bleu nuage est sa voiture, rien ne l’arrête dans son vol.
Je suis le dieu de l’éloquence, les avocats sont mes enfants,
Ils me sont d’un secours immense pour flanquer les mortels dedans.
Je dois comme dieu du commerce détester la fraude et le dol,
Mais je sais par raison inverse les aimer comme dieu du vol,
Car j’ai la main fort indirecte et quelquefois le bras trop long :
Quand il était berger d’Admète j’ai chipé les boeufs d’Apollon.
Tout en étant le dieu des drôles, je suis le plus drôle des dieux,
J‘ai des ailes sur les épaules, aux talons et dans les cheveux.
Jupin mon maître sait me mettre à toute sauce,
Il finira par me mettre dans un baromètre
Pour savoir le temps qu’il fera.
Junon
Pour savoir le temps qu’il fera.
Mercure
Eh hop!
Jupiter
Eh hop!
Mercure, Junon et Jupiter
Eh hop ! Eh hop ! Place à Mercure, etc.
Mercure
Salut au puissant maître des cieux et de la…
Jupiter
Pas de phrase ! Au fait !
Mercure
Seigneur, j’arrive en droite ligne des enfers !
Jupiter
Et Pluton ?
Mercure
Pluton était sorti !… Il est rentré aux enfers il y a une heure !
Jupiter
Seul ?…
Mercure
Non pas ! Mais avec une jolie petite femme qu’il venait d’enlever à son mari !…
Jupiter
Cette femme a pour nom?
Mercure
Eurydice…
Jupiter, à Junon
Là ! Je ne le lui fais pas dire ! Ah ! Le coquin de Pluton !… et il va venir ?…
Mercure
A l’instant… je lui ai dit que vous l’attendiez ! Le voilà !…
Jupiter
Eh bien ! Je vais le traiter comme il le mérite !…
Scène 4
Pluton (entrant accompagné de ses 3 sbires)
Salut au puissant maître des cieux et de…
Jupiter
Assez !… assez !… je te fais grâce de la formule !…
N°13 : AIR EN PROSE DE PLUTON
Pluton, à part
Comme il me regarde !… Est-ce qu’il se douterait !…
Détournons les soupçons !… flagornons-le !…
Ayons l’air de trouver son domicile agréable…
J’ai justement une vieille tirade que j’ai lue quelque part…
(haut.) Ah ! Avec quelle volupté je m’enivre des suaves émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l’Olympe ;
Heureuses divinités qui folâtrez sans cesse sous des cieux toujours bleus,
Tandis que je suis condamné aux sombres cloaques du royaume infernal !…
Ici l’on respire une odeur de déesse et de nymphe,
Une suave odeur de myrte et de verveine, de nectar et d’ambroisie.
On entend le roucoulement des colombes,
Les chansons d’Apollon et la lyre de Lesbos !…
Voici les nymphes !… voici les muses !… les grâces ne sont pas loin !…
Vous les verrez danser, calmes et bondissantes,
Aux douces clartés de la lune d’avril !…
On entend le roucoulement des colombes,
Les chansons d’Apollon et la lyre de Lesbos !…
Tous les parfums sont déchaînés, et les parfums de la nuit,
Et les parfums du jour, et les parfums du ciel,
Et les parfums des grâces, et les parfums des muses,
Et les parfums des nymphes !…
Jupiter
As-tu bientôt fini, avec ta parfumerie ?
Pluton
On chantera jamais trop votre bonheur !
Jupiter
Laissons cela ! Il paraît, mon bonhomme, que tu te conduis comme le dernier des drôles !
Pluton
Seigneur !
Jupiter
Tu as abusé de ton pouvoir en enlevant par la mort une épouse à son époux.
Pluton
Ce n’est pas vrai !
Jupiter
Ne nie pas ! Je sais tout !
Pluton
Ce n’est pas vrai !
Jupiter
Silence !… quand je parle, on se tait !
On entend des cris au dehors.
Pluton narquois
Ça n’est pas ce que j’appelle se taire, ça.
Jupiter
Une révolte !
Scène 5
N° 14. CHOEUR DE LA RÉVOLTE
Diane, Vénus, Cupidon et le Choeur des dieux
Aux armes ! Dieux et demi-dieux !
Abattons cette tyrannie,
Ce régime est fastidieux !
Plus de nectar ! Plus d’ambroisie !
Aux armes! Aux armes!
Jupiter
Une révolte, vraiment c’est curieux!
Pluton à part
Une révolte chez les dieux !
Sur mon âme, elle arrive au mieux !
Les Déesses et Cupidon
Plus de nectar! plus d’ambroise !
Plus de nectar, cette liqueur fait mal au coeur… oui, mal au coeur !
Assez de sucre et d’ambroise !
Plus d’ambroisie !
Pluton
lls ont raison ! Ces aliments sont fades !
Parlez-moi de ceci, de ceci, camarades !
Les sbires brandissent des bouteilles de champagne
Diane, Vénus, Cupidon et le Choeur des dieux
Aux armes ! dieux et demi-dieux !
Abattons cette tyrannie !
Ce régime est fastidieux ! etc.
Jupiter
Silence, ou je tonne !
Alors c’est une sédition! On refuse obéissance!
Tous
Oui ! Oui ! Oui !
Jupiter
Et la morale ?
Pluton
Il faudrait pourtant s’entendre sur ta morale !
Tu en as fait bien d’autres, toi, mon petit père !
Jupiter
Moi ? Jamais ! bon époux, bon père
Pluton
Ah oui ! Parlons-en de tes qualités domestiques !
Tu me reproches ce que j’ai fait !
Si on rappelait ce que tu as fait, toi !
Diane
Laisse donc! Moi Diane, j’en sais sur ton compte !
Vénus
Et moi, Venus !
Cupidon
Et moi, Cupidon !
Tous
Et nous donc !
Cupidon
Nous avons fait des chansons là-dessus !
Pluton
Tu l’entendras !
Tous
Tu l’entendras !
Junon
Ce sera ta punition !
Scène 6
N° 15. RONDEAU DES METAMORPHOSES
DIANE
Pour séduire Alcmène la fière
Tu pris les traits de son mari !
Je sais bien des femmes sur terre
Pour qui ça n’eût pas réussi!
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus l’air patelin :
On connaît tes farces, Jupin !
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus l’air patelin,
On te connaît Jupin!
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
MINERVE
Est-ce de la même enveloppe
Que tu te servis de nouveau,
Lorsque, pour enlever Europe,
Tu pris les cornes d’un taureau ?
Ah ! Ah ! Ah !
Etc., etc., etc.
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
CYBELE
A Danaé, ton adorée,
En pluie, un jour, tu te montras ;
POMONE
Mais cette pluie était dorée :
Ça lui plut et tu l’adoras.
CYBELE ET POMONE
Ah ! Ah ! Ah !
Etc., etc., etc.
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
VÉNUS
Ce cygne traqué par un aigle
que Léda sauva dans ses bras,
c’était encore vous, gros espiègle !
J’étais l’aigle, ne le niez pas !
Ah ! Ah ! Ah !
Etc., etc., etc.
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
FLORE
Tour à tour, bête, homme ou légume,
Tout te fut bon pour t’habiller !…
CERES
Ah ! Quelle note de costume
Tu dus payer ton costumier !
FLORE ET CERES
Ah ! Ah ! Ah !
Etc., etc., etc.
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
Pluton
Que prouvent ces métamorphoses ?
C’est que tu te trouves si laid
Que pour te faire aimer
tu n’oses te montrer tel que l’on t’a fait !
Ah! ah! ah! etc.
LE CHOEUR
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ne prends plus, etc.
Junon.
Je suis à bout de forces !… Ah ! traître ! ah ! volage !… Va-t’en !… je te hais ! Nous nous séparerons !…
Elle tombe dans les bras de Pluton en poussant des cris.
Jupiter.
L’attaque de nerfs !… je ne pouvais pas l’éviter !…
Pluton.
Prenez-moi donc votre femme !
Jupiter,
Je te jure que c’est avant notre mariage !…
Junon.
Ah !…
Pluton.
Mais prenez donc votre femme !…
Jupiter.
Tout ça, c’est des cancans, de purs cancans !… Je n’ai jamais aimé que toi ! (A Pluton.) Tu n’es qu’un diffamateur, toi, tu n’es qu’une espèce de…
Pluton.
N’achevez pas !… Et prenez donc votre femme ! Elle me gêne !
Mercure
Seigneur, deux étrangers sont là, qui demandent audience!
Jupiter
Leurs noms ?
Mercure
Orphée.
Jupiter (à part)
Orphée ! (à Pluton) Je vais te pincer, Pluton !
Mercure
Il est accompagné de quelqu’un qui se dit l’Opinion Publique.
Jupiter
L’Opinion Publique ! Mes enfants, trêve à nos dissensions intestines !
Pluton
Ne les recevez pas !
Tous
Recevez-les !
Jupiter
(bas, à Pluton) Je vais les recevoir ! (haut) Je vais les recevoir ! Je suis Jupin et je dois la justice à tous! Ah! tu trembles, Pluton!
Scène 7
N° 16. FINALE
Entrent Orphée et l’Opinion Publique.
Pluton
Il approche! Il s’avance!
Le voilà, oui, c’est bien lui!
Ah! sapristi! je commence à bien m’ennuyer ici.
Les dieux
Il approche! il approche!
Le voilà, oui, c’est bien lui !
L’on va prendre ta défense, hélas, trop infortuné mari !
Orphée
C’est malgré moi que j’avance !
Et je suis tout ahur. Ce voyage-là commence
à me donner beaucoup trop d’ennui.
Pluton, Jupiter et Mercure
Le voilà !
DIANE, CUPIDON, VENUS ET LE CHOEUR
Attendons !
PLUTON, JUPITER ET MERCURE
C’est bien lui !
DIANE, CUPIDON, VENUS ET LE CHOEUR
Observons !
ORPHÉE
La vengeance est bien près de moi!
L’OPINION PUBLIQUE
Avance ! Avance ! Obéis-moi !
DIANE, CUPIDON, VENUS ET LE CHOEUR
Regardons, écoutons, oui regardons même écoutons !
Car on va prendre ta défense, trop infortuné mari !
ORPHÉE
La vengeance est bien près de moi !
Dieu! qu’il m’ennuie !
Oui, il m’ennuie ce damné vieillard,
Il commence à me donner de l’ennui.
PLUTON, JUPITER ET MERCURE
Le voilà, c’est bien lui, il approche, il s’avance ! etc.
L’OPINION PUBLIQUE
La vengeance est bien près de toi, obéis-moi, marche toujours !
Crains ma vengeance !
Sinon, crains la vengeance prête à fondre sur toi!
JUPITER
Que me veux-tu, faible mortel ?
L’OPINION PUBLIQUE
Voici le moment solennel !
Tu vas, d’une voix attendrie,
Implorer du grand Jupiter
Le droit de reprendre à l’Enfer
Ton épouse tendre et chérie!
ORPHÉE
Vous le voulez ?
L’OPINION PUBLIQUE
Allons !
ORPHÉE
On m’a ravi mon Eurydice…
DIANE, CUPIDON, VENUS
Rien n’égale son tourment!
DIANE
Rien n’égale sa douleur!
CUPIDON, DIANE, VÉNUS ET LES DÉESSES
Rien n’égale sa douleur!
ORPHÉE
Et le ravisseur…
JUPITER
C’est ?…
ORPHÉE
C’est Pluton !
TOUS
C’est Pluton ! C’est Pluton !
JUPITER
Punissant justement le crime et l’injustice
je condamne Pluton à lui rendre Eurydice!
ORPHÉE (à part)
O ciel ! O ciel ! Il me la rend !
PLUTON (à part)
O ciel ! O ciel ! Il me la prend !
JUPITER
Et pour faire observer ma volonté suprême,
aux Enfers aujourd’hui, Pluton, j’irai moi-même!
LES DIEUX
Aux Enfers!
DIANE, CUPIDON VÉNUS ET MERCURE
Jupin, emmenez-nous avec vous, s’il vous plaît !
Emmenez-nous, Jupin, emmenez-nous avec vous.
JUPITER
Allons, j’emmènerai l’Olympe au grand complet !
LES DIEUX
Vive Jupin !
JUPITER
Venez tous, venez tous !
LES DIEUX
Gloire, gloire à Jupiter,
Gloire à ce dieu clément et doux
Qui pour ce sémillant enfer,
N’a pas voulu partir sans nous !
Partons, partons ! La, la, la, la !
Partons, marchons ! Ah !
Plus de nectar, plus de ciel bleu !
Oh, nous allons donc rire un peu
Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu !
La, la, la, la, la, partons, marchons !
JUPITER
Prenons nos attributs, partons, n’hésitons plus !
LES DIEUX
Prenons nos attributs partons, n’hésitons plus !
TOUS
Merci, merci !
La, la, la, la, partons, partons, etc.
Gloire, gloire à Jupiter, etc.
Tous les dieux sortent, ravis
Acte III
Scène 1
No. 18 COUPLETS DES REGRETS
EURYDICE parlé
Personne encore. Pas de nouvelles.
Ah, ça, mais c’est intolérable ! Je m’ennuie épouvantablement ici !
chanté
Ah! quelle triste destinée
Me fait ici le dieu Pluton !
Me laisser seule abandonnée !
Que veut dire cet abandon ?
Lorsqu’avec lui je suis venue, de tendresse il était pétri !
Ah! mais si cela continue je vais regretter mon mari !
Ah mais oui je vais regretter mon mari!
L’amour des dieux, disait le traître,
contient d’ineffables douceurs!
Je vais te les faire connaître…
Les dieux seraient-ils des lâcheurs ?
Où donc est l’ivresse inconnue que je devais goûter ici ?
Ah! mais si cela continue etc.
parlé
Voilà deux jours que je suis seule, n’ayant d’autre récréation que la compagnie de ce gros bêta de domestique dont on a fait mon geôlier !
Ah! Encore lui !
Scène 2
John Styx s’avance.
JOHN (à part)
Elle est bien belle ! bien belle ! bien belle ! Ah ! si j’osais !
EURYDICE
C’est encore toi ! Que me veux-tu ?
JOHN
Madame n’a pas sonné?
EURYDICE
Moi ? Non !
JOHN
Est-ce que Madame sonnera bientôt ?
EURYDICE
Est-ce que je sais ? Pourquoi ?
JOHN
Parce que si Madame sonnait, je m’empresserais d’accourir.
Ah! je suis bien malheureux !
EURYDICE
Qu’est-ce que cela me fait ?
JOHN
Puisque Madame paraît s’intéresser à moi, je vais tout lui dire.
Figurez-vous, Madame, que je suis la meilleure nature du monde. J’ai un coeur sensible et une tête faible. La femme qui m’aimerait serait bien heureuse !
EURYDICE
Ne m’approche pas ! (à part) Il est affreux !
JOHN
Madame me repousse après un tel aveu ? Ah ! c’est parce que je ne suis qu’un domestique, n’est-ce pas ?
Mais je n’étais par mort pour porter cette livrée, Madame ! Quand j’étais sur terre, j’étais le fils d’un grand prince de Béotie !
N° 19 COUPLETS DU ROI DE BEOTIE
JOHN
Quand j’étais roi de Béotie, j’avais des sujets, des soldats,
Mais un jour, en perdant la vie, j’ai perdu tous ces biens, hélas !
Et pourtant, point ne les envie : ce que je regrette en ce jour
C’est de ne point t’avoir choisie pour te donner tout mon amour !
Quand j’étais roi de Béotie, quand j’étais roi de Béotie !
Si j’étais roi de Béotie, tu serais reine sur ma foi,
Je ne puis plus qu’en effigie t’offrir ma puissance de roi.
La plus belle ombre, ma chérie ne peut donner que ce qu’elle a,
Accepte donc, je t’en supplie, sous l’enveloppe que voilà
Le coeur d’un roi de Béotie, le coeur d’un roi de Béotie.
EURYDICE
Insolent!
JOHN
Voyez-vous il est une chose que je n’oublierai jamais, c’est l’image de la femme adorable dont mon maître m’a donné la garde depuis deux jours…
On entend de nouveau l’air du Roi de Béotie.
EURYDICE
Ah non, pas encore !
JOHN décroche son téléphone dont c’était la sonnerie
Chut, c’est mon maître !
Il amène du monde! (poussant Euyridice vers la porte du cabinet dérobé) Rentrez là, Madame, rentrez là !
EURYDICE
Je ne veux pas !
JOHN
Ce sont les ordres de Monsieur. Vous me feriez flanquer à la porte!
EURYDICE
Mon petit John Styx, je t’en supplie !
JOHN
Non, non ! Rentrez, rentrez !…
EURYDICE
Ah ! Pluton ! Tu me le paieras!
JOHN
Allons, allons ! (Il fait entrer Eurydice au moment où paraissent Pluton et Jupiter.) Il était temps !
Scène 3
Jupiter et Pluton entrent en se bousculant et tâchant de se devancer l’un l’autre.
PLUTON (bas à John)
Eurydice ?
JOHN (bas à Pluton)
Sous clef.
JUPITER
Où est-elle ? Où est-elle ?
JOHN
Qui elle ?
JUPITER
Eurydice ! Par ma foudre, parle !
PLUTON
Eurydice ? Comment, tu crois encore que j ai enlevé cette petite ?
JUPITER
Parfaitement! Et je verrai bien ! j’ai saisi la justice ! Il y a eu enlèvement et tu vas être jugé par les juges des Enfers!
Paraît un huissier.
L’HUISSIER
La Cour !
JUPITER
Les voici !
3ème tableau – scène 4
Minos, Eaque et Rhademante font leur entrée.
N° 20 SEPTUOR DU TRIBUNAL
MINOS, EAQUE et RHADAMANTE
Minos, Eaque et Rhadamante,
Rhadamante, Eaque et Minos,
Sous les yeux de Thémis clémente,
Nous presidons les tribunos les tribunos infernos!
MINOS
Nul n’échappe à notre colère!
RHADAMANTE
Ceux que Minos ne punit pas,
EAQUE
Rhadamante en fait son affaire!
RHADAMANTE
Eaque est là dans tous les cas!
TOUS
Minos, Eaque et Rhadamante
Rhadamante, Eaque et Minos!
Sous les yeux de Thémis clémente.
Tous trois président/Nous présidons les tribunos, les tribunos infernos !
L’HUISSIER
La séance est ouverte!
MINOS (à l’Huissier)
Faites entrer le témoin Cerbère.
PLUTON (à part)
Pourvu qu’il n’aille pas me trahir!
L’HUISSIER (appelant)
Le témoin Cerbère !
Le témoin Cerbère !
Le témoin Cerbère !
Entrent les trois Cerbères.
MINOS
Témoin Cerbère, dans la soirée des Ides de Mars,
EAQUE
le dieu Pluton revenant de la terre,
RHADAMANTE
est-il rentré seul ou avec une femme?
CERBERE
grommellements indistincts, puis aveu d’ignorance
MINOS
Vous l’entendez? Il affirme que Pluton est rentré seul aux Enfers!
JUPITER
Mensonge !
Ah j’enrage ! Ce procès est truqué, les juges sont complices de l’accusé ! Le témoin sont complices de l’accusé ! C’est une parodie de justice ! Ma foudre, que je les foudroie tous ! En poudre! En poudre, tous ces gens-là !
Crépitement et coup de de tonnerre, la lumière baisse. Pluton, John, huissiers, Cerbère, juges, tout le monde se sauve. Apparaît Cupidon.
Scène 5
CUPIDON riant
Ah ah ah !
JUPITER
Tiens, Cupidon!
CUPIDON
Oh! Papa ! Papa ! tu me fais de la peine !
JUPITER
Qu’est-ce qu’il vient faire là, ce méchant galopin ?
CUPIDON
Il vient te sauver, ce méchant galopin !
JUPITER
Me sauver ?
CUPIDON
Tu cherches une femme, non ?
JUPITER
Quoi, mon petit chéri, tu te chargerais ?…
CUPIDON
Il faut donc que je te la rende, ton Eurydice ?
JUPITER
Oh, oui !
CUPIDON
Eh bien on va te la retrouver !
Scène 6
Apparaissent de tous les côtés les acolytes de Cupidon
N° 21. RONDE DES CUPIDONS
CHOEUR DES CUPIDONS
Nez au vent oeil au guet, clairvoyant et discret,
Le limier de l’amour doit veiller nuit et jour.
Aussi fin qu’un renard, très malin,
Peu bavard sachant tout découvrir et partout se blottir!
À l’amant, au mari, apportant son appui,
Il surprend tous les jours plus de cent jolis tours.
Nez au vent, etc.
N° 22. RECIT ET COUPLETS DES BAISERS
CUPIDON
Attendez, j’ai mon moyen!
JUPITER ET LES CUPIDONS
Voyons, voyons ton moyen!
CUPIDON
Attendez, attendez!
JUPITER ET LES CUPIDONS
Voyons, voyons le moyen.
CUPIDON
Pour attirer du fond de sa retraite
Une souris qui cache son museau
Non loin du nez de la petite bête,
Il faut semer quelque friand morceau.
Je sais un autre stratagème
Qui doit faire de son réduit
Sortir une femme qu’on aime :
Ce stratagème, c’est un bruit ;
mais il faut que ce joli bruit
Soit bien mignon et bien gentil !
Ah! (imitant le bruit des baisers.)
Allez-y, la p’tit’ bête va répondre au bruit,
la p’tit’ bête va répondre au bruit!
LES CUPIDONS imitent les baisers
Allez-y la p’tit’ bête, etc.
CUPIDON
Lorsque l’on veut attirer l’alouette,
On fait briller un miroir à ses yeux
Et sans retard on voit la coquette
En voltigeant accourir à ses feux !
Une femme, c’est tout de même,
Par ses faiblesses qu’on la séduit ;
Tout ce qu’elle veut, c’est qu’on l’aime
Et c’est ainsi qu’on le lui dit,
Mais il faut que cela soit dit
D’un air bien mignon bien gentil!
Ah! etc.
CUPIDON
Je vais te métamorphoser séance tenante. Tu connais ça.
JUPITER
Me métamorphoser en quoi ?
CUPIDON
Je veux que tu en aies la surprise.
JUPITER
La surprise ! La surprise ! J’ai besoin d’être joli, très joli, tu sais !
CUPIDON
Tu seras joli très joli ! Attention au changement, Papa, attention au changement !
JUPITER
En quoi va-t-il me mettre, le petit malheureux ?
CUPIDON
Une… deux… trois…
Scène 7
N° 23 PETITE RONDE DU BOURDON
LES CUPIDONS
Le beau bourdon que voilà
Est-il joli comme çà !
Bonne chance papa,
Passe, passe, passe là
Et la belle y restera.
Cupidon va chercher Eurydice et la drogue en lui faisant boire un cocktail.
Scène 8
N° 24 DUO DE LA MOUCHE
EURYDICE
Il m’a semblé sur mon épaule sentir un doux frémissement!
JUPITER
Il s’agit de jouer mon rôle plus un mot!
Car dès ce moment je n’ai droit qu’au bourdonnement!
(Imitant le bourdonnement de la mouche) Zi! Zi!
EURYDICE
Ah! la belle mouche!
Le joli fredon
JUPITER
Zi! Ma chanson la touche, chantons, chantons ma chanson!
EURYDICE
La belle mouche!
JUPITER
Ma chanson la touche, chantons ma chanson!
EURYDICE
Ah, la belle mouche!
Le joli fredon!
Bel insecte à l’aile dorée,
Veux-tu rester mon compagnon?
JUPITER (imitant la mouche)
Zi!
EURYDICE
Ces lieux dont tu forças l’entrée, hélas, me servent de prison.
JUPITER
Zi!
EURYDICE
Ne me quitte pas, je t’en prie, reste, on prendra bien soin de toi!
Ah! je t’aimerais, mouche jolie, reste avec moi, reste avec moi!
JUPITER
Quand on veut se faire adorer il faut se laisser desirer !
EURYDICE (courant à lui)
Je la tiens par son aile d’or!
JUPITER
Pas encor! Pas encor!
EURYDICE
Fi, la méchante, la méchante!
JUPITER
J’ai pris des ailes, ma charmante, j’ai bien le droit de m’en servir!
EURYDICE
Elle ne cherche qu’à me fuir !
De cette gaze légère, sans l’étouffer, je puis faire un filet à papillon.
JUPITER
Attention ! Attention !
EURYDICE
Ah! la voilà prise! plus de résistance !
JUPITER
La plus prise des deux n’est pas celle qu’on pense !
EURYDICE
Chante, chante !
JUPITER
Zi !
ENSEMBLE
Zi ! Zi !
EURYDICE
Ah! je la tiens ! Ah! c’est charmant !
JUPITER
Ah! je la tiens ! Ah! c’est charmant !
EURYDICE
Ah, je savais bien que je t’attraperais, mon joli bijou ailé ! Mais voyez donc, qu’elle est gracieuse! Quelles belles couleurs ! Et quelle taille fine !
JUPITER
Eh bien, tout cela est à toi, si tu le veux, mortelle adorée !
EURYDICE
Ah, grands dieux, elle parle ! Au secours !
JUPITER
Tais-toi ! J’ai pris ce costume pour tromper les regards jaloux d’un tyran qui ne veut que te torturer.
EURYDICE
Jupiter ! Le roi des dieux !
JUPITER
Oui, c’est moi. Ah! si je t’avais connue plus tôt, Pluton ne t’aurait pas enlevée. Je t’aurais emmenée dans l’Olympe.
EURYDICE
Voir l’Olympe et quitter cet affreux séjour ? Oh! fuyons, emmène-moi !
JUPITER
Nous n’avons qu’un moyen pour ne pas éveiller les soupçons. Il faut que je retourne à la fête que me donne cet idiot de Pluton. Retrouvons-nous tout à l’heure.
Ils se séparent, Jupiter sort en coulisses.
Scène 9
Jupiter revient ausstôt, fuyant John Styx armé d’une tapette et vociférant « Mouche ! Mouche ! ». Passant devant le bar, Styx s’arrête, oublie la mouche, jette la tapette, et prend une bouteille, avec l’intention de boire. Pluton arrive.
PLUTON
Où est elle ? Où est cette mouche ? Et Eurydice, où est Eurydice ?
JOHN STYX
Mais euh.. je ne sais pas… je…
PLUTON
Ah l’incapable. Si je ne fais tout moi-même ici… Eh bien prépare donc les lieux, le monde arrive. Et moi, je me charge de retrouver et la Belle et la Bête ! (il sort)
JOHN STYX (commençant à préparer les lieux pour l’arrivée des hôtes)
Si j’étais roi de Béotie, tu serais reine sur ma foi!
Je ne puis plus qu’en effigie t’offrir ma puissance de roi!
La plus belle ombre ma chérie ne peut donner que ce qu’elle a,
accepte donc, je t’en supplie, sous l’enveloppe que voilà
le coeur d’un roi de Béotie, le coeur d’un roi de Béotie!
Acte IV
Acte IV
Scène 1
N° 26 ENTR’ACTE ET CHOEUR INFERNAL
Arrivée de tous les dieux de l’Olympe.
LE CHOEUR
Vive le vin ! Vive Pluton !
Et nargue du qu’en-dira-t-on !
La divine cohorte que ce vieux vin transporte chante le Dieu
qui porte la couronne de fer !
Sa demeure chérie sera notre patrie,
si l’on comprend la vie, amis, c’est en enfer !
Vive le vin, etc.
Scène 2
CUPIDON
Allons, ma belle bacchante,
Mortelle émule de Vénus
Chante-nous, de ta voix charmante
Chante-nous ton hymne à Bacchus!
LE CHOEUR
Chante, belle bacchante
Chante-nous ton hymne à Bacchus!
N° 27 HYMNE A BACCHUS
EURYDICE
J’ai vu le Dieu Bacchus sur sa roche fertile,
Donnant à ses sujets ses joyeuses leçons,
Le Faune au Pied de chèvre et la Nymphe docile
Répétaient ses chansons, répétaient ses chansons!
DIANE, CUPIDON et les Déesses
Répétaient ses chansons !
Evoé ! Evoé ! Bacchus m’inspire !
Evoé ! je sens en moi, évoé,
Son saint délire, évoé, Bacchus est roi !
EURYDICE
Laissez, leur disait-il, les tristesses moroses,
Laissez les noirs soucis aux profanes humains,
Et vous, couronnez-vous de pampres et de roses
Qui tombent de mes mains, qui tombent de mes mains!
CUPIDON, DIANE et les Déesses
Qui tombent de mes mains!
Evoé ! etc.
Scène 3
PLUTON
Et voilà mon corps de ballet!
N° 28. MENUET ET GALOP INFERNAL
JUPITER
Maintenant, je veux, moi
Qui suis mince et fluet,
Comme au temps du grand roi
Danser un menuet.
DIANE
Ah!
TOUS
Ah! La la la la la!
Le menuet n’est vraiment si charmant que lorsque Jupin le danse.
Comme il tend d’un air coquet le jarret : comme il s’élance en cadence.
Le menuet, etc.
Terpsichore dans ses pas n’a pas plus d’appas.
Le menuet, etc.
JUPITER (à part)
Ce sot de Pluton n’a pas reconnu Eurydice : après la danse, nous lèverons le pied !
PLUTON (à part)
Cet idiot de Jupiter croit que je n’ai pas reconnu la bacchante… Mais j’ai l’oeil sur eux!
Scène 4
TOUS
Ce bal est original d’un galop infernal donnons tous le signal !
Vive le galop infernal ! donnons le signal d’un galop infernal !
Amis, vive le bal !
La la la la la !
Scène 5
EURYDICE (à part, à Jupiter)
Et maintenant, fuyons, Jupiter…
JUPITER (à part, à Eurydice)
Oui, profitons de ce qui nous reste de souffle, fuyons !
PLUTON (se dressant devant eux)
Où donc ?
EURYDICE
Aïe !
JUPITER
Que veut cet audacieux ?
PLUTON
Ah, plus de dignité, n’est-ce pas ? Crois-tu que j’ignore rien de ce qui se passe ici depuis deux heures ? Crois-tu que sous ce costume de bacchante je n’ai pas reconnu la femme ?…
JUPITER
… Que tu n’avais pas enlevée, disais-tu ?
PLUTON
Eh bien, oui, je l’avais enlevée ! Mais je m’en repens bien.
EURYDICE
Que dit-il ?
PLUTON
Je dis que tu t’es conduite avec moi comme avec ton mari ! Que tu m’as flanqué mon envers à l’Enfer – mon Enfer à l’envers, et que…
JUPITER (riant)
Il sait tout !
PLUTON
Riez, allez ! Rira bien qui rira le dernier ! La farce est bonne, mais vous ne l’emporterez pas ensemble en Paradis.
JUPITER
Et qui donc m’empêcherait, si je voulais ?
PLUTON
Qui ! Mais toi-même !
JUPITER
Que veut-il dire ?
PLUTON
Et le mari qui va venir, le petit mari.
EURYDICE
Mon mari ! Je l’avais completement oublié !
JUPITER
Moi aussi !
PLUTON
Ah, je vais être vengé ! Ce n’est pas à moi que tu rendras Eurydice, c’est à lui !
JUPITER
M… Miserere ! Qu’ai-je promis ?
On entend au loin un chant de violon.
N° 29. MELODRAME
PLUTON
La position se tend.
JUPITER
Elle est tendue.
PLUTON
Je vais élever le dialogue avec la situation. Je ne parle plus qu’en vers. Méfiez-vous.
Femme, reconnais-tu ce chant de violon?
EURYDICE
Ce chant qu’il trouve large et que je trouve long
C’est celui de l’époux que j’ai…
PLUTON
Tu l’as dit, femme,
C’est ton époux qui vient pour racheter ton âme.
Ton époux te réclame, on te rend à la terre :
c’est un joli cadeau que nous allons lui faire.
EURYDICE (suppliante)
Jupin !
JUPITER
Rassure-toi, pauvre ange, j’ai mon plan.
Et tu n’es pas encore au bras de ton tyran.
Scène 6
Apparaissent l’Opinion Publique et Orphée.
ORPHÉE
Oui, tu m’as convaincu, malgré ses injustices
C’est ma femme, et je veux ignorer ses caprices.
Puissant roi des âmes…
JUPITER
Assez, grâce du boniment.
Je connais ta demande, allons-y donc gaiement.
Fidèle à ma promesse, à tes désirs propices,
D’accord avec Pluton, je te rends Eurydice.
Va!
ORPHÉE (avec philosophie)
Jupiter me comble et Pluton est trop bon.
JUPITER
Mais j’y mets, cependant, une condition,
Condition expresse autant qu’inexplicable…
Que tu n’as pas besoin de comprendre, que diable!
Vers le Styx, gravement, tu vas t’acheminer
En précédant ta femme et sans te retourner
Si trop pressé de voir ton aimable Eurydice
Tu désobéissais à ce petit caprice,
Elle t’échapperait pour toujours, cette fois…
PLUTON (furieux)
Mais ce n’est pas du jeu!
JUPITER
L’on élève la voix?!
Allons, derrière toi va marcher Eurydice;
Ne te retourne pas! J’ai dit ! Qu’on obéisse
Scène 7
N° 30. FINALE
L’OPINION PUBLIQUE
Ne regarde pas en arrière.
A quinze pas fixe les yeux.
Ami, pense à la terre,
Elle nous attend tous les deux.
TOUS
Pour un époux, quel embarras !
Il se retournera, se retournera pas ?
JUPITER
Sur sa curiosité, aurais-je donc en vain compté ?
L’OPINION PUBLIQUE
Nous triomphons ! Ah, quelle joie !
JUPITER
Il ne se tourne pas ! Tant pis, je le foudroie !
Noir, jaillissement d’étincelles. Orphée se retourne brusquement comme si le coup l’avait atteint. Eurydice recule, guidée par les sbires, pour revenir dans les griffes de Pluton.
LES DIEUX
Ah!
L’OPINION PUBLIQUE
Malheureux, que viens-tu de faire?
ORPHÉE
Un mouvement involontaire !
PLUTON
Tu l’as perdue, et pour jamais !
Elle me reste donc.
JUPITER
Pas plus qu’à moi !
PLUTON
Comment ?
JUPITER
Non, car j’en fais une bacchante.
TOUS
Une bacchante !
EURYDICE à Bacchus qui vient d’arriver
Ah ! Ah ! Bacchus. mon âme légère qui n’a pu se faire
au bonheur sur terre, aspire à toi, divin Bacchus !
Recois la prêtresse, dont la voix sans
cesse veut chanter l’ivresse à tes élus !
TOUS (sur l’air du galop infernal)
La la la la la!
FIN