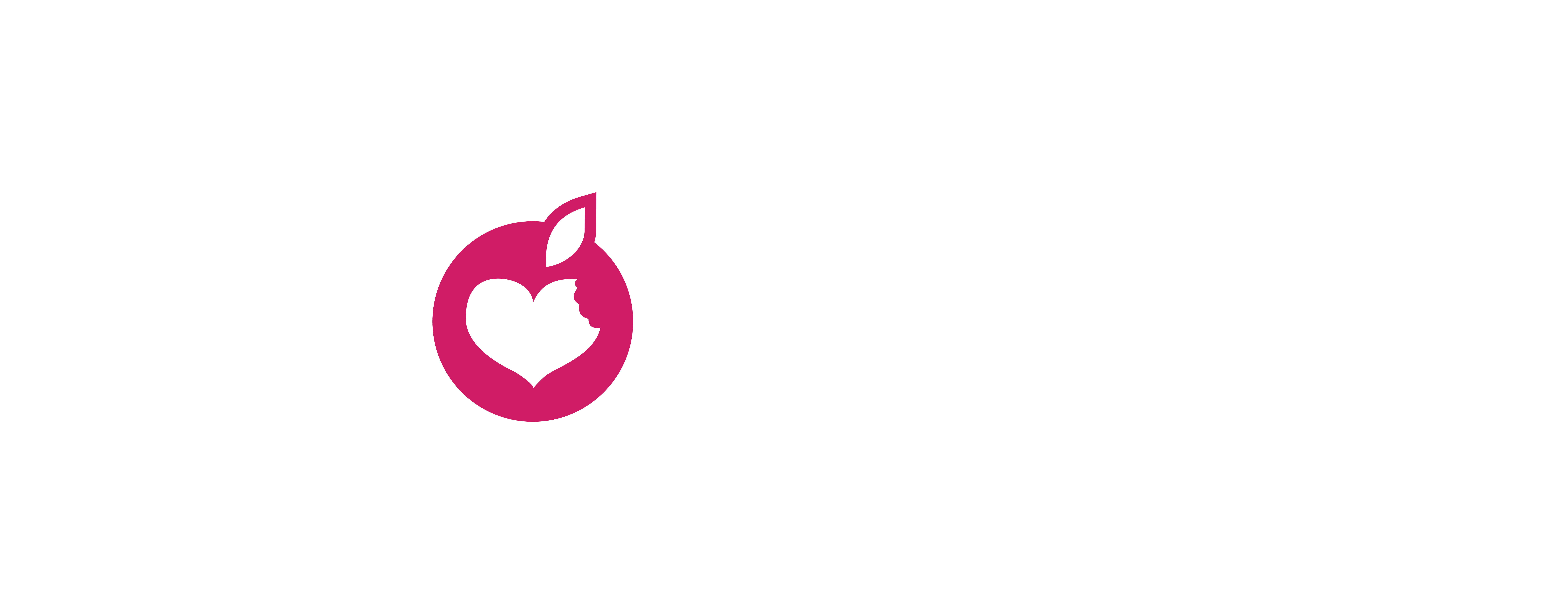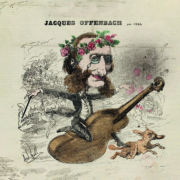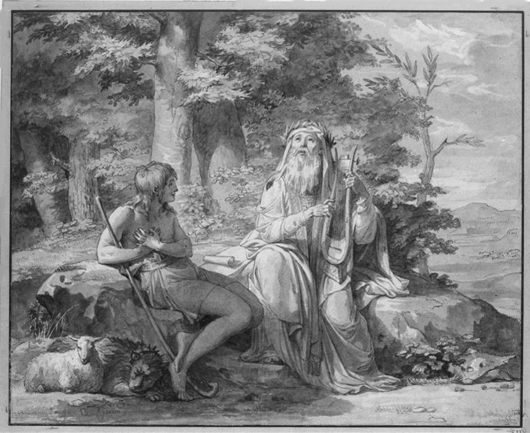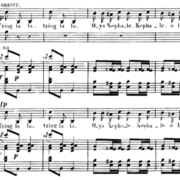Pourquoi s’accorde-t-on sur le la ?
On a déjà expliqué dans ces mêmes pages comment un orchestre s’accorde en début de concert, et qui est chargé de mener ce processus étrange et donne le la à tous les participants. Mais cela ne nous dit pas pourquoi c’est cette référence commune que tout le monde va adopter durant les prochaines heures de ce concert. Petite histoire abrégée du la…
Quel la ?
Des la, il en existe tout un tas. Il suffit de regarder le clavier d’un piano pour en compter 8 différents. De tous ces la, c’est en réalité le la3 qui est utilisé comme référence. C’est celui qui se place entre les lignes 2 et 3 sur une portée de clé de sol.
Le la, fût-il un la3, n’est pourtant pas une hauteur prédéterminée et n’existe pas de manière absolue. Le nom des notes utilisées dans la musique occidentale ainsi que leurs hauteurs ne sont en effet que des conventions qui facilitent la compréhension de la musique. De la même manière que les noms de couleurs ne sont que des étiquettes posées sur des réalités physiques, les notes de musique sont en réalité des fréquences déterminées par une valeur physique exprimée en Hertz (ou en battements par seconde).
Et en l’occurrence, le la de référence (le fameux la3) correspond à une vibration de 440 Hz. On le nomme donc parfois le la 440. D’ailleurs, si vous avez connu l’époque lointaine des téléphones fixes (c’est comme un smartphone mais avec un fil constamment relié au mur), ce la 440 est exactement la hauteur de la tonalité d’attente.
Mais alors pourquoi le la et pourquoi 440 ?
Pourquoi le la ?
La réponse est multiple. D’abord c’est par simple convention. On pourrait accorder un orchestre sur un do, un sol dièse ou un mi bémol qu’on arriverait globalement au même résultat. Mais on n’imagine pas qu’à chaque concert, le hautbois se lève en hurlant « Aujourd’hui les enfants, on part sur un fa … [pouet] … ». On pourrait très bien décider que le lundi on s’accorde sur un do, le mardi sur un ré, … Mais voilà, on a tranché, c’est un la. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas.
Mais en fait, le la répond aussi – et surtout – à un critère de commodité pour les nombreux instruments à cordes. Le la fait en effet partie des cordes à vide qu’ont en commun les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Il ne s’agit pas du même la selon la taille de l’engin, mais tous possèdent une « corde de la ». Or il est plus facile et nettement plus fiable d’accorder des instruments à cordes sur une corde à vide, sans se préoccuper de la position de la main gauche et de l’imprécision que cela rajouterait à l’accord.
D’ailleurs il est courant – bien que non systématique – qu’une partie des pupitres de vents, pour qui les contraintes logistiques sont très différentes de celles des cordes, préfèrent s’accorder sur un si bémol plutôt que sur un la. Lorsque c’est le cas, on entend donc le hautbois donner successivement deux notes différentes à chaque partie de l’orchestre.
Pourquoi 440 Hz ?
De même qu’on aurait pu prendre comme référence un mi bémol plutôt qu’un la, on aurait tout aussi bien pu établir que le la correspond à la fréquence de 441 Hz, ou bien 1 Hz ou encore 1 milliard de Hz. Et d’ailleurs, cette fréquence de 440 Hz n’a pas toujours été la norme en vigueur.
Jusqu’au XIXe siècle, il n’y a en fait pas de réelle référence commune de fréquence. D’ailleurs, le concept même de fréquence des sons n’a été découvert qu’au XVIIIe siècle. Autrefois (bien avant l’époque des téléphones fixes, pour vous dire si c’est ancien…), les instrumentistes s’accordaient donc entre eux selon d’autres principes. Par exemple on pouvait s’accorder sur la hauteur de la flûte dont la fabrication en un seul morceau imposait une hauteur non réglable, ou sur l’orgue qui, une fois fabriqué, ne peut plus vraiment ajuster la hauteur de ses tuyaux. Et de fait, la référence du la variait considérablement selon les régions, les orchestres ou les compositeurs.
Des études réalisées sur des instruments d’époque montrent ainsi que le la a pu s’étaler entre 330 et 560 Hz entre le XVIe et le XIXe siècle, avec une tendance assez généralisée à s’élever au cours de l’histoire. Le la de Mozart tournait aux alentours de 422 Hz, celui de Haendel à 423 Hz, celui de Verdi à 432 Hz. Le baroque vénitien (notamment Vivaldi) semblait se fonder sur 440 Hz tandis que les allemands (Bach, Telemann, …) privilégiaient un 415 Hz et les français (Couperin, Marin, Charpentier, …) un 392 Hz. Le diapason de l’Opéra de Paris a longtemps été à 449 Hz (diapason dit « de Berlioz »). Bref, un beau bazar !
La disparité des accords commence à poser de sérieux problèmes lorsque s’accroissent les échanges entre les musiciens qui se mettent à voyager de plus en plus d’un orchestre à l’autre à travers le monde. Par ailleurs, au XIXe siècle, les instruments sont de plus en plus fabriqués en série et exportés partout dans le monde suite aux révolutions industrielles. Si on rajoute à cela la question très spécifique des chanteurs pour qui chanter la même partition avec de gros écarts de diapason ne constitue pas tout à fait le même effort physique, la nécessité d’une uniformisation émerge de plus en plus dans les milieux musicaux.
Chronologiquement, Liszt et Wagner sont parmi les premiers à tenter cette uniformisation. Entre 1830 et 1840, le la 440 Hz entre ainsi progressivement en vigueur en Allemagne. En 1858, sous l’impulsion de Berlioz, le gouvernement français monte une commission de physiciens et musiciens – on y retrouve notamment Auber, Meyerbeer et Rossini – qui planchent environ un an pour établir un la à 435 Hz. En 1884, c’est Verdi qui obtient du gouvernement italien la réunion d’une autre commission musicale qui promulgue par décret que le la sera à 432 Hz. Ce décret, approuvé à l’unanimité par la commission, est toujours exposé au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.
Le problème est donc partiellement résolu. Partiellement seulement puisque les tentatives d’uniformisation se sont faites de manière assez locale, conduisant ainsi à une homogénéité relativement… hétérogène.
C’est seulement en 1939 que le problème du la est enfin considéré à une échelle internationale. Un collège d’experts est rassemblé à Londres et la Fédération internationale des associations nationales de standardisation décide que l’étalon sera désormais fixé à 440 Hz. La décision est entérinée en 1953 lors d’une conférence internationale tenue à Londres, et ce malgré les protestations des Français et des Italiens. Pour enfoncer le clou, la valeur de 440 Hz est inscrite en 1975 dans la norme internationale ISO 16:1975.
La « victoire » du 440 n’a pas manqué de susciter des théories complotistes assez farfelues, dont celle d’un coup d’état nazi, et d’innombrables articles, tous plus fantaisistes les uns que les autres, paraissent alors pour justifier que le 432 Hz serait une fréquence de vibration plus harmonieuse, biologique, astronomique et spirituelle. Le la 440 s’impose pourtant peu à peu à travers le monde, dans les salles de concert et dans la plupart des conservatoires (et dans les téléphones fixes).
Et aujourd’hui ?
Tout le monde joue-t-il à présent sur un 440 Hz réglé à la virgule près ? Et bien non ! Aujourd’hui encore, l’accord de l’orchestre peut varier selon le contexte en dépit de tous ces efforts de normalisation. Certes on est très loin du niveau de disparité d’il y a 400 ans. Mais de nombreux orchestres choisissent toujours volontairement de s’accorder à une hauteur différente selon le répertoire qu’ils jouent, en se fondant sur des volontés philologiques de retrouver les conditions et modes de jeu correspondant à l’époque des œuvres exécutées.
Il se murmure même que l’orchestre d’Oya Kephale ne joue pas non plus à 440 Hz. Mais chut, je ne vous ai rien dit …
Rédaction de l'article